Union communiste libertaire
Manifeste de l’Union communiste libertaire
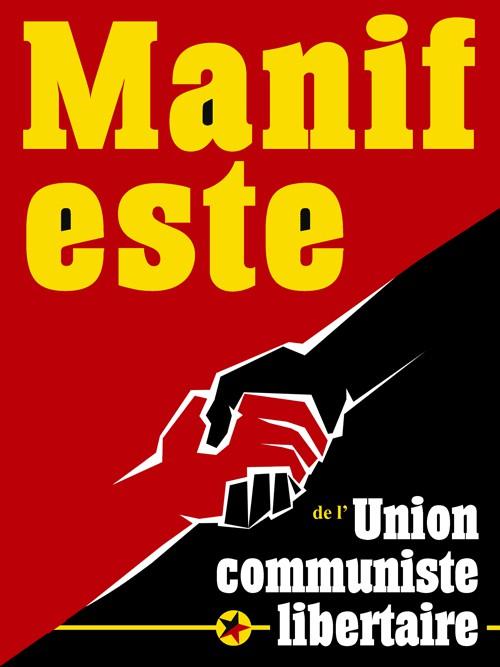
L’urgence écologique et sociale
Un moteur : la lutte des classes
Combattre toutes les aliénations
Un antifascisme social et populaire
Une stratégie fondée sur les luttes sociales et l’auto-organisation
Notre pratique syndicaliste révolutionnaire
Des valeurs pour un monde nouveau
Porter un projet de société alternatif
Contre-pouvoir, double pouvoir et rupture révolutionnaire
*Le Manifeste de l’Union communiste libertaire est la base commune à toute l’organisation, adoptée lors du congrès d’unification d’AL et de la CGA, du 8 au 10 juin 2019, dans l’Allier.
Les gens qui veulent rejoindre l’UCL sont invités à le lire au préalable, pour vérifier qu’ils sont en accord dans les grandes lignes.*
Un autre futur
Partout, la réaction, la régression, la destruction sont à l’œuvre. Bâti sur l’inégalité, sur l’accaparement des richesses par les classes dirigeantes, le système capitaliste et ses relais à la tête des États poursuivent leur fuite en avant au mépris des crises toujours plus graves qu’ils engendrent et qui, désormais, les dépassent. Profondément mortifère, ce système, fondé sur la propriété privée des moyens de production, de distribution et d’échange, et sur la recherche du profit, détruit les êtres vivants et dévore la planète jusqu’à menacer notre existence même. Il organise, à l’échelle du monde, une concurrence généralisée qui fracture les sociétés, les jette les unes contre les autres.
Un seul mot d’ordre semble prévaloir : la précarisation des conditions de vie, de travail, de sociabilité. Méthodiquement, les solidarités essentielles au bon fonctionnement de la société, les droits arrachés par les luttes à la voracité des classes dominantes sont attaqués et détruits. Toute contestation est réprimée par une violence toujours plus grande.
Dans les pays industrialisés, le pouvoir ne se soucie même plus de légitimer sa domination par une part de redistribution ou par la garantie de libertés publiques. La social-démocratie a vécu. L’époque est celle du retour de la peur. Peur de perdre ses moyens de subsistance, quand chacune et chacun est contraint à l’isolement social. Peur qui permet à la haine des différences – ultime atout d’un système mis à nu – de prospérer dans les discours politiques.
Face à un tel constat, il y a urgence à construire un changement radical de société.
Pourtant, notre camp social est à la peine. La crise de légitimité qui frappe les gouvernants, accusés à raison de ne représenter qu’eux-mêmes et de défendre un système dont ils tirent profit, fragilise aussi les organisations traditionnelles du mouvement social et révolutionnaire, qui peinent à incarner une alternative.
Mais de cette crise de légitimité naissent aussi des mobilisations nouvelles, qui rejettent les formes d’organisation et les idéologies anciennes pour exiger une démocratie directe et radicale. Un foisonnement porteur de possibles, d’écueils aussi, d’expérimentations en tout cas.
Cette exigence de démocratie directe, ce refus de la délégation, cette affirmation du pouvoir à la base, pour la base, sont aussi les nôtres. Mais il reste encore du chemin pour qu’elles rompent avec les mirages électoraux vendus par la social-démocratie, cette promesse qu’abandonner sa capacité de décision au profit de quelques-uns profiterait à toutes et à tous. Elle est aussi en rupture avec la dictature pratiquée par les régimes socialistes autoritaires.
À cette exigence de démocratie directe, nous ajoutons la lutte contre toutes les aliénations et contre toutes les oppressions – capitaliste, raciste, patriarcale, religieuse… – sans hiérarchie entre elles. Nous assumons aussi notre analyse qu’une organisation formelle est à la fois un outil utile aux luttes et un moyen de garantir une démocratie réelle, par la mise en place de fonctionnements collectifs.
Cette organisation, nous l’inscrivons dans le courant communiste libertaire. Mais nous ne nous figeons pas sur un dogme qui aurait été défini une bonne fois pour toutes. Fondant notre pratique politique sur l’implication dans les luttes sociales, sur nos lieux de travail et nos lieux de vie, en phase avec les réalités de la société contemporaine, avec l’évolution des rapports de classes et de domination. Puisant dans les courants révolutionnaires, autogestionnaires, antiautoritaires, antiraciste, anarchistes, écologistes, féministes, syndicalistes passés comme présents, nous nous nourrissons des expériences menées dans tous les lieux où les exploité·es se battent pour leur émancipation. Sans limiter nos références. Sans nous limiter, non plus, aux frontières des États. Notre combat fait écho à ceux menés ailleurs, et s’inscrit en solidarité avec eux. Il est partie prenante d’une lutte qui est internationale et d’un projet internationaliste.
La période que nous vivons est instable, et nous ne prétendons pas connaître toutes les réponses aux enjeux qu’elle pose. Mais nous savons ce que nous voulons ; nous n’avons pas besoin d’hommes providentiels. Nous savons dans quelles conditions nous voulons vivre et vieillir, travailler, apprendre, aimer. Notre combat, détaillé dans ce manifeste, est un combat pour une société dans laquelle la coopération serait logique et la concurrence absurde, dans laquelle travailler serait intéressant et utile, dans laquelle l’arrivée d’une étrangère ou d’un étranger serait une bonne nouvelle.
Une société dans laquelle les travailleurs et travailleuses géreraient elles-mêmes leur activité, dans laquelle les usagères et usagers détermineraient eux-mêmes leurs besoins, dans laquelle on ne serait pas opprimé·e du fait de son handicap, de sa couleur de peau, de son genre ou de sa sexualité, dans laquelle la planète ne serait ni une poubelle ni un magot dont tirer profit. Une société dans laquelle quelques-uns, détenteurs du capital, ne se goinfreraient pas sur le dos de toutes et tous les autres, où un chef n’aurait pas raison contre tout le monde. Une société débarrassée du capitalisme et de l’État, du racisme et du patriarcat.
L’urgence écologique et sociale
Le monde vivant est aujourd’hui menacé par le dérèglement climatique, la déstabilisation de la biodiversité, l’empoisonnement des terres et des eaux, l’artificialisation des terres, la déforestation… La lutte écologiste est vitale ; elle n’est cohérente qu’en étant anticapitaliste et antiproductiviste.
Le capitalisme repose sur la nécessité d’une croissance continue de la production et sur une extension de son emprise. Il surexploite les ressources planétaires. Pour optimiser la production et la distribution, il a poussé à son paroxysme la spécialisation et la hiérarchisation des espaces par la métropolisation. Cela éloigne toujours plus les lieux de production, de consommation, de vie et de travail.
Les classes dominantes se nourrissent de l’illusion qu’il serait possible de résoudre la crise environnementale par la technologie, sans sortir du capitalisme. Elles combattront toute mesure, même indispensable, qui menacerait leurs profits.
Elles se font le chantre d’un capitalisme prétendument « vert » qui promeut des solutions partielles exclusivement techniques, ouvrant de nouveaux marchés sans remettre en question la tendance mortifère à l’accumulation indéfinie du capital.
L’acceptation du cadre capitaliste conduit, au mieux, aux diverses solutions individuelles de « simplicité volontaire » avec un impact global limité, et, au pire, à une politique de rationnement pour les classes populaires, qui sont les premières victimes des désastres écologiques. Les capitalistes confisquent aux classes populaires les moyens de choisir comment elles consomment, comment elles produisent, comment elles se déplacent, etc. Ils les contraignent donc à participer à la destruction de l’environnement.
À l’inverse nous défendons la perspective d’une production répondant aux besoins de l’humanité et respectant les limites de la biosphère. Au lieu d’une exploitation destructrice de la nature, l’humanité devra trouver un équilibre avec les autres formes de vie.
Trois révolutions sont nécessaires :
• Une révolution des modes de production. La maîtrise de la production par les paysans et paysannes sera le fer de lance du combat contre les multinationales agroalimentaires : fin de la spécialisation agricole de régions entières ; remise en cause de l’utilisation massive des pesticides et des engrais industriels ; abolition des élevages industriels, des abattages à la chaîne, de la pêche industrielle…
• Une révolution des modes de vie. Nous nous battons pour une société égalitaire dans laquelle les moyens de production seront socialisés. Un nouveau mode de vie pourra naître. L’organisation des villes, les équilibres entre villes et ruralité, l’organisation de nouveaux habitats – favorisant la mutualisation de biens et d’installations –, tout pourra être transformé. Une vie sociale riche, associant convivialité, culture, sciences, activités physiques, festives… pourra éclore et la possession de biens matériels n’aura plus une place centrale dans la vie humaine. Une société où l’être humain ne se considère plus comme supérieur aux autres espèces, maîtrise l’impact de ses implantations et de ses activités sur l’environnement, afin de vivre en harmonie avec le reste du monde vivant.
• Une révolution des échanges. Contre le libre-échange, nous défendons l’« autonomie productive ». Chaque région du monde doit être en mesure de produire ce dont elle a besoin une fois débarrassée de la dépendance des multinationales. Cela ne signifie pas une autarcie, mais des circuits d’échange courts, et la limitation des échanges longs à ce qui ne peut être produit localement.
Des pans entiers de l’économie capitaliste devront disparaître, en particulier tout ce qui est lié à la marchandisation du vivant, au contrôle des classes dominées, à la publicité, au suremballage, à l’appropriation privée des terres, des bâtiments et des outils de production, à la bourse et à la domination de la finance, aux productions réservées aux classes privilégiées, aux temps de transport absurdes imposés par la ségrégation socio-spatiale, à l’extraction de ressources des sous-sols des pays du Sud…
L’utilisation de matières premières à fort taux de dangerosité, difficilement recyclables et dont l’extraction détruit l’environnement devra être sévèrement plafonnée et remplacée dans la mesure du possible. Nous combattons autant les énergies fossiles que le nucléaire.
Nous revendiquons la sortie du nucléaire avec arrêt immédiat de son utilisation civile (hormis les usages médicaux) et militaire, car c’est un système autoritaire lié à l’industrie militaire impliquant une gestion policière, excessivement dangereux, dont la pollution est irréversible, et aux antipodes d’un modèle énergétique décentralisé et démocratique. Les besoins en énergie, réduits par les nouveaux modes de production et de vie, pourront être satisfaits avec des sources renouvelables d’énergie, produite en priorité localement et en fonction des besoins.
Une écologie sociale au cœur des luttes
Le combat écologiste est intimement lié au combat pour un autre type de société. Il est inséparable du combat pour une démocratie directe et pour une égalité économique. La construction d’une convergence entre les luttes sociales et les luttes écologistes est ainsi la brique fondamentale d’une stratégie écologiste conséquente.
Nous récusons à l’avance toute logique antidémocratique, dans laquelle des experts – trop souvent liés aux classes dominantes – décideraient à la place des populations concernées.
Nous n’attendons rien de l’institutionnalisation des luttes écologistes, ni des réponses institutionnelles à la crise environnementale. Elles sont inefficaces et préservent les intérêts des capitalistes.
Nous voulons contribuer à construire le combat écologiste de façon pluraliste :
– au sein d’associations spécifiquement écologistes, en y défendant la prise en compte des intérêts des classes populaires et en recherchant le débat et les alliances avec le mouvement social ;
– au sein du mouvement syndical et des associations de lutte sur le logement, la santé… en se battant pour que la dimension écologique soit systématiquement prise en compte et que le mouvement social devienne un des acteurs des mobilisations écologistes ;
– en participant à la création d’outils collectifs de production et de distribution.
Les victoires partielles obtenues par les résistances locales sont importantes. Elles ne prendront tout leur sens que si elles permettent d’affaiblir l’emprise idéologique du capitalisme. Ainsi les expérimentations alternatives – construites en convergence avec une dynamique de luttes sociales revendiquant la socialisation des moyens de production – permettront de populariser des imaginaires libertaires et de structurer des éléments de contre-pouvoir indispensables au renversement du capitalisme.
Un anticapitalisme vital
Nous sommes résolument anticapitalistes. Nous ne nous opposons pas seulement aux abus du système qui domine aujourd’hui le monde entier. Nous sommes radicalement opposé·es à ses fondements : l’exploitation du travail humain au profit de minorités dirigeantes et privilégiées ; l’exploitation des ressources naturelles menant à leur destruction ; le développement mondial inégal et l’impérialisme ; l’aliénation de l’individu ; la domination étatique et patronale sur la société.
Anticapitalistes, nous refusons la course aux profits, la logique d’entreprise, le modèle de développement productiviste, la hiérarchie et les inégalités sociales, qui sont les credo d’une société dominée par le mode de production capitaliste.
Nous sommes anticapitalistes pour des raisons sociales, par notre engagement dans la lutte des classes. Nous le sommes pour des raisons éthiques, par notre attachement à des valeurs égalitaires, libertaires, de justice sociale et de respect des spécificités de chaque individu. Nous le sommes également pour des raisons vitales, puisque le capitalisme repose sur une surexploitation toujours plus poussée des ressources environnementales qui menace la survie de l’humanité.
Il n’y a pas de capitalisme « à visage humain »
Nous sommes opposé·es au capitalisme quelle que soit la forme historique sous laquelle il se présente : capitalisme libéral ou capitalisme d’État. Nous sommes opposé·es au capitalisme libéral, fondé sur une régulation « autonome » du marché, et qui se prétend « démocratique ». Il repose sur un mode de production par essence antidémocratique et est tout entier tourné vers la réalisation des profits des classes dirigeantes.
Nous sommes opposé·es au capitalisme d’État, même quand il se prétend « socialiste », voire « communiste ». Il repose sur un mode d’exploitation et de domination tyrannique des travailleuses et travailleurs, et sur la détermination autoritaire du marché, au profit d’une classe privilégiée et toute-puissante. Ces deux visages du capitalisme créent une structure bureaucratique et technocratique. Nous ne soutenons en conséquence ni une étatisation partielle ou totale du capitalisme libéral, ni une privatisation partielle ou totale du capitalisme d’État. Qu’il s’agisse du secteur public ou privé, la règle selon laquelle fonctionne le capitalisme a toujours été celle de la collectivisation des pertes et de la privatisation des bénéfices.
« Protectionnisme » et « libre-échange », capitalisme national et capitalisme mondialisé sont les deux faces d’une même monnaie. Au gré de leurs intérêts, les classes possédantes plaident pour l’un ou pour l’autre. Il ne faut pas y chercher de cohérence idéologique. Leur seul dogme, c’est celui de la propriété privée des moyens de production et de distribution. Tout le reste est adaptable aux circonstances.
Notre anticapitalisme s’inscrit dans les luttes quotidiennes et la lutte des classes pour aboutir à un socialisme autogestionnaire et libertaire.
Un moteur : la lutte des classes
Nous affirmons que la division de la société en classes sociales antagonistes demeure le fait majeur du capitalisme moderne. Le capitalisme a connu de profondes mutations, il n’a cessé et il ne cessera de se transformer, à travers un cycle de crises et d’expansions. Mais il n’en repose pas moins d’abord et toujours sur des rapports de domination, dirigeants/dirigé·es, avec leur corollaire : l’exploitation des travailleurs et travailleuses manuel·les ou intellectuel·les par les classes dirigeantes.
Une conception moderne du prolétariat
Les classes sociales sont déterminées par leur place dans les rapports de pouvoir et dans la production – qu’il s’agisse de la production des biens matériels, des marchandises, des équipements, ou de la production des services – dans le secteur privé comme dans le secteur public. La lutte des classes oppose principalement la classe capitaliste et le prolétariat moderne. La classe capitaliste est constituée des catégories qui, propriétaires et gestionnaires des moyens de production, organisent la production et accaparent la plus-value qu’elles répartissent entre elles. Le prolétariat moderne regroupe l’ensemble des groupes sociaux qui, parce qu’ils sont privés de toute propriété ou possession de moyens de production, sont contraints à vendre leur force de travail (manuel et/ou intellectuel) pour la plupart d’entre eux sous la forme du salariat et sans pouvoir réel de décision sur la production.
Entre classe capitaliste et prolétariat, de nouvelles couches moyennes salariées se sont développées (cadres, ingénieur·es, technicien·nes…), qui occupent des tâches de gestion et d’encadrement. Ces couches pèsent toujours plus, politiquement mais aussi culturellement. La conduite de la lutte de classe suppose que la distinction soit faite parmi celles-ci, entre celles dont le commandement n’est que d’ordre technique et professionnel, et celles qui participent à l’établissement de la finalité de la production.
Une partie des indépendantes et indépendants oscillent, d’un point de vue matériel et idéologique, entre les catégories supérieures et populaires, en fonction du capital (social, culturel, et économique) possédé, des revenus tirés de leur activité et de leurs conditions de travail. Les travailleuses et travailleurs non salariés de la terre, du bâtiment, ou de la santé notamment – dont le plus grand nombre subit l’exploitation de ce système de domination – constituent toujours une catégorie sociale importante, tant du fait de la finalité de leur travail que de leur place dans l’environnement naturel et social.
Les mutations récentes du capitalisme dans les sociétés les plus riches ont diversifié et émietté le prolétariat malgré sa place importante dans la société, rendant plus difficiles la construction et la transmission d’une conscience de classe. L’accélération de la lutte des classes menée par la classe capitaliste conduit à plonger de façon durable une part de plus en plus importante des travailleuses et des travailleurs dans le chômage ou la précarité. De nouvelles formes d’exploitation au travail se développent en dehors du salariat, tel l’auto-entrepreneuriat qui permet à de grands groupes privés, parfois par le biais de plateformes numériques, de faire appel à des travailleuses et travailleurs sous-payés et faussement « indépendants », sans leur garantir une protection juridique et sociale.
Le recours à la sous-traitance qui caractérise le capitalisme actuel, avec parfois plusieurs échelons de sous-traitances, dilue les responsabilités patronales et divise d’autant plus le prolétariat, entre les sous-traitant·es et celles et ceux disposant d’un statut.
Pour une démarche inclusive
Malgré des conditions et vécus communs, le prolétariat n’est pas une classe sociale uniforme. Il est traversé par d’autres systèmes de domination qui le subdivisent en groupes sociaux distincts. Les conditions de travail, la rémunération, ou encore les possibilités de trouver un emploi dépendent de la qualification, mais aussi du sexe, du genre, du handicap, de la couleur de peau, des capacités, de la ou des langues parlées, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de la nationalité, de la religion réelle ou supposée… Les femmes, les personnes LGBTI, et les personnes racisées subissent généralement une exploitation accrue et multiforme.
Le capitalisme instrumentalise ces divisions pour mettre en concurrence ces différentes fractions du prolétariat. Les combats pour l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, contre les discriminations racistes ou LGBTIphobes au travail, ou encore pour les droits des travailleurs et des travailleuses sans papiers font donc partie intégrante de la lutte des classes. De même, les personnes souffrant de handicap se retrouvent particulièrement discriminées et marginalisées. Leurs besoins spécifiques sont ignorés par le capitalisme et les institutions normatives qui les considèrent comme des « coûts » supplémentaires, rendant difficile, voire impossible, leur intégration pleine et entière dans la société. C’est pourquoi nous soutenons leurs luttes pour l’égalité des droits et des conditions de vie. S’ajoute à tout cela, et faisant partie intégrante de la lutte des classes, la lutte contre la hiérarchie visant à l’abolition de l’opposition dirigeant·e-exécutant·es dans le travail.
Un rôle déterminant à jouer
La vision d’une classe uniquement ouvrière, minoritaire, avant-garde sociologique et unique force d’entraînement est une vision dépassée qui ne prend en compte que la domination capitaliste et nie les autres oppressions.
Ce nouveau prolétariat multiforme mais unifiable sur la base de sa situation commune, dominée, exploitée, doit chercher des convergences revendicatives et anticapitalistes avec de larges pans des couches moyennes salariées et des autres catégories sociales dominées par le capitalisme. Ces convergences se construiront à travers les luttes sociales, les prises de conscience collectives, et l’émergence de projets nouveaux de transformation de la société.
Il nous revient, aujourd’hui, à nous, révolutionnaires, de renforcer l’inclusivité des luttes. Il faut arrêter de ne parler et de ne lutter qu’avec une frange particulière du prolétariat. Celui-ci est multiple, nos revendications doivent l’être également. Associer à notre vision anticapitaliste une vision antipatriarcale et antiraciste, c’est renforcer le camp des révolutionnaires, c’est lutter ensemble pour l’entièreté des prolétaires. Cette convergence se construira à travers les luttes sociales, les prises de conscience individuelles et collectives, et l’émergence de projets nouveaux de transformation de la société.
La lutte des classes est au cœur de notre combat révolutionnaire. Elle est à la fois porteuse de transformations partielles (sur le travail, le partage des richesses, le droit, les institutions…) opposées à la logique et aux intérêts des dominants, et d’une rupture révolutionnaire posant les bases d’une société nouvelle émancipant l’ensemble de l’humanité. Le prolétariat, du fait de sa place dans les rapports de domination et de production, aura un rôle central à jouer dans la rupture avec le capitalisme et l’instauration de l’autogestion.
Libérer la société de l’État
Nous refusons le mythe de l’État républicain, neutre, démocratique, surplombant des intérêts particuliers. L’État, c’est au contraire l’organisation de la violence politique des classes dirigeantes qui s’impose à la base de la société.
Si le principe étatique a émergé il y a plusieurs milliers d’années, l’État moderne est une institution récente, concentrant entre ses mains la force militaire, policière, judiciaire et les ressources fiscales. Reposant sur le mythe de l’unité nationale par-delà les classes sociales, l’État constitue un outil fondamental de contrôle des populations et d’uniformisation culturelle. Il est l’arme principale dont disposent les classes dominantes pour asseoir leur pouvoir, aussi bien par la force que par l’idéologie. Il constitue l’instrument essentiel du colonialisme et de l’impérialisme modernes.
Mutation de l’État moderne
Sous le mode de production capitaliste, le gouvernement est largement l’instrument des intérêts du capital. Il participe à la constitution et à la défense des grands monopoles privés et publics. La vague néolibérale de privatisations et d’ouvertures à la concurrence perpétue l’hybridation croissante du haut fonctionnariat et de la classe capitaliste, dont les représentants circulent, au fil de leur carrière, entre la finance, l’industrie et l’administration, tissant des liens de plus en plus étroits entre sphère étatique et sphère marchande.
Si l’État néolibéral prétend moins intervenir directement dans l’économie, il continue de subventionner le secteur privé, notamment les secteurs stratégiques (armement, énergie, transports, etc.).
La décentralisation du pouvoir d’État initiée en France dans les années 1980 n’a pas encouragé le pouvoir populaire ; elle a simplement redistribué les prérogatives de l’État central à des fractions locales de l’élite politique.
La mondialisation néolibérale n’a pas non plus remis en cause le principe étatique ; elle n’a fait que transformer ses méthodes d’action. La construction de l’Union européenne a accompagné une évolution des attributions de l’État en accentuant la dépossession démocratique et en accélérant la destruction des services publics.
Ni le supranationalisme, ni le régionalisme ne constituent des moyens d’échapper à l’oppression étatique.
À l’heure où le capitalisme néolibéral connaît des crises successives depuis les années 1980, L’État apparaît encore davantage comme le dernier rempart au service de la bourgeoisie pour imposer ses réformes, réprimer la contestation sociale et défendre l’ordre social inégalitaire. Une frange de plus en plus importante de la bourgeoisie appelle de ses vœux le renforcement autoritaire, raciste et sexiste de L’État, en témoigne la montée des forces politiques conservatrices et d’extrême droite qui trouvent toujours plus d’audience dans les classes dominantes. Notre génération bascule dans une nouvelle époque marquée à droite ; plus que jamais nous devons construire des contre-pouvoirs qui marquent la rupture avec l’État.
Le sens de notre anti-étatisme
L’anti-étatisme libertaire se distingue radicalement de l’anti-étatisme libéral. Le premier veut émanciper la société de l’État et du capitalisme ; il défend la gestion collective des biens et des services publics. Le second veut à la fois « moins d’État » pour libérer les marchés, et « plus d’État » policier et militaire pour contrôler la population et défendre les intérêts capitalistes à l’étranger.
L’anti-étatisme libertaire se distingue également nettement de l’anti-étatisme théorique du marxisme-léninisme. Contrairement à ce qu’affirme ce dernier, l’État n’est pas seulement un « produit des contradictions de classe » voué à « s’éteindre » de lui-même avec la disparition de la classe capitaliste. L’expérience soviétique a démontré que c’est un appareil de domination en soi, dont la logique interne est de se reproduire en engendrant une technocratie qui constituera la nouvelle classe exploiteuse.
Nous luttons aussi contre les institutions de répression utilisées par l’État en vue de maintenir l’ordre social : police, justice, prisons, fichage, contrôle administratif…
L’illusion du changement par les urnes
Il ne peut y avoir de réelle démocratie dans le cadre du capitalisme. C’est pourquoi, sans faire de l’abstentionnisme un dogme intangible, nous boycottons les institutions de l’État et les élections représentatives.
La participation aux élections représentatives constitue, pour le mouvement social et révolutionnaire, une impasse qui ne peut engendrer que division, compromission, renoncement, institutionnalisation et instrumentalisation, éloignant les exploité·es de l’action directe. Or, les conquêtes sociales n’ont pas été obtenues grâce aux urnes, aux alliances ou aux allégeances électorales mais par les luttes collectives.
Loin de correspondre à du mépris pour les personnes qui votent, l’anti-électoralisme que nous professons est politique et non circonscrit aux échéances électorales : il renoue avec l’esprit de la Première Internationale qui affirmait que « l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ».
Nous œuvrons à préserver l’unité du mouvement social face aux divisions qui peuvent apparaître lors des échéances électorales.
Pour autant, nous ne renvoyons pas dos à dos les régimes représentatifs et les régimes autoritaires et dictatoriaux. Les uns et les autres n’aboutissent pas au même degré d’oppression des populations. Les libertés publiques – d’expression, de presse, d’association, de manifestation – ainsi que les services publics sont des conquêtes du mouvement ouvrier, que l’État n’a concédées que pour préserver l’ordre social. Face à l’offensive sécuritaire visant à accentuer le contrôle social de la population, il faut défendre pied à pied, et étendre, chaque conquête obtenue par la lutte. Quel que soit le régime politique, notre objectif reste le même : l’émancipation de tous et toutes et la justice sociale.
Une alternative fédéraliste
Notre projet politique se propose de substituer le fédéralisme autogestionnaire à l’organisation étatique et capitaliste. Dans une telle société, la population fixera elle-même les grandes orientations économiques et politiques.
La révolution, telle que nous la concevons, devra remplacer la démocratie indirecte par une démocratie directe. Une large décentralisation fédérative devra éviter la dépossession du pouvoir populaire au profit d’un nouveau pouvoir d’État, centralisé et coupé de la société.
Une démocratie authentique et véritablement émancipatrice ne pourra se réaliser qu’en dehors du carcan capitaliste et étatique, au sein d’une société sans classes.
Briser la mécanique raciste
Qu’il prenne la forme de discours haineux ou de discriminations, qu’il soit véhiculé par l’État, la bourgeoisie ou le prolétariat, le racisme est un système de domination multiforme qui crée des divisions au sein des populations, entre un groupe majoritaire et des groupes minoritaires opprimés, en prenant pour base une origine, des critères physiques ou culturels auxquels des stéréotypes sont rattachés.
Un produit du nationalisme et du colonialisme
Les États européens, dans leur volonté d’uniformiser les territoires contrôlés et de centraliser le pouvoir, ont construit politiquement et de manière artificielle un « corps national » autour d’une identité définie comme « blanche et chrétienne » à partir d’une histoire tronquée – ce qu’on nomme le « roman national » – excluant et opprimant les minorités ne répondant pas à ces critères.
Hier comme aujourd’hui, les minorités vivant à l’intérieur du territoire et exclues de ce « corps national » subissent la domination raciste. C’est notamment dans ce contexte que se sont développés l’antisémitisme et la rromophobie en Europe, les juifs, les juives et les Rroms étant défini·es comme la figure antinationale, racisée, désignée comme extérieure au « corps national ».
En parallèle, la colonisation de l’Amérique, puis, à partir du XIXe siècle, l’extension de l’impérialisme colonial à l’ensemble du monde non occidental, se sont appuyées sur une définition raciste des peuples non européens. Pour justifier leur asservissement, et l’accaparement des territoires qu’ils habitent et de leurs richesses, les peuples colonisés furent désignés comme inférieurs afin d’autoriser le recours massif à l’esclavage, à la déportation et au travail forcé pour des millions d’individus.
Le racisme visant les descendantes et descendants de peuples colonisés, en France et dans les autres pays ayant participé à la colonisation, est aussi le prolongement de cette histoire. L’islamophobie, entendue comme un racisme touchant les personnes musulmanes ou considérées comme telles, est née également de ces deux dynamiques.
Un rempart pour les classes possédantes
Les périodes de crise économique et de régressions sociales sont propices au renforcement du racisme. Les pouvoirs politiques et la bourgeoisie peuvent alors s’appuyer sur le racisme pour diviser ceux et celles qui auraient intérêt à s’unir pour contrer les effets dévastateurs du capitalisme.
Désigner des boucs-émissaires comme responsables du chômage, de la précarité et de la misère, permet à la bourgeoisie de détourner les classes populaires des revendications d’égalité économique et sociale. Les politiques de fermeture des frontières mises en place par l’État, les lois visant à stigmatiser une partie de la population ou encore les pratiques concrètes des institutions politiques (police, justice, école…) tendent à participer en France à la mise en œuvre d’un racisme d’État.
L’antisémitisme permet quant à lui de protéger la bourgeoisie nationale de la colère populaire en désignant les juifs et juives comme pseudo-classes dominantes, par la mobilisation des stéréotypes racistes autour de la prétendue domination de la « finance juive ». Les politiques antisociales sont ainsi présentées comme le résultat d’un « complot » et non pour ce qu’elles sont : les effets du capitalisme.
Pour l’auto-organisation de la lutte
La lutte contre le racisme est un enjeu essentiel pour l’ensemble de ceux et celles qui luttent pour l’égalité. Elle revêt notamment une importance particulière dans la lutte des classes pour permettre la solidarité entre toutes et tous les exploité·es face à l’État et au patronat. Ainsi, notre solidarité va-t-elle en premier lieu aux mouvements qui, aux luttes antiracistes, associent un projet démocratique d’émancipation sociale en s’appuyant sur l’action des classes populaires.
Les représentations construites par la République coloniale sont maintenues et permettent à la hiérarchie raciste de continuer de s’exercer. Dans les territoires encore occupés par la France, le colonialisme continue d’être un profond vecteur de racisme.
Il nous appartient aussi de lutter contre le racisme au sein de notre organisation avec tous les outils à notre portée.
Le mouvement révolutionnaire doit prendre la mesure des transformations du système de domination raciste, avec une marginalisation progressive du racisme « biologique » au profit d’un racisme « culturel ». C’est ce qui est à l’œuvre avec un antisémitisme contemporain bien réel où les stigmatisations, les violences à l’encontre des personnes considérées comme juives frayent avec le complotisme.
C’est aussi ce qui a permis le succès de la théorie du « choc des civilisations » dont les violences et discriminations islamophobes qui frappent la quasi-totalité des pays occidentaux sont une des principales conséquences. Niant la réalité de cette islamophobie, certaines et certains instrumentalisent la nécessaire critique des religions pour, en réalité, diffuser des discours racistes. Au contraire, nous devons défendre un antiracisme clair, lucide, fondé sur une analyse de la réalité sociale débarrassée des fantasmes et des essentialismes.
Détruire le patriarcat
La lutte pour l’émancipation et l’égalité entre femmes et hommes est un des thèmes essentiels du combat libertaire. Nous nous fixons pour objectif l’abolition du patriarcat en tant que système de domination, l’égalité civile et sociale entre hommes et femmes, et la liberté des femmes de disposer de leur corps, de leur capacité reproductrice et de leur sexualité, dans l’espace privé et domestique comme dans l’espace public.
Nous rejetons toutes les discriminations basées sur le sexe, le genre et l’orientation sexuelle. En effet nous considérons la transphobie, l’homophobie, la biphobie, la lesbophobie et la discrimination des personnes intersexes comme des manifestations du patriarcat. Elles se fondent notamment, sur l’existence de seulement deux catégories de sexe distinctes, entraînant la mutilation des personnes intersexes, et sur l’imposition d’un modèle hétérosexuel dominant. Nous combattons ces oppressions en reconnaissant la jonction et les spécificités des luttes LGBTI.
Le patriarcat est un système politique et économique basé sur la division sexuée du travail qui se traduit par l’exploitation domestique que subissent encore aujourd’hui les femmes du monde entier. Il produit la culture sexiste, solidifiée en un système d’us et coutumes, de lois et de codes sociaux.
Le sexisme, c’est l’ensemble des préjugés qui attribuent des qualités ou des défauts « innés » à chaque genre. Les « qualités naturelles » attribuées par les préjugés sexistes aboutissent à une hiérarchisation entre le groupe des hommes et celui des femmes. Le patriarcat s’appuie sur le genre – qui est une construction sociale – pour justifier l’existence des catégories homme et femme et les inégalités entre elles, les violences faites aux femmes, l’assignation à certains rôles en fonction du genre, et imposer une norme hétérosexuelle et familiale. Son croisement avec d’autres rapports de domination fondés sur la classe sociale, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, les croyances réelles ou supposées, l’âge, la situation administrative, etc. engendre d’autres formes de dominations.
La domination est à la fois idéologique, culturelle, sociale, économique et politique, reléguant les femmes à des rôles subalternes et les dépossédant de la maîtrise de leur vie, de leur corps, et de leur sexualité. Elle est aussi physique par les violences domestiques, le harcèlement, les violences sexuelles qui entravent la vie des femmes à la fois par leur réalité et par la menace constante qu’elles font peser.
Des acquis sans cesse remis en cause
Au fil des décennies, la lutte féministe et antipatriarcale a permis des avancées réelles dans les consciences et dans la vie. Mais aucun acquis n’est jamais définitif ; il nous faut les défendre, et les élargir encore.
Partout où du terrain a été gagné – égalité des droits, égalité professionnelle, avortement et contraception – des mouvements réactionnaires exercent une pression contraire, qui vise à maintenir le système de domination patriarcale.
Une lutte spécifique est nécessaire
La lutte contre le patriarcat est une lutte spécifique qui ne se réduit pas à la lutte contre le capitalisme, bien que l’un et l’autre se nourrissent mutuellement. Le capitalisme tire parti du travail gratuit encore en majorité effectué par les femmes dans la reproduction de la force de travail : enfanter, élever et éduquer les enfants, accomplir le travail domestique et les soins. Il profite du système patriarcal pour surexploiter les femmes dans des métiers largement déconsidérés et sous-payés. Mais le patriarcat ne sert pas que la classe capitaliste. Ainsi, y compris au sein de notre camp social, les hommes bénéficient du travail gratuit des femmes et se voient libérés d’un certain nombre de tâches dont les femmes se chargent spontanément, poussées par les différents mécanismes qui maintiennent et renforcent ce rapport de domination.
Davantage astreintes aux temps partiels imposés, au chômage, à la précarité, elles servent de variable d’ajustement pour le patronat en fonction de ses besoins de main-d’œuvre. Réciproquement, les tâches domestiques assignées aux femmes (soin aux personnes, ménage…) déterminent à leur tour la division sexuée du travail (répartition genrée et hiérarchisée des tâches et des métiers).
Les religions et l’État sont aussi des soutiens actifs du patriarcat en imposant un ordre moral et un modèle familial hétéronormé et hiérarchisé, et en soumettant les femmes et les minorités sexuelles aux violences institutionnelles et policières. Plutôt que la famille patriarcale, nous défendons toutes les formes d’associations familiales et sexuelles sans hiérarchie, basées sur le consentement et qui prennent en compte les droits des enfants, des personnes LGBTI eux aussi victimes de violences et d’oppression.
Des pratiques inclusives et égalitaires
Les organisations révolutionnaires sont composées de personnes membres d’une société à un moment donné, et en cela porteuses de préjugés, de modes de fonctionnement, des conditionnements et d’habitudes inconsciemment acquis par leur éducation, malgré leur volonté de créer une société plus égalitaire. C’est pourquoi il nous appartient de lutter contre le patriarcat aussi au sein de notre organisation avec tous les outils à notre portée :
– travailler à rendre l’organisation accueillante pour les femmes et minorités de genre par ses pratiques ;
– s’organiser de manière non sexiste (dans les répartitions des tâches éviter « les hommes à la politique, les femmes à la logistique ») ;
– favoriser la prise de responsabilités des femmes et minorités de genre au niveau local comme fédéral en formant les hommes à ne pas prendre toute la place ;
– faire face aux violences sexuelles et sexistes par un travail de vigilance et d’insécurisation des agresseurs, qui ne seront pas tolérés au sein de l’UCL, ni dans nos milieux ;
– favoriser les cadres de discussion non mixtes pour libérer la parole ;
– questionner nos propres habitudes et réflexes pour veiller à ce que les tâches ménagères et affectives ne soient pas automatiquement attribuées aux femmes de l’organisation ;
– se doter d’outils favorisant la parole des plus timides et des moins formé·es.
Nous rejetons la conception traditionnelle du militant révolutionnaire dont la disponibilité pour la cause est fondée sur le confinement domestique de sa conjointe. Nous cherchons à développer une forme nouvelle, alternative, de militantisme qui ne reproduise pas à l’intérieur du mouvement d’émancipation, les rapports patriarcaux et les aliénations domestiques.
Combattre toutes les aliénations
Porteuse d’aspirations égalitaires et libertaires qui dépassent la seule lutte des classes, l’émancipation de chaque individu n’est pas, pour nous, une perspective secondaire. Loin de les opposer, nous affirmons que la lutte pour la liberté individuelle ne peut avancer sans le concours des luttes collectives.
Pour justifier, ou simplement masquer la domination et les mécanismes matériels qui la mettent en œuvre, les classes et groupes sociaux dominants entretiennent des idéologies qui, combinées, forment l’idéologie dominante.
Celle-ci, relayée à tous les niveaux de la société, conduit une partie importante du prolétariat, et des groupes sociaux dominés à soutenir un ordre social contraire à leurs intérêts.
Au travail, où l’individu est parcellisé, dominé et réduit au statut de marchandise. Dans la vie quotidienne, où le mode de consommation est déterminé par la logique des profits, les diktats des standards de beauté et des besoins artificiels générés par des techniques marketing. Si le capitalisme soutient, tout en les renouvelant, des aliénations multimillénaires, il est lui-même porteur d’aliénations spécifiques.
Le capitalisme n’a pas engendré toutes les aliénations qui constituent cette idéologie dominante, mais elles servent à cimenter sa domination, et à justifier l’ordre établi en distillant les haines et les divisions dans la population.
Soumettre les religions à une critique radicale
À ce titre, les religions comptent parmi les principaux vecteurs des aliénations : par la vision du monde qu’elles proposent, par les formes hiérarchisées qu’elles se sont données, par leur prétention à enserrer la vie de chacune et de chacun, jusque dans sa plus stricte intimité, dans un réseau de dogmes, de tabous et de règles imposées (droit à l’avortement, sexualité, le mariage comme norme, patriarcat, etc.)
Nous ne combattons pas les croyantes et les croyants, mais les dogmes : nous sommes pour la liberté de culte, respectant le choix de chacune et chacun. Nous dénonçons les persécutions et les interdictions à l’égard des croyantes et croyants. Mais l’UCL est une organisation athée, et nous défendons un projet de société libéré de l’aliénation religieuse.
En effet, nous refusons toute emprise des religions sur la société et nous voulons les soumettre à une critique radicale, parce qu’elles servent à justifier un ordre social inégalitaire. Nous combattons les discours qui entendent mettre à l’abri de la critique des pans entiers de la réalité sociale au nom du « sacré » ou du « divin ».
Contrairement à ce qu’elles prétendent, les religions ne sont pas coupées de la société, elles ont une place dans l’espace politique et peuvent servir d’appui aux idéologies d’extrême droite.
Contre les alibis essentialistes
Nous remettons en cause les normes genrées, sociales, hiérarchiques imposées tout au long de la vie au nom d’une prétendue « nature » ou sous le couvert d’un scientisme qui justifie les inégalités sociales et enferme chaque être dans des données biologiques, une hérédité ou un ADN censés déterminer son avenir et limiter son libre-arbitre.
Pour une éducation émancipatrice
Nous affirmons que le système éducatif prend une part considérable dans l’aliénation de l’individu en reproduisant l’ordre social établi et en le lui faisant accepter dès son plus jeune âge. Il est nécessaire de mettre en place une forme d’éducation émancipatrice pour dépasser collectivement ses aliénations. Pour autant, nous sommes conscient·es que la seule action sur l’éducation ne saurait suffire à la construction de la société à laquelle nous aspirons.
Fidèles à notre courant politique qui, dès son origine, s’est saisi de la problématique éducative, nous défendons des valeurs et des pratiques pédagogiques fondées sur le rationalisme, la coopération, la créativité, le respect de la spécificité de chacune et de chacun pour forger des individus libres et responsables, en capacité de comprendre et d’agir sur le monde qui les entoure. Nous accordons également une place particulière à la conscientisation contre les discriminations racistes, sexistes et sociales parce qu’elle vise à donner un pouvoir d’agir contre elles. Les libertaires prônent une éducation qui vise à développer, sans les hiérarchiser, les capacités physiques, intellectuelles et artistiques. Une éducation accessible tout au long de la vie qui émancipe de la soumission à l’autorité, à la compétition, et permette de réaliser une société solidaire et égalitaire. Pour y parvenir les moyens sont aussi importants que les fins, c’est pourquoi nous faisons nôtres les pratiques des pédagogies antiautoritaires et de l’éducation populaire.
Contre le validisme
La société capitaliste est une société éminemment validiste. Le validisme est une oppression qui touche les personnes en situation de handicap (physique ou psychique, visible ou invisible). Le capitalisme encourage et soutient des structures validistes, dans la mesure où il valide les individus en fonction des capacités qui les rendent productifs ou exploitables dans la sphère du salariat. Les personnes qui ne correspondent pas à ces normes sont proprement invalidées, et ainsi exclues, marginalisées ou minorisées. Le validisme est également cristallisé dans les infrastructures urbaines, qui ne sont, le plus souvent, adaptées qu’à un individu valide type (un individu qui n’est pas en fauteuil, par exemple). Les personnes en situation de handicap seront généralement plus touchées par la précarité et la dépendance, dans la mesure où elles ont plus difficilement accès à la sphère du travail. Dans un système qui fait de la valeur-travail un principe d’intégration et de valorisation, elles sont également déconsidérées, tant symboliquement que socialement.
Ni préjugés, ni entraves
Nous sommes partisans et partisanes d’une lutte globale qui prenne à partie toutes les formes d’aliénation et d’oppression, et qui se donne pour finalité le respect absolu de chacune et de chacun, que toutes et tous puissent vivre, aimer, travailler, créer, s’exprimer librement, sans barrière de couleur de peau, de confession, de sexe, de nationalité, d’âge ou de mode de vie, que toutes et tous puissent trouver une place dans la société humaine, s’y épanouir et disposer de moyens d’existence satisfaisants.
Nous sommes donc pour que s’épaulent la lutte de classe et les diverses luttes contre les aliénations. La destruction de l’ordre capitaliste, de la domination patriarcale et de la domination raciste, la construction de nouveaux rapports sociaux égalitaires et libertaires, apporteront les bases nécessaires – même si elles ne sont pas à elles seules suffisantes – à une ère d’émancipation. Nous ne prônons pourtant pas un individualisme radical, la liberté des uns ne doit pas devenir le prétexte à l’oppression des autres.
Un antifascisme social et populaire
Le fascisme ne se réduit pas aux expériences historiques incarnées par Mussolini et par Hitler. Sous des formes adaptées à notre époque, le fascisme peut continuer à se présenter comme une « solution » politique moderne.
Le fascisme est une idéologie qui prétend hybrider discours social et national. Il est lié à la formation d’une « droite révolutionnaire » qui remet en cause l’idéologie démocratique bourgeoise, le rationalisme des Lumières. Le fascisme se vit donc comme « révolutionnaire », mais sert les intérêts de la bourgeoisie en brisant les luttes populaires, vues comme une menace contre « l’unité nationale ». Il met en avant la nation présentée comme un organisme qu’il faudrait purifier des ennemis intérieurs que sont à ses yeux les minorités, les étrangères et les étrangers, mais aussi les éléments subversifs, induisant une vision raciste, mais aussi misogyne et LGBTIphobe. C’est enfin un discours assignant une identité à un territoire.
Faussement anticapitaliste, cette idéologie défend l’ordre économique, la propriété privée des moyens de production et la recherche du profit. Elle oppose le capitalisme industriel, national, considéré comme « authentique », au capitalisme financier, arbitrairement séparé, et amalgamé aux juifs et juives par le discours antisémite. Celui-ci sert à protéger la bourgeoisie. Il accepte en effet volontiers le rôle des banques, dès lors qu’elles le financent.
Le fascisme veut mobiliser les masses
Dans la pratique du pouvoir, le fascisme est un mode de gouvernement qui pratique le terrorisme d’État associé à une stratégie de terreur menée par des bandes armées dont l’impunité est assurée. Il cherche à mobiliser massivement la population dans la rue pour imposer ses vues, faire éclater les verrous législatifs et constitutionnels susceptibles de l’entraver, et museler ses adversaires – le mouvement ouvrier, féministe, les minorités et les organisations progressistes ou démocratiques.
S’il possède une dynamique autonome comme mouvement et idéologie, le fascisme joue un rôle de dernier recours pour maintenir les privilèges de la minorité possédante. C’est pour cette raison que la majorité de la bourgeoisie a toujours soutenu le fascisme contre le mouvement ouvrier en période de crise, selon la formule « Plutôt Hitler que le Front populaire ».
Forts de ce constat, nous affirmons que la lutte contre le fascisme est une nécessité absolue. Loin d’être un aspect secondaire de la lutte des classes, cette lutte est une question de survie pour les dynamiques d’émancipation en période de crise.
Une stratégie reposant sur les mouvements sociaux
Nous privilégions de façon générale les mouvements sociaux comme instruments de changement et d’action sur la réalité. En matière d’antifascisme, ils peuvent avoir un rôle essentiel d’endiguement et d’alternative.
Une grève, une mobilisation féministe, une lutte pour le logement, la défense des services publics et des transports en commun ne sont pas nécessairement antifascistes. Mais, de façon implicite, en poursuivant des objectifs d’émancipation collective, elles font obstacle à l’extrême droite. D’abord parce qu’elles occupent le terrain social, et désignent actionnaires, propriétaires, bailleurs et patrons comme les classes dominantes réelles. Ensuite parce qu’elles dispensent d’autres valeurs : la solidarité de classe plutôt que la solidarité nationale ; l’entraide plutôt que la rancœur et la haine ; le désir d’émancipation individuelle et collective plutôt que l’attachement à l’ordre traditionnel ; la responsabilité collective plutôt que le culte du chef…
Il est fondamental de garantir le caractère antiraciste de ces luttes, leur ouverture à chacune et à chacun quelle que soit son origine, sous peine de voir les fascistes chercher à y prendre pied pour les orienter dans un sens nationaliste. Cependant, si les luttes sociales créent un climat politique propice, elles ne suffisent pas, en soi, à enrayer le fascisme.
Un combat spécifique contre l’extrême droite
Il y a un combat antifasciste spécifique à mener : idéologique, politique, militant. Il faut refuser la banalisation des thèses réactionnaires, contre-argumenter, démasquer les faussaires. Il faut organiser l’autodéfense de nos espaces, de nos luttes, de nos quartiers, face aux agressions fascistes.
Nous sommes partisanes et partisans de l’unité la plus large, mais sur des bases claires, à la fois humanistes et de classe. Un antifascisme social et populaire doit dépasser les professions de foi républicaines d’une part, et d’autre part l’activisme affinitaire et contre-culturel.
Pour notre part, nous optons pour un antifascisme qui ne se limite pas à s’opposer à l’extrême droite « officielle », mais qui lutte contre toutes les politiques – policières, liberticides et racistes – qui lui ouvrent la voie.
Contre tous les impérialismes
La division de l’espace terrestre en États-nations est une construction liée au développement historique du capitalisme et des États. C’est sur le socle idéologique de « la nation » que se forge la domination politique de l’État et des classes dirigeantes dont il est l’instrument.
L’idéologie nationale repose sur la négation en dernière instance de toutes les différences, de tous les antagonismes sur un territoire donné : négation de la pluralité des cultures et des langues, négation de la lutte des classes, négation des rapports de domination et d’oppression.
Nous refusons donc les logiques politiques nationalistes qui construisent en réalité un mythe fondé sur la pureté et « l’autarcie culturelle » afin d’opposer les exploité·es entre elles et eux, et de justifier leur soumission.
Le fédéralisme libertaire nous paraît permettre la coexistence de multiples cultures et leur brassage, sans qu’une seule soit imposée aux individus par un pouvoir politique.
L’essor du capitalisme, aux XIXe et XXe siècles, n’a pu se faire sans le pillage systématique des ressources des pays du Sud. Les conséquences en sont désastreuses : guerres et massacres, destructions des équilibres écologiques, des cultures vivrières, des productions locales, au profit des secteurs d’exportation des richesses vers les empires coloniaux. Les économies locales s’en sont retrouvées incomplètes, dépendantes, incapables de répondre aux besoins des populations ce qui entraîne la montée des inégalités, la misère, la faim, l’exil.
Notre anticolonialisme
Nous nous opposons à l’impérialisme colonial et néocolonial qui légitime les discours racistes, les opérations militaires, le pillage organisé des ressources naturelles par l’alliance entre les bourgeoisies occidentales et leurs relais à la tête des États des « anciennes » colonies.
Les luttes indépendantistes du XXe siècle ont mené à un redéploiement de l’impérialisme. L’indépendance, formelle, s’est traduite par le passage d’un mode de domination direct à un mode de domination indirect, fondé sur le soutien à des classes dirigeantes désormais nationales, mais exerçant leur pouvoir dans l’intérêt de l’ancienne puissance coloniale. Dans nombre d’anciennes colonies, celle-ci conserve une présence militaire et économique dominante, et veille à ce que les gouvernements au pouvoir soient compatibles avec ses intérêts. Ces rapports de domination se sont ensuite accentués avec la mondialisation capitaliste, par le biais de l’endettement, des mécanismes de contrôle monétaire et de rapports commerciaux iniques.
La fin de la Guerre froide et le début du XXIe siècle ont vu de nouvelles puissances émerger, à l’échelle régionale, continentale voire mondiale. Elles entrent en concurrence avec les anciennes puissances impérialistes, leur contestent leur monopole de prédation économique néocoloniale et leur influence politique sur les classes dirigeantes locales. Si ces dernières peuvent parfois profiter de cette situation pour faire fructifier leurs intérêts privés, il ne s’agit, pour les populations des anciennes colonies, que de la perpétuation d’une domination extérieure. Un nouvel impérialisme vient remplacer ou se superposer à un autre, la concurrence entre les deux pouvant même dégénérer en conflit par procuration dont les populations locales sont toujours les victimes.
Adversaires résolu·es de l’impérialisme français, nous revendiquons la levée de la tutelle de l’État français sur les départements d’outre-mer, l’éradication des réseaux de la Françafrique et la fin de l’interventionnisme militaire extérieur.
Le soutien que nous apportons aux luttes des peuples contre l’impérialisme est en même temps lucide et critique. Historiquement, les luttes anticolonialistes, toujours légitimes dans leur refus de la domination, et en ceci a priori toujours à soutenir, ont souvent accouché de régimes bureaucratiques militarisés, voire impliqués dans des formes de néocolonialisme. Aussi notre solidarité va-t-elle aux forces qui, à leur lutte contre la domination coloniale, associent un projet d’émancipation sociale, démocratique, voire anticapitaliste et fédéraliste, en s’appuyant sur le prolétariat et sur la paysannerie.
Ce faisant, nous nous plaçons résolument du côté des peuples, contre tous les impérialismes, qu’ils soient mondiaux ou régionaux. Nous récusons la grille de lecture « campiste » qui consiste à soutenir ou à mépriser les luttes populaires en fonction du camp impérialiste qu’elles gênent.
Une solidarité de classe sans frontières
Le capitalisme s’est construit à l’échelle mondiale. Une stratégie de classe serait donc impensable si elle se limitait à un seul pays. Les enjeux sont internationaux, et les mouvements sociaux ont là un retard important à combler. Un combat pour une orientation internationaliste est nécessaire, qui devra passer sur le corps de bien des résistances « souverainistes » et localistes.
Nous sommes résolument favorables à la liberté de circulation et d’installation. Les États les plus puissants orchestrent la liberté de circulation des capitaux et des marchandises, tout en érigeant des frontières et des murs entre les exploité·es. Ces frontières n’empêchent pas les migrations : elles tuent des milliers de migrantes et de migrants. Elles permettent en revanche de créer, dans les pays du Nord, une catégorie de travailleuses et travailleurs illégaux et privé·es de droits. Nous militons à la fois pour leur régularisation, et pour l’abolition du pillage commercial qui ruine leurs pays et les jette sur les routes de l’exil. Il n’y a pas de lutte possible contre les inégalités Nord-Sud sans lutte pour la liberté de circulation et d’installation.
Nous préconisons la solidarité internationale entre les travailleurs et travailleuses de tous les pays, entre les peuples, solidarités féministes et LGBTI, écologistes, contre les États et tous les impérialismes. L’unité internationale reste à construire, notamment au travers d’actions concrètes coordonnées pour affronter des pouvoirs depuis longtemps multinationaux.
Une stratégie fondée sur les luttes sociales et l’auto-organisation
Seules les luttes directes menées à la base peuvent imposer de véritables transformations contraires aux intérêts capitalistes. Nous opposons une stratégie de luttes sociales motrices des changements à la stratégie social-démocrate de transformations opérées depuis les institutions étatiques par les partis politiques.
Les acteurs et actrices, les décideurs et décideuses de ces transformations ne sont donc pas les dirigeants politiques ou les minorités militantes, mais les travailleurs et travailleuses, les étudiant·es et lycéen·nes, la population, s’inscrivant dans des mouvements de masse, sans élitisme.
L’autogestion des luttes, le pouvoir aux assemblées générales, leur coordination démocratique, sont la condition nécessaire pour que toutes et tous puissent remplir ce rôle de décideur collectif. De multiples expériences ont démontré la validité de la démocratie directe par l’autogestion.
Une animation autogestionnaire des luttes
Les militantes et les militants peuvent apporter une aide décisive au déclenchement et à la conduite des luttes de masse. Nous promouvons une conception autogestionnaire du rôle d’animateur et d’animatrice des luttes. Placée souvent en situation active – organisateurs et organisatrices, porte-parole, coordonnateurs et coordonnatrices, mandaté·es –, l’intervention autogestionnaire est nécessairement contradictoire puisqu’elle tend, en même temps, à l’autodirection des mouvements par ceux et celles qui luttent, à la prise de parole par tous et toutes, et à la responsabilisation collective. Cette dialectique vivante est nécessaire. Elle peut permettre d’éviter deux écueils : celui du dirigisme et celui du spontanéisme.
L’autonomie ouvrière, et plus largement celle de tous les mouvements sociaux, est nécessaire à cette affirmation de la base sociale comme sujet maîtrisant ses luttes. Autonomie par rapport aux institutions étatiques et aux pouvoirs patronaux. Autonomie par rapport à toute forme de direction extérieure. Mais aussi autonomie créatrice : dans les luttes d’aujourd’hui, nous préparons la société de demain !
Les luttes sociales ne se limitent pas à celles que les travailleurs et travailleuses mènent dans les entreprises. La remise en question globale du système passe aussi par d’autres mobilisations de masse autogérées : celles sur nos lieux d’étude, des chômeurs, chômeuses et précaires, les luttes sur l’habitat, le cadre de vie, le combat écologiste, les droits des femmes, les luttes contre le racisme…
Contre les tentations avant-gardistes
Dans une telle conception des luttes sociales, nous donnons la priorité, non pas à la radicalité idéologique, mais à la possibilité de mobiliser, de faire agir, débattre collectivement des franges importantes des classes dominées.
Une révolution autogestionnaire ne pourra se construire sans l’affirmation d’une volonté massive de la société pour celle-ci. L’impact de nos luttes d’aujourd’hui sur la conscience collective dépendra bien évidemment de nos capacités à développer des pratiques autogestionnaires et alternatives à un niveau de masse.
Dans cette optique, nous combattrons toutes les tentations avant-gardistes, les minorités s’autoproclamant représentantes de la base et méprisant ou instrumentalisant les cadres collectifs. Il s’agit dans un premier temps de construire des mouvements massifs, tout en y avançant des propositions visant à dépasser leurs limites propres (isolement, corporatisme…) et en y soutenant des orientations autogestionnaires.
Cela ne signifie pas la condamnation de toute action minoritaire, mais cela signifie que toute action minoritaire doit s’inscrire dans une perspective d’élargissement à un niveau de masse.
La prise de conscience par l’expérience
Le système capitaliste a une immense capacité à récupérer, puis à remettre en cause ultérieurement tout ce que les rapports de force peuvent lui imposer. Malgré cela, nous affirmons que les luttes revendicatives – dont les objectifs ne sont pas, par définition, révolutionnaires – peuvent entraîner la mobilisation massive des exploité·es et permettre des prises de conscience et des expérimentations concrètes d’auto-organisation porteuses de ruptures anticapitalistes.
De même des réalisations alternatives, des coopératives et des activités associatives autogérées peuvent être porteuses d’une remise en question globale de la société, si elles savent rester en lien avec les travailleurs et les travailleuses, la population, la lutte de classe.
Notre stratégie inclus des revendications à court et long terme, notre objectif est d’améliorer les conditions matérielles d’existence de toutes et tous en visant l’avènement du communisme libertaire.
Notre pratique syndicaliste révolutionnaire
Le mouvement syndical est né de la volonté d’organisation des travailleuses et des travailleurs en révolte contre l’oppression et l’exploitation. Il permet d’opposer au patronat, qui compte sur l’isolement individuel des prolétaires, la force collective qu’apporte l’action concertée.
La lutte revendicative dans les lieux de travail et d’études passe principalement par l’action syndicale. Nous préconisons donc la participation active au syndicalisme, compris d’abord comme une pratique de lutte et d’auto-organisation unitaire, de masse et de classe.
Comme dans toute forme d’association, cette force collective bénéficie aux individus associés et plus largement à notre classe, à condition qu’elle ne soit pas appropriée par une minorité au détriment de la collectivité. C’est le cas quand il existe une distinction entre dirigeant·es et dirigé·es, qui aboutit à ce que les dirigeantes et dirigeants utilisent l’organisation pour faire valoir leurs intérêts plutôt que pour servir la cause commune. Le syndicalisme n’est pas une carrière !
Nous sommes également conscientes et conscients que le mouvement syndical est – comme beaucoup de choses dans une période non révolutionnaire – traversé par une contradiction entre intégration et rupture. Et que l’intégration génère une tendance lourde aux compromis sociaux et à la bureaucratie.
Nous ne pouvons cependant nous satisfaire du rejet des syndicats par une partie du prolétariat. Il conduit davantage à démobiliser les salarié·es qu’à accentuer le rapport de force face à l’État et au patronat. C’est par une pratique syndicale autogestionnaire et de lutte de classe que les syndicats redeviendront un outil attrayant pour les luttes sociales.
Un répertoire d’actions directes
Nous défendons un syndicalisme révolutionnaire qui revienne aux sources de la dynamique d’auto-organisation du prolétariat que représente le mouvement syndical, en intégrant les acquis historiques des luttes émancipatrices menées depuis son origine.
Nous promouvons donc tout le répertoire d’actions du syndicalisme révolutionnaire – grève, boycott, sabotage ouvrier, blocage – y compris leurs formes nouvelles et réinventées, dès lors qu’elles reposent sur l’action directe des travailleuses et des travailleurs.
Nous défendons la perspective de la grève générale, en tant qu’arme du prolétariat pour défendre ses intérêts, et possible levier d’une reprise en main révolutionnaire de la production. Cela ne signifie pas qu’il faut multiplier, hors contexte, les appels incantatoires à une grève générale mythifiée, mais qu’il faut la poser comme une visée stratégique, structurant notre action.
Cela implique de participer aux débats syndicaux et de faire vivre – et même parfois tout simplement exister – la démocratie syndicale.
Pour l’unité ouvrière, malgré les divisions
Nous préconisons l’indépendance des syndicats contre tout groupement extérieur visant à les instrumentaliser, la démocratie interne et le fédéralisme, le partage, le contrôle et la révocabilité des mandats. Nous voulons renouer avec une pratique interprofessionnelle à travers le développement d’outils permettant l’émergence d’une solidarité et d’une conscience de classe : unions locales, union départementales, syndicats et fédérations d’industrie, confédérations.
La division syndicale est le résultat de plusieurs facteurs : bureaucratisation, remise en cause de l’indépendance syndicale, pratiques antidémocratiques, auxquelles se sont ajoutés depuis, concurrence et esprit de chapelle. À l’opposé de cette logique, par-delà les « patriotismes d’organisation », nous affirmons la nécessaire unité ouvrière et entendons œuvrer à créer les conditions d’une réunification du mouvement syndical de classe et de lutte, sans en nier les difficultés.
Nous soutenons les autres formes d’organisation que peuvent se donner les travailleurs et travailleuses en lutte (assemblée générale, comité de grève, coordination…), notamment lorsqu’elles peuvent compléter, voire pallier les limites actuelles des organisations syndicales.
Nous défendons la solidarité internationale dans le champ syndical. Nous soutenons enfin une pratique syndicale qui intègre la diversité du prolétariat : travailleuses et travailleurs du public et du privé, avec ou sans emploi, actifs et actives ou retraité·es, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur genre, leur orientation sexuelle.
Porter une démocratie de base
Nous pouvons être conduit·es par la réalité du terrain à inscrire notre syndicalisme révolutionnaire dans des organisations différentes. L’essentiel est, pour nous, la possibilité réelle, offerte par telle ou telle structure, de développer des collectifs militants et de déployer une activité revendicative. Notre syndicalisme se pense donc en termes de terrain, s’inscrit d’abord dans les structures de base, mais refuse de considérer la fragmentation du mouvement syndical comme positive ou inévitable.
C’est au service de cette activité des collectifs de base, et dans le respect scrupuleux de la démocratie syndicale, que des camarades peuvent être mandaté·es, à tous postes et à tous niveaux, par les adhérentes et les adhérents de leurs structures.
Syndicalistes révolutionnaires, nous refusons la division du travail social-démocrate entre parti qui s’occupe de la politique, c’est-à-dire aussi des questions de société, et syndicat cantonné aux revendications immédiates. Pour nous, l’organisation syndicale doit être porteuse de sa propre stratégie de transformation de la société, élaborée en toute indépendance. Elle est un espace essentiel à la construction d’un contre-pouvoir. Elle doit permettre d’aiguiser les capacités autogestionnaires de notre classe.
S’il paraît évident que le fait syndical, comme tous les faits de société importants, soit discuté partout, y compris dans les courants politiques, nous réfutons la pratique de « fraction » qui conduit ses membres, quelle que soit leur opinion, à agir de façon concertée pour répercuter les directives de leur organisation politique dans le syndicat, au mépris de l’indépendance et de la capacité d’élaboration propre de ce dernier.
Des valeurs pour un monde nouveau
Le communisme libertaire vise à articuler le plus harmonieusement possible notre besoin d’appartenir à un collectif et nos aspirations à être reconnu·es et respecté·es dans notre singularité. Ce que nous visons, c’est une société où le chacun pour soi est remplacé par la coopération et l’entraide. Une société où il n’y a plus celles et ceux qui possèdent, et celles et ceux qui n’ont rien ou pas grand-chose. Une société où il n’y a plus ni riches, ni pauvres. Une société où les ordres des minorités dirigeantes sont balayés par les choix collectifs, libres et assumés. Une société où s’équilibrent et s’épaulent mutuellement l’individu, le local, le particulier et le collectif, le social, le culturel : une société égalitaire et libertaire.
L’égalité et la liberté ne peuvent être effectives que dans une démocratie réelle qui empêche la reconstitution d’un nouveau pouvoir et de nouvelles oppressions, qui permette à chacune et chacun de faire valoir ses choix et ses aspirations. Le communisme libertaire, c’est la démocratie horizontale et directe ; le peuple souverain auto-institue la société, autogouverne sa politique, autogère sa production et plus globalement détermine ses besoins collectifs et les façons d’y répondre.
L’autogestion de la production, libérée des impératifs du productivisme et de la course au profit, peut enfin mettre au service des individus la recherche et les avancées techniques. Respectueuse de l’environnement, elle ouvre la voie à un rapport nouveau réintégrant la communauté des humains dans l’équilibre des écosystèmes.
Parce qu’il satisfait les besoins collectifs et qu’il est débarrassé du rapport d’exploitation, le travail peut prendre du sens, perdre son caractère aliénant, permettre à chacune et chacun d’accéder à la maîtrise de ses activités.
Émancipations individuelle et collective sont indissociables
La satisfaction égalitaire des besoins exprimés dans une société fondée sur l’émancipation des individus et des communautés de base ne signifie ni nivellement, ni uniformisation, et respecte la multiplicité des modes de vie, des goûts, des aspirations.
Le communisme libertaire, c’est le combat pour une société où les individus sont libres, égaux et responsables. Libres dans un monde où pèsent les nécessités matérielles, et dans une société où l’on participe aux tâches communes et aux responsabilités collectives. Libres de s’exprimer, de créer ; libres de leurs modes de vie, de leurs sexualités, de leurs cultures. Responsables, maîtres de leur travail, participant au côté de toutes et tous à l’autogestion de la production et de la société. Égaux à toutes et à tous, donc accédant à égalité avec toutes et tous à la répartition des produits du travail.
Pour favoriser cette responsabilisation, une société autogérée doit rendre effectif l’accès à l’éducation, l’information et la culture sur des bases émancipatrices.
Le communisme libertaire, c’est la fin d’un certain ordre du monde. La fin du colonialisme et de l’impérialisme, au profit d’un rapport égalitaire et solidaire entre tous les peuples, fondé sur l’autonomie productive de chaque région, et le partage des richesses entre zones riches et zones pauvres. La fin de l’ordre étatique, au profit d’une fédération libre des régions autogérées. La fin des frontières et de la menace de guerre, pour un monde sans barrières et totalement démilitarisé.
Défendre une éthique
L’avènement d’une société libertaire ne signifierait pas la fin de l’histoire et l’instauration d’un « paradis terrestre » ; des rapports de domination pourraient subsister ou ressurgir. Il demeurera important de mettre en avant des valeurs, de continuer à interroger des fonctionnements, des pratiques, et probablement de mener des luttes.
L’ensemble de ces valeurs implique une cohérence entre les moyens et les fins sans laquelle il n’y a aucun espoir de vivre le communisme libertaire. C’est pourquoi, sans attendre un basculement révolutionnaire, nous tentons d’en faire vivre les finalités ici et maintenant, dans nos actions et nos engagements, dans nos espaces de vie et de lutte.
Porter un projet de société alternatif
Nous sommes révolutionnaires, c’est-à-dire partisan·es d’une transformation radicale de la société. Notre action politique vise à mettre en adéquation notre projet de société et les moyens pour y parvenir : le bilan de la social-démocratie a démontré qu’on ne peut pas lutter efficacement contre le capitalisme en conquérant le pouvoir par la voie électorale et en le réformant progressivement.
Cela ne signifie pas non plus attendre passivement une rupture « inéluctable » : l’avenir n’est écrit nulle part, il sera ce que nous en ferons, et à chaque situation historique le champ des possibles est largement ouvert. Il n’y a aucune raison pour que l’Histoire ait atteint son stade ultime : le capitalisme ne sera pas la dernière forme de la société humaine. Les systèmes de domination raciste et patriarcale ne sont pas une fatalité.
Mais un socialisme autogestionnaire et des rapports sociaux égalitaires ne surgiront pas mécaniquement au terme d’une « crise finale » à une seule issue possible. Ils naîtront de l’action consciente et déterminée des masses exploitées. Matérialistes, et instruit·es par l’expérience historique, nous savons qu’un véritable mouvement populaire n’est jamais « pur ». Il peut être peuplé de forces contradictoires, progressistes comme rétrogrades, dont chacune essaie de faire prévaloir son projet politique. Les révolutionnaires ne peuvent se satisfaire de distribuer bons et mauvais points de façon extérieure. C’est dans les luttes qu’ils et elles peuvent espérer influer sur les événements.
Contre l’action armée isolée
Révolutionnaires, nous ne sommes pas partisan·es a priori d’une solution violente. L’essentiel dans un processus de transformation est dans l’œuvre constructive, qui nécessite une autodéfense de la population pour préserver les acquis. Mais le degré de violence d’une révolution est d’abord choisi et imposé par les classes dirigeantes renversées. Cette violence peut donc être nécessaire. Il faut alors faire preuve de vigilance, pour se garder des excès et du danger de militarisation.
Excepté dans les situations de dictature ou d’occupation militaire ou coloniale, nous sommes opposé·es à l’action minoritaire armée menée par des groupes coupés de la population et du mouvement social. L’action armée, menée dans ces conditions, conduit au face-à-face dangereux avec l’État ; elle aboutit au renforcement de ce dernier et à l’isolement de celles et ceux qui la pratiquent.
Nous ne confondons évidemment pas l’action minoritaire armée avec les formes dures prises par les luttes des travailleurs et travailleuses et de la population pour la défense de leurs acquis et de leurs combats. La légitimité de l’action des révolutionnaires ne se fixe pas en termes de respect d’une légalité imposée par l’État mais évolue en fonction de la conscience des masses.
Imaginer pour transformer la réalité
Un projet révolutionnaire est nécessaire, alternatif aux socialismes d’État et au libéralisme. Un projet qui a vocation à mettre en œuvre un communisme libertaire à l’échelle de toute la société, sur le plan économique (socialisation des moyens de production et des produits du travail collectif), politique (fédéralisme libertaire comme alternative à toute centralisation du pouvoir politique) et social (égalité sociale entre individus sans considération de sexe, d’orientation sexuelle, d’origine, de capacités physiques ou psychologiques…). L’élaboration d’un projet révolutionnaire s’appuie sur les expériences historiques et contemporaines des luttes, en tenant compte des difficultés rencontrées. Le projet révolutionnaire nécessite donc une réévaluation régulière, intégrant les nouvelles luttes sociales et les évolutions de la société.
L’utopie peut avoir une incidence décisive sur les mouvements sociaux. En stimulant l’imagination collective, elle alimente les luttes immédiates, tant dans leurs formes que dans leurs objectifs, et elle peut donner force et crédit à nos luttes en explorant les possibilités d’une société alternative. L’imaginaire est nécessaire pour transformer les réalités.
S’il nous semble nécessaire que notre courant porte un tel projet, celui-ci n’a pas la prétention de prédire l’avenir, ni de tout prévoir, ni d’être un ensemble de promesses, ni d’être le plan tout prêt d’un socialisme à construire tel quel.
C’est à travers leurs expériences que les travailleuses et les travailleurs trouveront leurs réponses à nombre de questions de société. Mais dans cette élaboration, nos propositions peuvent avoir valeur de contributions et d’incitation, infléchissant le débat d’idées et les pratiques dans le sens le plus libertaire, le plus autogestionnaire possible.
Contre-pouvoir, double pouvoir et rupture révolutionnaire
La révolution libertaire n’est pas la substitution d’une équipe dirigeante à une autre : c’est une révolution globale des formes économiques, sociales, politiques et culturelles de la société.
La révolution n’est due ni uniquement à une maturation idéologique, ni uniquement à des conditions économiques « objectives ». Elle peut survenir au terme d’une dynamique fondée sur des pratiques sociales, les pratiques réelles des masses et des individus, leurs luttes, qui se déploient dans les conditions matérielles de chaque époque, et qui permettent une prise de conscience collective et l’émergence d’un projet de société partagé de plus en plus largement.
En période non révolutionnaire : construire des contre-pouvoirs
La prise de conscience révolutionnaire s’appuie généralement sur une expérimentation concrète à travers la lutte de classe, les luttes émancipatrices et leur auto-organisation. Syndicats de lutte, comités de privé·es d’emploi, comités de mal-logé·es, organisations féministes, collectifs antiracistes, comités dénonçant les violences policières… Tous participent d’une logique de contre-pouvoir face au capitalisme et à l’État.
Ces contre-pouvoirs sont potentiellement les embryons d’une alternative politique et sociale, mais potentiellement seulement. Ils peuvent le devenir s’ils adoptent des pratiques autogestionnaires et des perspectives anticapitalistes, antipatriarcales, antiracistes, écologistes, révolutionnaires… Le courant communiste libertaire doit y contribuer activement, et veiller à s’opposer aux discours et aux pratiques dirigistes, car la liberté n’est pas pour nous une fin lointaine autorisant le recours à n’importe quel moyen, mais elle est le but et le moyen.
Par ailleurs, renforcer le pouvoir populaire, c’est aussi renforcer notre autonomie face aux capitalistes et à l’État. Ainsi, il est utile de participer aux initiatives permettant de se réapproprier la production, la distribution, l’éducation, etc., en y apportant notre analyse et nos combats anticapitalistes et en y impulsant des pratiques autogérées et émancipatrices.
Durant une période pré-révolutionnaire : pousser au double pouvoir
Une période pré-révolutionnaire s’ouvre lorsque l’État est débordé par la montée de la lutte des classes au point qu’il commence à se déliter, et que son autorité est mise en question. Si certains lieux de production sont repris en main par les travailleuses et travailleurs, le patronat lui-même voit sa raison d’être directement menacée.
Les contre-pouvoirs actifs en amont peuvent alors former l’armature d’un maillage d’organes démocratiques – qu’ils se nomment fédérations locales, fédérations d’industries, communes, conseils, comités de quartier ou d’usine, assemblées populaires – qui commencent à reprendre en main les activités économiques et sociales. La fédération progressive de cet ensemble dessine les contours d’un pouvoir populaire concurrençant le pouvoir d’État.
Par « pouvoir populaire », nous entendons non pas un « État ouvrier » selon la conception léniniste, mais bien une dynamique de démocratie directe, fédéraliste, contrôlée par la base.
Durant ce processus – où le pouvoir capitaliste est ouvertement défié –, le courant communiste libertaire ne cherche pas à former un « état-major » aspirant à s’emparer du pouvoir d’État. Il pousse au contraire à ce que le pouvoir populaire prenne conscience de lui-même, se consolide, s’étende, et envisage de remplacer le pouvoir d’État.
Le courant communiste libertaire doit contribuer à orienter le processus révolutionnaire vers une solution autogestionnaire, évitant les pièges de la bureaucratisation, sans s’en remettre complètement à la spontanéité. Celle-ci a déjà montré, dans l’histoire, son extraordinaire puissance créatrice, mais aussi son instabilité.
L’inventivité du prolétariat
Notre conception du socialisme n’est pas le fruit d’une élaboration extérieure aux luttes du prolétariat. Nous affirmons au contraire que ce sont les travailleuses et les travailleurs elles et eux-mêmes qui ont inventé et réinventé les bases d’une société alternative au capitalisme, à travers leurs luttes et notamment dans les périodes révolutionnaires.
De tout temps et à l’époque contemporaine, les peuples ont cherché des voies vers l’égalité sociale et politique. Partout dans le monde, au cours de la Commune de Paris en 1871, au Mexique entre 1910 et 1917, en Russie et en Ukraine de 1917 à 1921, avec la commune coréenne de Shinmin (1929-1931), en Espagne de 1936 à 1937, se sont développées les bases d’un autre socialisme possible, finalement écrasé par la bourgeoisie et/ou le fascisme, ou trahi par la constitution d’une nouvelle classe dirigeante. Les expériences révolutionnaires au Chiapas à partir de 1994 et au Rojava à partir de 2012 constituent d’autres de ces exemples.
Ne pas réitérer les erreurs du passé
Chaque expérience révolutionnaire, chaque temps fort de la lutte des classes est venu confirmer cette aspiration à une société et à une reprise en main par la base, depuis les entreprises collectivisées et autogérées jusqu’aux communes libres.
Notre socialisme libertaire est donc l’héritier des tendances antiautoritaires développées depuis la Première Internationale par une partie des mouvements ouvriers, paysans et sociaux. Force est de constater que ce sont d’autres courants qui se sont imposés pendant des décennies : des socialismes d’État – social-démocratie, léninisme, stalinisme, maoïsme, trotskisme –, qui se sont opposés aux aspirations populaires d’autogestion et de démocratie directe et qui ont conduit les mouvements populaires dans l’impasse.
Le communisme libertaire, élaboré de façon autonome par les travailleurs et les travailleuses, a ouvert une perspective extraordinaire pour l’humanité, en esquissant à travers des réalisations concrètes une forme supérieure de démocratie.
Mais les expériences historiques ont également révélé des limites et des faiblesses dont il faut tenir compte. C’est pour cette raison qu’un projet cohérent porté par une organisation militante est aujourd’hui nécessaire pour poser les problèmes auxquels se heurte et se heurtera le communisme libertaire.
Si l’existence d’un tel projet n’est pas une garantie infaillible, elle peut néanmoins aider les masses en lutte à éviter les erreurs du passé pour atteindre l’émancipation intégrale.
Contre les socialismes d’État
Le bilan des socialismes d’État, sous leurs diverses formes, est globalement négatif. Historiquement, le socialisme d’État a servi d’arme contre le socialisme élaboré par les travailleuses et travailleurs : gestion des crises par la social-démocratie, édification d’un capitalisme « patriote » par le nationalisme de gauche et d’un capitalisme bureaucratique d’État par le léninisme, puis le stalinisme et le maoïsme.
Si ces régimes ont pu, durant une période, orchestrer des réformes sociales, ils l’ont fait sans jamais rompre avec les rapports de production capitalistes, ni avec les hiérarchies dirigeant·es-dirigé·es.
Ils l’ont fait en réprimant ou en domestiquant les mouvements sociaux indépendants, n’hésitant pas, dans certaines périodes, à endosser un rôle ouvertement contre-révolutionnaire (Allemagne 1918-1919, Russie 1918-1921, Espagne 1937-1939, Hongrie 1956, Algérie 1965, Tchécoslovaquie 1968, Pologne 1980…).
Ce faisant, ils ont étouffé les capacités politiques du prolétariat et facilité, par la suite, le retour de la bourgeoisie traditionnelle au pouvoir.
La social-démocratie
La social-démocratie repose sur l’illusion d’un État « neutre » au-dessus des classes, et donc retournable en faveur des intérêts des exploité·es.
Il y a là un double leurre : d’une part la promesse de diriger l’État contre les intérêts capitalistes ; d’autre part la promesse d’une transformation progressive de la société, pacifique et légale, réformiste, par lois et décrets, du capitalisme au socialisme.
Il s’ensuit une stratégie politique inscrite dans les institutions du capitalisme, respectueuse de celles-ci. La social-démocratie – dans ses variantes socialiste, travailliste ou écologiste – est avant tout un socialisme étatiste, reposant sur la délégation de pouvoir, profitant aux politiciens et aux classes dirigeantes, bureaucratiques.
Au cours du XXe siècle, l’accession au pouvoir de la social-démocratie a pu correspondre à certaines avancées sociales. Mais ces conquêtes sont bien le fruit des luttes menées à la base. Le rôle joué par la social-démocratie, agent des classes dominantes, est alors de mettre fin à ces luttes en satisfaisant certaines de leurs revendications avant qu’elles ne s’étendent trop et ne remettent en cause les fondements du système capitaliste. Quand il n’y a pas de luttes, la social-démocratie au pouvoir n’obtient aucune concession et participe même à détruire ce qui avait été conquis.
Le bilan de la social-démocratie est désastreux pour le prolétariat. Instauration de « paix sociale » où les travailleuses et travailleurs perdent leurs capacités de résistance, soumission des organisations syndicales et du mouvement social au calendrier électoral ou à celui de la politique gouvernementale lorsque la gauche est au pouvoir.
Au final, prise au piège de la gestion du capitalisme, la social-démocratie a toujours fini par en adopter les codes et l’idéologie.
Les nationalismes de gauche
Des gouvernements prétendent parfois s’opposer au capitalisme au nom de la « patrie ». Le nassérisme en Égypte, le péronisme en Argentine ou le chavisme au Venezuela ont ainsi pu se revendiquer d’une forme de socialisme en nationalisant des secteurs-clés de l’économie et en améliorant la situation des classes pauvres.
Cependant, l’ambition réelle des nationalistes de gauche est de façonner un capitalisme national, associé à un État fort dirigé par un leader charismatique, main dans la main avec un patronat patriote, et en mettant les mouvements sociaux sous tutelle.
Historiquement, les régimes nationalistes de gauche ont engendré une classe bureaucratique et une classe possédante qui, loin d’œuvrer dans l’intérêt de « la patrie », ont toujours fini par servir leurs propres intérêts, au détriment de peuples réduits à la célébration du leader bienfaisant.
Le léninisme et le stalinisme
Projet d’une transformation révolutionnaire de la société sous la direction d’un parti dirigeant et par l’étatisation de toute l’économie, le léninisme a également fait faillite en méprisant et en combattant l’essentiel du socialisme autogestionnaire et fédéraliste né au sein du prolétariat. Le bilan est terrible, et des dictatures sanglantes ont entaché le mot même de « communisme ».
L’histoire l’a maintenant démontré : l’étatisation des moyens de production n’implique pas une rupture avec le rapport capitaliste dirigeant·es-dirigé·es, mais le passage d’un capitalisme éclaté, concurrent, à un capitalisme d’État, avec à sa tête une nouvelle classe exploiteuse.
Aucun parti ne peut s’autoproclamer « l’avant-garde du prolétariat » et imposer sa dictature aux travailleurs et travailleuses au nom de leur émancipation. La forme centralisée et hiérarchisée du parti léniniste, en phase avec sa fonction de prise du pouvoir et d’accaparement de l’appareil d’État, conduit à la tyrannie à l’intérieur de l’organisation, à l’écrasement de la contestation à l’extérieur, à la coupure entre le parti et les travailleurs et travailleuses, entre le parti et la société.
La stratégie de prise du pouvoir par le parti conduit également à des pratiques détestables dans le cadre des luttes quotidiennes : schéma de la courroie de transmission soumettant les organisations de masse et les syndicats aux directives du parti, dirigisme dans la conduite des luttes, faisant à l’occasion prévaloir l’intérêt supérieur du parti sur les nécessités de la lutte.
Certes, nous ne tirons pas un trait d’égalité entre léninisme et stalinisme. Le premier est un courant révolutionnaire autoritaire, alors que le second est un système bureaucratique totalitaire. Cependant, tous deux sont issus du bolchevisme, courant autoritaire du socialisme. Et force est de constater que le léninisme a fait le lit de cette bureaucratie, et qu’il a ouvert la voie aux crimes contre la démocratie et contre le prolétariat. Ces régimes sont responsables de la restauration du capitalisme, leurs classes dirigeantes se sont généralement maintenues au pouvoir en se reconvertissant.
Pour un communisme libertaire
Le projet de société que nous proposons s’appuie sur l’expérience concrète des travailleuses et des travailleurs en lutte, en période révolutionnaire ou non : usines récupérées et autogérées, communes libres, conseils ouvriers, industries socialisées, collectivités agraires, fédérations…
Nous nommons ce projet communisme libertaire, non par référence au courant « communiste » marxiste-léniniste, mais dans la continuité d’un courant plus ancien et plus large : anarchiste, syndicaliste, conseilliste, antiautoritaire.
Par communisme, nous entendons la mise en commun des moyens de production, sans appropriation privée ni privative, décentralisée, c’est-à-dire sans classes et sans État, et la répartition des richesses créées en fonction des besoins de chacune et chacun.
Par libertaire, nous entendons une société qui a pour objectif et pour condition l’émancipation des individus, qui passe par l’égalité économique et sociale et par une démocratie fédéraliste, autogestionnaire.
Le communisme libertaire est le projet d’une société en évolution, animée par un processus révolutionnaire permanent, qui étend progressivement la société nouvelle sur toute la surface terrestre, et qui gagne et intègre peu à peu toute la population.
Contrairement au capitalisme prédateur, incapable de stopper sa fuite en avant destructrice pour la planète, le communisme libertaire peut réaliser l’équilibre entre les capacités productives, les besoins de la population et les capacités de la biosphère.
Nous indiquons ici quelques grands axes de ce projet, tel que nous pouvons le concevoir dans sa première phase de construction, c’est-à-dire alors que toute la population n’a pas encore été gagnée, que la révolution a encore de nombreux ennemis à l’intérieur et à l’extérieur, et qu’il faut faire avec l’héritage du capitalisme en matière de technologies, d’aménagement du territoire et d’inégalités sociales.
Des rapports de production autogestionnaires
Le communisme tel que nous l’entendons repose sur trois points indissociables : socialisation des moyens de production et d’échange ; autogestion de chaque unité de travail ; planification démocratique de la production.
– La socialisation signifie que les moyens de production et d’échange sont une propriété sociale, un « bien commun » de toute la société, et sont placés sous la double responsabilité de fédérations industrielles (métallurgie, bâtiment, agroalimentaire…) et des échelons territoriaux les plus appropriés (communes, régions, fédération…). Chaque fédération industrielle est coordonnée par un conseil très large formé de délégué·es des travailleuses et travailleurs des divers sites de production. L’affiliation de chaque site à une fédération industrielle garantit une logique de coopération et de complémentarité, contre la logique de compétition et de concurrence qui prévaut dans le cadre du marché capitaliste.
– L’autogestion signifie le pouvoir de décision des assemblées de travailleuses et travailleurs, avec liberté totale d’expression et votes démocratiques. L’autogestion doit abolir la césure dirigeant·es-dirigé·es, la hiérarchie entre les métiers et, de façon générale, la parcellisation du travail.
Dans l’autogestion, les responsables, délégué·es, coordinateurs et coordinatrices, sont élu·es et révocables par les assemblées de base, tenu·es de mettre en œuvre les grands choix dans l’organisation du travail, sur la base d’un mandat impératif.
Le renversement des rapports de production implique une transformation radicale de la nature du travail. Les fonctions manuelles et intellectuelles, séparées par le capitalisme, doivent être réunifiées : chaque travailleuse et travailleur doit pouvoir participer à la conception et à la décision, pour le processus de production et pour sa finalité. Son temps de travail incorpore des temps de décision, d’exécution et de formation continue. En ambitionnant, avec l’embauche des chômeuses et chômeurs, et avec la suppression des fonctions inutiles, une redistribution et une réduction massive du temps de travail.
Cette désaliénation du travail remodèle profondément l’appareil productif et le rôle des technologies. Avec des sites de production à taille humaine, plus aisés à autogérer. Avec des technologies qui ne sont plus utilisées par les capitalistes pour intensifier l’exploitation, mais sont adaptées aux besoins réels des collectifs de travail.
– La planification démocratique signifie que la production n’est plus guidée par la course au profit, mais par les besoins de la population. La valeur d’usage prend le pas sur la valeur marchande. Cependant, les besoins humains ne seront jamais « objectifs » : ils sont fonction de données culturelles, d’aspirations personnelles, mais aussi de ce qui est matériellement disponible.
La diversité des besoins appelle donc à la coexistence d’un mécanisme de planification générale et d’une sphère d’échanges de biens, à l’initiative des individus et des communautés.
La planification doit recenser les besoins et orienter la production vers la satisfaction des besoins fondamentaux, dans le respect des impératifs écologiques : logement, alimentation, déplacements, santé, formation… De façon ni concurrente ni contradictoire, la sphère d’échanges spontanés doit permettre l’accès de chacune et de chacun à des commerces et services de complément.
Une démocratie directe et fédéraliste
La différence entre État parlementaire et fédération autogestionnaire est radicale : renversement du pouvoir ; mandatement des responsables pour la coordination et la gestion courante, mais refus de la délégation du pouvoir sur les grandes décisions, et donc démocratie directe.
Cette démocratie directe repose sur trois points : fédération des territoires ; assemblées populaires ; mandat impératif (en lien avec les structures autogestionnaires présentes au sein des unités de travail).
– La fédération des territoires signifie que la société est structurée à partir des communes, puis des régions, parce qu’elles sont les espaces les plus directement contrôlables par la population.
Les régions fédérées ne reproduisent pas nécessairement le découpage des anciennes régions administratives. L’important est qu’elles atteignent une autonomie productive en matière agricole et industrielle, pour permettre un maximum d’échanges en circuits courts.
Le communisme libertaire vise une fédération universelle des régions, par-delà les frontières linguistiques. Cette fédération se donne des règles communes, garantissant la protection de chaque individu et de chaque communauté. Le fédéralisme permet d’éviter les deux écueils que sont le centralisme bureaucratique d’une part et l’atomisation de la société d’autre part. C’est l’équilibre entre l’initiative et l’autonomie des unités fédérées, et la solidarité entre toutes et tous ; c’est la mutualisation des moyens et la structuration des services publics interrégionaux ; c’est une interdépendance sans hiérarchie où, sur les questions communes, les choix collectifs sont faits et appliqués par toutes et tous. Le fédéralisme implique une conception ouverte de la société comme lieu où chercher l’équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt particulier, sans jamais réduire l’un à l’autre.
– Les assemblées populaires sont la cellule démocratique de référence. Elles ne signifient pas un assembléisme perpétuel, obligeant tout un chacun à passer sa vie en réunion pour contrôler chaque détail de la vie de la cité. Ne pouvant rassembler, dans un même laps de temps, qu’une fraction de la population, les assemblées doivent être une arène où se discutent les grands projets ; une étape démocratique avant qu’une consultation formelle de la population, à chaque échelon pertinent, tranche entre les grandes orientations en concurrence.
C’est également dans ces assemblées populaires que sont mandaté·es et éventuellement révoqué·es les délégué·es qui forment les conseils des communes, des régions, de la fédération.
La démocratie directe implique la liberté d’expression et d’organisation, la liberté des cultes, la liberté de la presse. Des courants de pensée organisés peuvent défendre leur point de vue et nourrir le débat, mais les délégué·es sont mandaté·es collectivement. Une fois désigné·es, ils et elles doivent appliquer les décisions collectives, et non celles de leur tendance.
– Le mandat impératif signifie que les délégué·es aux conseils des communes, des régions ou de la fédération ne sont pas élu·es sur un programme et des promesses, avec un mandat délégataire. Ils et elles sont choisi·es en fonction de leur intégrité et de leurs compétences, pour coordonner la mise en œuvre des décisions collectives, dans le cadre d’un mandat impératif et révocable où le fond ne change pas mais où la forme peut évoluer en fonction des arguments.
La démocratie fédéraliste autogestionnaire représente une forme radicalement nouvelle de pouvoir collectif, en rupture avec la division gouvernant·es-gouverné·es, avec la coupure État-société, et avec tous les systèmes de classes. Chacune et chacun étant associé·e à ce pouvoir collectif, le gouvernement descend dans l’atelier et dans la commune : c’est l’autogouvernement de la société, qui répond à l’autogestion de la production.
L’autodéfense de la société
La nécessité de défendre la société nouvelle de ses ennemis intérieurs et extérieurs implique des formes d’autodéfense devant lesquelles les révolutionnaires ne peuvent reculer.
Au moins durant une première phase de la révolution, la persistance des tares de la société, violences racistes, homophobes, sexistes, déprédations et crimes environnementaux nous contraint à une profonde réflexion en vue de l’établissement d’un droit émancipateur et d’une justice réhabilitatrice et réparatrice.
Cependant, les structures d’autodéfense et de justice de la société devront être étroitement liées à la population et contrôlées par les conseils, en rupture complète avec les organes répressifs de l’ancienne société.
Les risques de militarisation ou d’ordre policier sont évidents dans une période révolutionnaire et exigent une vigilance aiguë. La finalité du communisme libertaire est une société débarrassée de l’emprise militaire et policière.
Une organisation militante autogérée
L’Union communiste libertaire n’est pas un parti : elle n’a pas vocation à briguer les voix des électeurs et électrices. L’activité essentielle de l’organisation est le développement et l’auto-organisation des luttes contre tous les systèmes de domination : par sa politique et par sa propagande, par sa réflexion collective, par la formation, par l’aide qu’elle apporte, par l’action de ses membres.
Elle œuvre à l’émergence d’un contre-pouvoir de la base de la société et à une rupture avec l’ordre capitaliste, patriarcal et raciste.
Solidarité, luttes, autogestion
Nous voulons également faire de l’UCL un espace privilégié de solidarité et d’entraide, notamment face à la répression.
L’organisation repose, et ce jusqu’à ce que les adhérentes et les adhérents en décident autrement, sur le présent Manifeste. Ni programme historique, ni déclaration de principe immuable, ce manifeste n’est en effet qu’un moment d’un processus théorique, pratique et organisationnel, qui contient lui-même une dynamique potentielle de dépassement.
Un contrat statutaire fixe les règles du fonctionnement de l’organisation et lie toutes et tous les membres librement associé·es. Les orientations stratégiques de l’organisation, ses prises de positions, ses décisions sont soumises aux débats, à la décision collective, aux votes de l’ensemble de l’organisation. Celle-ci constitue ainsi un terrain d’expérimentation pour la démocratie autogestionnaire et fédéraliste, en cohérence avec le projet communiste libertaire : nous voulons une société égalitaire, sans dirigeant, et nous nous efforçons de la faire vivre au sein de l’UCL.
Cette alternative en acte permet aux militantes et aux militants de posséder un réel vécu et une pratique autogestionnaire. Cela leur donne la possibilité d’insuffler avec plus de facilité et d’assurance ces pratiques au sein des luttes et des mouvements sociaux, dans les collectifs, syndicats et associations dans lesquels ils et elles militent.
Un fonctionnement en cohérence avec nos finalités
L’organisation est donc une fédération autogérée, placée sous la responsabilité collective de l’ensemble de ses militantes et militants. En renversant l’image traditionnelle du parti hiérarchisé, mais sans nier la nécessité et l’importance des activités de coordination et d’animation de l’organisation, nous cherchons à établir un cadre de débat et d’intervention horizontal et décentralisé.
La pratique du mandatement permet de concilier élaboration collective et efficacité ; les mandats sont définis, contrôlés par les membres de l’organisation qui peuvent le cas échéant, révoquer les personnes mandatées.
L’organisation est un lieu pluriel où, sur un fond politique commun, une grande diversité d’opinions peut s’exprimer librement. S’il est naturel qu’elle se donne démocratiquement une orientation majoritaire, elle n’en garantit pas moins scrupuleusement les droits des minorités et des groupes locaux à l’expression. Cela dans le débat interne bien sûr, mais aussi dans la presse de l’organisation, selon des modalités établies par le contrat statutaire.
L’organisation cherche la convergence des actions de ses membres dans un souci évident d’efficacité. Les militantes et les militants sont lié·es par leur mandat lorsqu’il s’agit de parler ou d’agir au nom de l’organisation mais, en dehors de cela, chacune et chacun peut agir selon ses choix personnels.
L’organisation se refuse à tout rapport de direction ou de substitution en direction des luttes des travailleuses, des travailleurs et de la population. Elle peut participer à l’organisation d’initiatives et de mobilisations. Les militantes et les militants de notre courant peuvent prendre toute leur place dans ces luttes. Mais la direction des luttes sociales doit rester sous le contrôle collectif de ceux et celles qui les font vivre. Notre combat est international tout comme la structuration du courant que nous construirons.
Une démarche ouverte
Le communisme libertaire que nous promouvons s’inscrit dans une histoire longue, celle du socialisme antiautoritaire et qui prend ses sources dans la Première Internationale. Il hérite pour l’essentiel des décennies de luttes, d’analyses, de remises en causes stratégiques du courant libertaire « lutte de classe ». C’est dans celui-ci qui est la principale incarnation politique de ce socialisme que nous nous inscrivons.
Il n’a rien à voir avec un individualisme qui nierait l’antagonisme des classes et la nécessité́ de l’action collective pour bouleverser l’ordre du monde. L’appropriation, la socialisation et l’autogestion des moyens de production sont notre ordre du jour pour en finir avec le capitalisme. Nous récusons la politique bourgeoise, et notre intervention ne peut être que résolument extraparlementaire. La « dictature du prolétariat », le léninisme et les expériences des pays dits « socialistes » ne font pas partie de notre histoire.
Pour autant, nous ne prétendons à aucun monopole. Diverses organisations et regroupements existant se réclament d’une filiation libertaire. Nous sommes pour le débat, pour que les forces soient mises en commun aussi souvent que possible, sans nier les spécificités de chacune. Un même souhait de confrontations et d’unité nous conduit à refuser les sectarismes entre toutes les forces qui combattent sincèrement le capitalisme et les autres systèmes de domination.
Refuser les sectarismes
Nous sommes partisan·es de l’auto-organisation et de la démocratie directe, rétifs et rétives en cela au culte de l’unanimité comme à un spontanéisme sommaire. Nous savons que ces préoccupations peuvent rencontrer celles d’autres « écoles » du socialisme. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, plus encore après Mai 68, le courant communiste libertaire a su s’ouvrir aux expériences, s’intéresser aux courants avec lesquels il partage des points communs et même en intégrer les acquis positifs.
Ainsi nous pensons qu’un dialogue est toujours possible et souhaitable avec les différents courants révolutionnaires, d’origines marxistes ou anarchistes.
Si nous rejetons les illusions étatistes véhiculées par les courants et les théories marxistes, les libertaires ont largement puisé, comme Bakounine en son temps, et sans la fétichiser, dans la pensée matérialiste et dialectique synthétisée notamment par Marx. Celle-ci continue d’occuper une place singulière pour celles et ceux qui veulent changer le monde. En particulier lorsqu’elle ne s’égare pas dans le surdéterminisme économique. Pour nous, il n’y a ni destin ni fatalité : c’est bien nous toutes et tous qui, par notre action, faisons l’histoire.
Puiser aux meilleures sources
Nous puisons plus largement dans les courants qui travaillent à l’émancipation de toutes et tous. En en faisant l’expérimentation concrète, notre courant a su faire sienne la pratique syndicaliste révolutionnaire : démocratie syndicale et ouvrière, sens de la grève, rôle des animateurs et animatrices autogestionnaires de lutte, stratégie des contre-pouvoirs…
De même, sur l’écologie, le féminisme, les combats anticolonialistes et antiracistes, nos analyses ont évolué au contact de courants militants, de luttes et de résistances bien réelles. Avant toute chose, c’est en nous immergeant au cœur de ces luttes et de ces résistances que nous éviterons de nous scléroser, de nous racornir sur un étroit pré carré doctrinaire.
C’est pourquoi nous nous inscrivons dans une double démarche :
– développer notre courant libertaire « lutte de classe » ;
– contribuer à l’émergence d’un vaste mouvement anticapitaliste et autogestionnaire, nécessairement unitaire.
L’Union communiste libertaire ne prétend pas devenir à elle seule, en comptant sur ses seules forces, l’alternative au capitalisme. Il serait non seulement prétentieux mais aussi dangereux de croire ou de feindre le contraire. Rejetant tout sectarisme et tout isolationnisme, nous voulons être une des forces unificatrices pour le mouvement révolutionnaire et le mouvement ouvrier. Dans les périodes de recul, l’unité de toutes et tous les anticapitalistes, l’ouverture au mouvement social, permettent la solidarité face à la répression et à une machine étatique qui traque des révolutionnaires. Dans les périodes de montée des luttes, cette unité favorise et amplifie l’action des révolutionnaires face à celles et ceux qui combattent la rupture avec le vieux monde. Mais cette unité ne doit pas masquer nos divergences idéologiques ou stratégiques qui ne manqueront pas de s’affirmer en période révolutionnaire.
Devenir une force politique qui compte
Cette démarche ouverte vise à concrétiser une force de masse, qui pèsera à très grande échelle dans la société, aidant à la multiplication des contre-pouvoirs et préparant les conditions de la rupture révolutionnaire. Cela veut dire inscrire prioritairement ses interventions sur le terrain social, à la base de la société, reliant les luttes antipatriarcales, écologistes, antiracistes, les luttes ouvrières, en leur proposant une perspective autogestionnaire. Un mouvement politico-social donc, et non pas un nouveau parti.
Des actions nouvelles sont nécessaires pour permettre l’expression et l’organisation des révoltes de la base de la société. Nous voulons activement y contribuer car ces pratiques communes permettront les réponses nécessaires, face aux menaces de l’extrême droite et aux illusions véhiculées par la « gauche » de gouvernement. Nous voulons devenir demain une force politique majeure, qui donne au courant libertaire « lutte de classe » une assise auprès des larges masses, et ce dans un mouvement révolutionnaire, s’inscrivant dans un mouvement ouvrier refondé et renouvelé.
