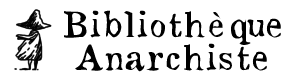Luigi Fabbri
Dictature et Révolution
Du socialisme autoritaire au communisme dictatorial
Dictature et liberté en Russie
La dictature bourgeoise de la révolution
Communisme autoritaire et communisme anarchiste
Le marxisme et l’idée de la dictature
L’enseignement des précédentes révolutions
Préface
Pourquoi rééditer ce livre pour la première fois traduit en français ? Est-ce pour sa valeur historique : démontrer la lucidité de Luigi Fabbri en 1920 et prouver ainsi que les anarchistes ont analysé correctement, très tôt, la révolution russe ? Cela pourrait paraître superflu de rajouter un livre de plus à la littérature critique de la révolution russe, à l’heure où l’espoir suscité par l’URSS est bien mort, à part chez quelques fanatiques des partis communistes et d’extrême gauche.
Hélas ! le même espoir renaît, surtout chez les jeunes, pour les révolutions confisquées par des communistes dictatoriaux et sanguinaires, que ce soit en Chine, au Vietnam, à Cuba, etc. Les Lénine et Trotsky portent alors les noms de Mao, Ho Chi-minh ou Che Gue-varra. Leurs noms sont scandés dans des manifestations et sujets à bien des louanges. La leçon n’est donc pas comprise tant que l’on peut s’enthousiasmer pour une révolution qui met en place un régime souvent pire que le précédent. D’où l’intérêt de Dictature et Révolution, œuvre majeure de Luigi Fabbri et ouvrage fondamental pour les anarchistes.
Mais en premier lieu, il n’est pas inutile de présenter brièvement au lecteur français l’auteur, Luigi Fabbri. Son nom est lié, dans l’histoire, à celui d’un autre militant italien célèbre, Errico Malatesta, que Luigi Fabbri appelait son « maître en anarchie ». Malatesta a traversé l’histoire de nombreux pays, notamment d’Europe et d’Amérique latine, sur une période qui va de la première Internationale,
où il faisait partie de la Fraternité de Bakounine, jusqu’à l’installation du fascisme en Italie où son effigie est brûlée symboliquement par les fascistes. Cette histoire fait de Malatesta l’un des militants les plus importants de l’histoire du mouvement libertaire et des organisations anarchistes.
Lorsque Malatesta est arrêté et mis en détention au cours de l’hiver 1897–1898, apparaît, avec d’autres compagnons anarchistes, Luigi Fabbri pour remplacer ceux qui sont détenus et qui ne peuvent plus assurer la parution d’un journal anarchiste à Ancone, l’Agitazione. Dès lors, Fabbri deviendra un des militants les plus actifs, travaillant avec Malatesta ou le remplaçant lorsque celui-ci est en prison ou en exil. Fabbri, lorsqu’il n’est pas lui-même incarcéré, participe à plusieurs journaux et revues où sa volonté, comme celle de Malatesta, est de convaincre par des arguments simples et réalistes, délaissant les insultes et le ton violent qui avaient trop souvent cours dans le mouvement anarchiste. Ce qui lui donnera l’occasion d’écrire, en réaction, une brochure Les Influences bourgeoises dans l’anarchisme.
Il est, toujours avec Malatesta, un défenseur infatigable de l’organisation anarchiste et un des plus actifs fondateurs, en 1919, de l’Union anarchiste communiste italienne qui deviendra un an plus tard, l’Union anarchiste italienne. Bien avant cela, il avait écrit une brochure L’Organisation ouvrière et l’Anarchie pour intervenir dans le débat entre ceux qui, comme Monate, pensaient que le syndicalisme se suffisait à lui-même, et ceux, comme Malatesta, qui pensaient qu’il fallait une organisation anarchiste spécifique, car le syndicalisme ne réunit pas que des anarchistes. Cela donnera lieu à un beau débat au congrès international anarchiste d’Amsterdam en 1907 (24–31 août).
A ce même congrès, et à celui des Italiens deux mois auparavant, Fabbri présente un rapport, véritable plaidoyer pour l’organisation anarchiste, qui sera édité en brochure : L’Organisation anarchiste[1]. Il y écrit notamment : « On entend dire que l’organisation est une méthode et non une fin ; c’est une erreur. Le principe de l’organisation n’est pas seulement propagé parce qu’en nous organisant aujourd’hui nous pouvons mieux préparer la révolution, mais aussi parce que le principe d’organisation en soi est un des principaux postulats de la doctrine anarchiste. »
Après la guerre de 1914–1918 où il a continué sa propagande antimilitariste, refusant de rejoindre une quelconque union nationale, il est impliqué dans la situation révolutionnaire italienne sans pour cela se désintéresser de la révolution russe. Il fait paraître une brochure Crise de l’anarchisme[2] où l’on retrouve les mêmes préoccupations que dans son livre Dictature et Révolution, concernant la troisième Internationale et le livre de Lénine L’État et la Révolution. Il écrira également une réponse à l’ouvrage du grand théoricien bolchevik de l’époque, Boukharine, en reprenant le même titre : Anarchie et Communisme scientifique.
La situation italienne deviendra ensuite préoccupante, avec la répression qui suivra le mouvement des conseils d’usines en 1920 et l’arrivée au pouvoir des fascistes. Fabbri écrira alors La Contre-Révolution préventive dont les analyses sont toujours valables. Refusant en tant qu’enseignant de prêter serment au fascisme, il est contraint de s’exiler ; et peu avant sa mort, en 1935, il écrira un livre sur Malatesta, décédé en 1932 : Malatesta, sa vie et sa pensée ; puis s’occupera de l’édition de ses œuvres complètes.
Incontestablement, Dictature et Révolution est l’œuvre majeure de Fabbri et est considéré comme une réponse au livre de Lénine L’État et la Révolution. Malatesta, le préfaçant, a pu écrire : « La matière du livre est un cas particulier du vieux, de l’éternel conflit entre liberté et autorité, qui a rempli toute l’histoire passée et travaille plus que jamais le monde contemporain, et des vicissitudes desquelles dépend le sort des révolutions actuelles et futures. » Malatesta savait de quoi il parlait, lui qui combattait déjà Marx dans la première Internationale aux côtés de Bakounine.
Écrivant en 1920, Fabbri devait surmonter plusieurs difficultés. Comment critiquer la révolution russe avec de rares informations, exceptées celles partiales des journaux bourgeois occidentaux, lorsque la coalition des États capitalistes fait blocus et envoie des troupes en URSS ? Situation difficile pour ne pas hurler avec les loups et compliquée par celle, révolutionnaire, de l’Italie où il fallait préserver les chances d’unité. Fabbri se voit donc contraint à des précautions de langage tout en essayant de renforcer sa démonstration, ce qui donne lieu quelques fois à des contradictions alors que ses affirmations restent claires et précises.
Le risque encouru est que certains s’appesantissent plus sur ses préoccupations que sur ses affirmations. C’est ce risque qu’il prend lorsqu’il écrit que l’on peut être théoriquement anarchiste et marxiste pour ensuite répéter maintes fois que les anarchistes ne sont pas marxistes. Même risque tactique, suivant en cela Bakounine, lorsqu’il déclare juste certaines idées de Marx comme par exemple le matérialisme historique, alors que c’est justement là le point fondamental d’opposition entre le marxisme et l’anarchisme. Il faut donc que le lecteur fasse bien la différence entre ce qui est commandé par le contexte dans lequel il écrit et les positions de fond ou de principe.
Ce livre est l’occasion de constater qu’en 1920, on pouvait posséder toutes les informations nécessaires à la compréhension exacte de la révolution russe. Fabbri connaissait très bien, malgré ses précautions, la situation faite aux anarchistes depuis la canonnade de leur centre à Moscou, durant la nuit du 11 au 12 avril 1918, et la succession des alliances et des traîtrises envers Makhno et ses partisans.
De même, Fabbri connaissait très bien la situation faite aux socialistes révolutionnaires de gauche ainsi qu’aux autres tendances révolutionnaires. La suppression de la liberté de la presse, des libertés politiques, la prise de contrôle des soviets, la mise en place de la Tchéka et de l’Armée rouge, tout cela il le sait ; tout cela on pouvait le savoir, sans attendre de quelconques rapports.
Tout cela pouvait se savoir, d’autant plus, qu’à côté des calomnies lancées contre leurs adversaires par les bolcheviks et la théorie marxiste, Fabbri pose le problème central, non seulement de la révolution russe, mais de toute révolution passée et à venir : celui de l’État. Soviets, constituante, terrorisme, violence, expropriation, ordre et désordre, travail, défense de la révolution : tous ces problèmes sont vus sous l’aspect de l’État et de la critique des anarchistes. Fabbri nous montre comment l’État ne peut satisfaire la demande des travailleurs et comment il est nécessairement contre-révolutionnaire, quel que soit le parti ou les individus qui sont à sa tête.
Lorsque ce sont des marxistes comme Lénine, Trotsky ou Staline, cela mène tout naturellement à la « dictature du prolétariat ». Pour légitimer cette dictature, les marxistes ont souvent eu recours à des artifices pour prouver que celle-ci n’a rien d’oppressif pour les révolutionnaires et les travailleurs, disant que son modèle était la Commune de Paris et que les suppressions de liberté ne viseraient que les bourgeois. Des anarchistes, oubliant leurs principes, y ont cru.
Dès 1919, Malatesta était intervenu en s’adressant à ces anarchistes qui croyaient que la « dictature du prolétariat » signifiait « tout simplement le fait révolutionnaire des travailleurs qui prennent possession de la terre et des instruments de travail et essaient de constituer une société, d’organiser un système de vie qui exclu la classe exploitante des producteurs ». Malatesta, connaissant le marxisme, leur répondit : « Mais les vrais partisans de la « dictature du prolétariat » ne l’entendent pas ainsi, et le montrent parfaitement en Russie. Le prolétariat y a la même importance que le « peuple » dans les régimes démocratiques : c’est-à-dire sert simplement à cacher l’essence réelle de la chose. En réalité il s’agit de la dictature d’un parti, ou mieux de la dictature des chefs du parti. Et c’est une vraie dictature au sens propre, avec ses décrets, ses sanctions pénales, ses agents exécutifs et surtout sa force armée, qui aujourd’hui lui sert aussi à défendre « sa » révolution contre les ennemis extérieurs, mais qui demain lui servira pour imposer la volonté des dictateurs aux travailleurs, pour arrêter la révolution, consolider les nouveaux intérêts en passe de se constituer et pour fonder contre la masse une nouvelle classe privilégiée. »
Ce n’était pas un procès d’intention, c’était constater les conséquences pratiques d’une théorie qui sera d’ailleurs confirmée un an plus tard dans l’Avanti !, journal du Parti socialiste italien soutenant le régime bolchevique où il est écrit : « En Russie, sous le régime soviétique, le parti dirige véritablement toute la politique de l’État, et toute l’activité publique, tant des individus que des collectivités, est subordonnée aux décisions du parti, de sorte que la dictature du prolétariat est vraiment la dictature du parti et par conséquent du comité central. » Il n’est pas encore question d’un dictateur unique, mais on y vient !
Fabbri insiste dans son livre sur ce qu’est la dictature, sans artifice, c’est-à-dire la violence envers les opposants et le prolétariat lui-même. Il affirme avec force que la dictature sous quelque forme que ce soit est inacceptable et que l’expliquer par des nécessités quelconques ne peut pas la justifier. Notamment le prétexte, évoqué par Malatesta, de la défense de la révolution contre l’extérieur qui a toujours servi en fait à la dictature pour contrôler la révolution, la freiner et faire peser son poids ensuite contre la population.
Ce livre nous montre bien que l’État est à combattre dès les premiers jours et que l’on ne peut y avoir recours sans risquer de rejoindre les marxistes dans leur conception de la phase « transitoire ». C’est de la capacité à résoudre les problèmes posés par la révolution sans État que se construit une société contre l’État. La révolu-ion qui se déroulera plus tard, en 1936, en Espagne, confirmera de manière éclatante l’exactitude de la façon de poser les problèmes de Fabbri. Des anarchistes sont entrés dans des gouvernements locaux et nationaux, sous le prétexte de défendre la révolution, et ils n’ont fait que freiner celle-ci et renforcer l’État.
Ce sont nos compagnons espagnols qui en ont tiré les conséquences pratiques en 1945 pour les organes de coordination nécessaires au fonctionnement de la société en essayant justement de résoudre les problèmes posés par la révolution, sans avoir recours à l’État et contre l’État. D’ailleurs cette révolution espagnole, en opposition avec le fascisme et le communisme international, a été bien plus loin socialement que n’importe quelle révolution car l’immense majorité des anarchistes et de la population s’est organisée en dehors de l’État ; insuffisamment malheureusement.
Il faut être conscient que, malgré les alliances et les sympathies déclarées en période d’opposition commune au capitalisme, la guerre est déclenchée jusqu’à l’extermination des anarchistes lorsque le pouvoir est pris par ces « alliés » d’antan, comme en Russie, en Espagne, en Chine, à Cuba, etc. Les anarchistes doivent-ils éternellement travailler pour les autres ? Non ! les anarchistes doivent se battre sur deux fronts : l’un antifasciste et anticapitaliste, l’autre anticommuniste et antisocialiste étatiques.
Ce livre est donc d’importance pour opposer notre anarchisme à tout socialisme d’État, à « tout socialisme de caserne » aurait dit Bakounine. Les anarchistes ne sont pas pour n’importe quelle révolution, et ils se doivent, même si elles sont combattues par des forces réactionnaires, de les critiquer si elles conduisent à mettre en place un régime encore plus dictatorial qu’avant. Puisse ce livre être une arme efficace pour ce combat.
Stéphane Carel groupe Malatesta
Veille de révolution
Nous attendons la révolution, nous la désirons, car elle nous libérera, nous et tous les hommes, de la plus grande part des maux qui nous affligent. Nous l’attendons depuis le premier moment où nous avons pris conscience de ces maux. Et pourtant nous ne sommes pas reconnaissants à cette guerre qui nous a laissé en héritage une situation révolutionnaire.
Certains, qui cachent mal sous une phraséologie plus démagogique que révolutionnaire un sentiment nationaliste, avaient déjà essayé au cours des polémiques qui avaient précédé l’intervention italienne dans la guerre, pendant sa période de neutralité (1914–1915), d’étayer leur propagande interventionniste avec des motivations révolutionnaires. Ceux-là, même aujourd’hui, avancent pour glorifier la guerre le fait que ses conséquences désastreuses ont rendu possible, plus que jamais, une révolution. Ainsi, ils rendent grâce à la guerre pour la révolution russe et, en ce qui concerne l’Italie, pour la faveur populaire acquise ces derniers temps par les idées et les partis les plus révolutionnaires, en réaction aux conséquences de. l’énorme conflit.
On peut voir combien cette exaltation du mal est grotesque au vu des réactions, de l’indignation et de la révolte qu’elle provoque. Avec une pareille logique, il faudrait exalter la faim parce qu’elle pousse les peuples à se rebeller contre leurs affameurs, et, toujours en suivant cette logique, on pourrait faire l’éloge des affameurs du peuple et justifier une propagande et une politique de famine. Ainsi, le mérite des premières insurrections de 1789, par exemple, reviendrait tout autant sinon plus aux accapareurs de céréales, pendus aux lanternes, qu’aux assaillants héroïques de la Bastille et des Tuileries.
Bien sûr, il est probable (bien que les éléments qui permettent de soutenir le contraire ne manquent pas) que sans la guerre mondiale, la révolution russe n’aurait pas eu lieu, ou bien qu’elle se serait fait attendre encore longtemps. Mais alors le mérite en reviendrait aux criminels couronnés qui ont préparé et finalement provoqué la guerre, aux intrigues du militarisme et du capitalisme international et, plus ou moins indirectement, au Kaiser, à l’empereur d’Autriche, au tsar, etc. Etant donné que sans maladie il ne saurait y avoir de soins médicaux ni de guérisons, avec la même méthode de raisonnement, on pourrait soutenir que le mérite de la guérison revient davantage à l’agent de la maladie qu’au médecin traitant.
Un médecin qui, par une aberration se réalisant parfois, finit par considérer sa science comme une fin en soi et non comme un moyen d’alléger, d’empêcher ou de guérir le mal, pourrait se féliciter de tomber sur un « beau cas » de maladie digne d’étude, qui lui procure le plaisir et la gloire d’une belle guérison. Mais ne s’en féliciteraient certes pas les patients qui auraient préféré ne pas tomber malade. Si, en plus, l’aberration scientifique est parvenue à faire taire la conscience du médecin, il se peut (et cela s’est parfois avéré) qu’il inocule lui-même à une personne saine une quelconque maladie pour pouvoir l’étudier et ensuite se vanter, en de doctes mémoires, d’avoir obtenu sa guérison. Mais notre conscience condamne de tels procédés comme des crimes.
Ceux qui ont accepté une quelconque coresponsabilité dans la guerre soit pour sa préparation, soit pour son extension ou sa continuation, solidaires en cela des gouvernements et des classes dirigeantes, sous prétexte que de la guerre serait née la révolution, sont comme le médecin qui provoque chez son patient une maladie, ou bien la rend plus grave dans l’intention de la guérir ensuite. Pire, dans notre cas, la maladie était sûre et la guérison incertaine. En effet, non seulement la paix n’a pas encore jailli de cette guerre mais, qui plus est, la révolution est incertaine, bien que paraissant fort probable, et les résultats du point de vue d’une meilleure organisation de la société humaine sont très douteux.
Ceux qui mettent en exergue la situation révolutionnaire créée par la guerre oublient qu’avant 1914, dans toutes les nations d’Europe, la situation était encore plus révolutionnaire. Déjà à ce moment-là, nous étions à la veille de la révolution, et le futur historien qui fera une synthèse des grands événements de ce début de siècle arrivera certainement à cette conclusion : la guerre de 1914–1918 a été organisée par les classes dominantes, car elle était l’unique moyen de contrer la révolution prolétarienne qui était imminente.
Le professeur C.A. Laisant, de l’École polytechnique de Paris, dont la sincérité ne peut être mise en doute du fait de ses idées libertaires puisqu’à partir de 1914 il a été en France l’un des plus fervents partisans de « l’union sacrée » patriotique, rapportait en 1912 un échange de propos avec une personnalité de la finance parisienne, au sujet de l’aide en argent, consentie justement ces jours-là par les banquiers français aux Turcs et en même temps à leurs ennemis dans les Balkans ; ce monsieur lui aurait textuellement confessé : « Ce que nous voulons, c’est la certitude d’avoir la voix au chapitre quel que soit le résultat des hostilités, et devenir de fait les arbitres de la situation, et nous le sommes. Désormais, la guerre européenne sera inévitablement la conséquence des événements actuels[3] parce que nous le voulons et parce qu’il est impossible de nous résister. Nous voulons la guerre, elle nous est nécessaire pour de multiples raisons, dont la principale est l’accroissement de la force des classes ouvrières organisées, tout spécialement en France et en Allemagne. Si les progrès de l’organisation ouvrière continuent, dans dix ans, plus rien ne pourra l’arrêter, et nous nous trouverons en face d’une catastrophe révolutionnaire certaine, devant une ruine universelle et irrémédiable. Une autre motivation, non moins puissante pour vouloir la guerre est la situation financière de la Russie, à laquelle nous avons donné les milliards de l’épargne française. La Russie ne peut pas payer et à peine aura-t-elle déclaré la banqueroute qu’elle provoquera la révolution chez nos petits épargnants. Nous serons alors perdus. La guerre, et elle seulement, nous fournit une solution. C’est un cas de force majeure qui a réponse à tout et dispense de payer. Dans l’état actuel des choses, nous ne craignons aucune résistance. En France tout spécialement, l’esprit des masses est resté accessible aux excitations chauvines, et le pouvoir aussi bien que la grande presse ne laisseront pas s’éteindre cette flamme… Il est vrai qu’il y aura un immense charnier, la faim et les épidémies feront encore plus de dommages que les fusils et les canons, mais on ne peut pas défendre des intérêts tels que les nôtres avec un sentimentalisme humanitaire. Nous rebâtirons sur les ruines. L’organisation ouvrière, génératrice de désordre économique, sera brisée dans le monde entier. De toute façon, nous n’avons pas le choix des moyens. Avec le moyen suprême d’une guerre européenne, nous avons l’avantage d’une victoire à coup sûr. Il nous importe peu de savoir qui sera vaincu et qui sera vainqueur, car en fin de compte, notre ennemi est le prolétariat, et il sera vaincu. Nous resterons les vrais vainqueurs [4]. »
Pour mettre en évidence la situation révolutionnaire européenne à la veille de la guerre mondiale, un long exposé serait nécessaire, mais il nous entraînerait trop loin. Disons seulement qu’en Russie comme en France, en Allemagne comme en Espagne, en Autriche comme en Italie, les temps étaient mûrs. L’Angleterre peut-être faisait exception, ainsi que les petites nations qui auraient suivi les grandes. Ici, les choses se seraient produites de façon plus légale et modérée, comme en Allemagne, où la démocratie socialiste était en train de remplacer le pouvoir des vieilles coalitions militaires et de cour ; là, d’une façon nettement révolutionnaire, comme en Russie et en Italie, où le heurt était tout proche.
Pour l’Italie, un symptôme éloquent a été l’épisode insurrectionnel de juin 1914, connu sous le nom de « semaine rouge ». Cet épisode est apparu ensuite négligeable, presque puéril, en comparaison des terribles événements ultérieurs. Pourtant la façon dont ces mouvements ont éclaté, le large consensus obtenu, l’esprit populaire qu’ils ont mis en lumière, aussi bien que la faiblesse organique de l’État italien, ont été une révélation pour tout le monde, pour le gouvernement comme pour les révolutionnaires. Le caractère improvisé et spontané de ces émeutes que personne n’attendait à ce moment-là, et grâce auxquels le peuple resta maître avec des moyens risibles et une grande facilité d’une dizaine de villes et d’un nombre encore plus grand de bourgs et de villages des Marches et de la Romagne, est une raison pour accorder une importance majeure aux émeutes elles-mêmes. Et si celles-ci ne furent ni révolution ni insurrection (et peut-être ne le devinrent-elles pas parce que dans les autres parties de l’Italie le mouvement s’arrêta trop tôt, et les organisations prolétaires n’eurent pas l’audace d’« oser »). Elles démontrèrent qu’alors, en Italie, la révolution était possible.
On y serait certainement arrivé malgré la guerre qui a éclaté peu après, si l’État italien n’y avait pas pris parti. La « semaine rouge », justement parce qu’elle avait révélé leur force au prolétariat en général et aux révolutionnaires en particulier, avait laissé derrière elle un ferment extraordinaire. La défaite, si on peut ainsi appeler le fait que l’« ordre » ne fut pas rétabli par le gouvernement mais revint spontanément (les soldats arrivèrent quand tout était déjà calme), n’avait pas atteint le moral, au contraire, elle avait plutôt excité les esprits. Une plus vaste action se dessinait parmi les divers partis et organisations prolétariennes dans un esprit de concorde jamais vu, aussi bien avant qu’après.
Sans l’intervention de l’Italie dans la guerre et sans le désordre et la discorde que par leur interventionnisme certains révolutionnaires des plus connus (à ce moment-là jugés sincères, mais qui passèrent ensuite et ouvertement dans le camp ennemi) jetèrent au sein du prolétariat, la révolution italienne aurait précédé de beaucoup la révolution russe. Et peut-être aurait-elle contribué à faire cesser l’énorme boucherie et fait en sorte que la révolution gagne l’Europe avant que la guerre ne gaspille jusqu’aux dernières ressources de la vie des peuples. C’est-à-dire avant même que cette révolution ne devienne trop problématique, trop âpre, trop chargée de périls et de difficultés.
A ce moment-là, l’intervention italienne sauva la monarchie et, en général, les classes dirigeantes qui n’auraient pas couru de tels risques si elles n’avaient pas compris que la guerre était nécessaire pour éviter, ou au moins retarder la révolution.
En 1914, cette possibilité de révolution était, en Italie, admise par beaucoup qui, tout en se disant révolutionnaires, soutenaient que la guerre était encore plus urgente. Ils ne comprenaient pas, ou faisaient semblant de ne pas comprendre l’importance d’une intervention révolutionnaire de l’Italie dans les affaires de l’Europe.
L’idée que la guerre aurait pu faciliter la révolution prévalait alors et cela plus spécialement parmi les éléments les plus incohérents et irréguliers des différents partis, poussés beaucoup plus par l’appât du succès que par une foi profonde, doués de ce génie superficiel et tout en apparences, fourni par une culture désordonnée, à dominante journalistique. Pourtant, même avant, de temps en temps, cette idée était apparue, tout spécialement en France, pendant la période de la propagande dite alors hervéiste [5], laquelle, malgré ses attitudes « hérétiques », n’était pas si éloignée de la mentalité patriotarde de l’interventionnisme ultérieur.
Certains de ces sophismes avaient cours aussi en Italie au temps de la guerre de Libye. Malatesta avait essayé alors de les contrer, en publiant différents articles dans des journaux italiens, français et anglais. L’un de ses articles[6] dénonçait le « danger de s’habituer à considérer la guerre comme une condition nécessaire, voire même simplement utile pour une insurrection populaire, alors que la guerre est la pire des conjonctures qu’on puisse imaginer pour le triomphe d’une insurrection, serait-ce même en cas de défaite ».
Si l’on considère attentivement les circonstances dans lesquelles se sont produites les révolutions dans toute l’Europe à la suite de la guerre, on peut voir combien Malatesta avait raison. La révolution sous la botte d’un vainqueur étranger est des plus instables et ne pourra jamais être totalement radicale. Si elle va un peu trop loin, elle risque d’être étouffée, comme c’est arrivé en Hongrie, ou bien alors elle est condamnée à la plus grande modération, comme en Allemagne, ou encore soumise aux ingérences étrangères comme en Autriche. Dans tous les cas, elle est contrainte à subir la loi faite par les vainqueurs, avec le danger permanent, étant réduite à l’impuissance militaire ou presque, que les vainqueurs imposent ou facilitent, toujours comme en Hongrie, le retour à l’ancien régime ou pire encore.
La réussite révolutionnaire de la Russie va elle aussi dans le sens de notre opinion, par des faits complètement différents. La révolution, qui a éclaté en Russie par haine de la guerre a nui à la guerre et, à son tour, trouve dans celle-ci le plus grand obstacle à son con-solidement. Aujourd’hui encore, c’est bien la guerre qui, perdue ou gagnée, à l’intérieur ou de l’extérieur, menace de perdre la révolution, de même que jusqu’ici, c’est bien la guerre qui a facilité ou bien rendu inévitables les nombreuses erreurs de la révolution.
A ses débuts, la révolution russe aurait certainement exigé un effort plus grand et aurait buté contre les premières tranchées du tsarisme, si celui-ci n’avait pas été affaibli par la guerre, ou s’il n’y avait pas eu la guerre. L’accouchement révolutionnaire aurait été sans doute beaucoup plus laborieux et douloureux. En revanche, la révolution aurait gagné en rapidité et en liberté de mouvements, une fois balayés les premiers obstacles, si, à cause de la guerre, il n’y avait pas eu aux frontières des armées étrangères. Et, en dernière analyse, l’effort relativement aisé pour aboutir à la révolution de mars 1917 a ensuite été compensé par le gaspillage de sacrifices, d’énergies et de sang qui est devenu nécessaire et qui l’est toujours.
Parmi les multiples conditions défavorables dans lesquelles la révolution s’est développée, elle a tout de même trouvé une chance qui l’a favorisée : c’est justement le fait d’avoir éclaté alors que la Russie, bien qu’ayant subi pas mal de revers militaires, n’avait pas encore été vraiment battue par les armées allemandes. Autrement dit, elle a précédé de quelques mois la pire des défaites (celle subie par l’offensive de Brussiloff, voulue par Kerensky et imposée par les pays de l’Entente) et elle a eu la possibilité et le temps de mûrir et de se consolider. Il va de soi que si la Russie n’avait pas eu en face d’elle un ennemi bien plus terriblement engagé ailleurs, et donc pressé de conclure la paix, elle aurait eu contre elle tout de suite, dès les premiers moments, un vainqueur véritable, libre de ses mouvements, qui ne lui aurait pas permis de s’engager sur la voie de la révolution trop au-delà des limites consenties par les intérêts de l’impérialisme germanique.
La révolution, qui, tout au moins dans ses premiers temps, est une condition d’infériorité militaire, ne déplaît pas trop à l’ennemi au-delà de la frontière à condition cependant qu’elle n’aille pas trop loin. Même en 1871, la Commune n’a pas été mal vue par Bismark et Moltke, mais cela ne les a pas empêchés d’en faciliter l’écrasement par Thiers. Ce qu’il leur fallait, c’était plutôt la révolution de septembre avec la république de Jules Favre, une révolution aux conséquences limitées, pas plus.
Ces effets qui limitent la révolution dans les pays vaincus se transforment toujours en effets férocement et cyniquement réactionnaires et contre-révolutionnaires dans les pays vainqueurs. De même que les victoires de 1866–1870 ont empoisonné l’Allemagne et en ont fait le centre de la réaction en Europe, après qu’elle eut été pendant un demi-siècle le pays de la libre pensée, la victoire de 1918 rend aujourd’hui la France folle d’orgueil militariste et d’esprit conservateur. Le pays de la Grande Révolution et de la Commune redevient la terre de l’inique thermidor, des massacreurs de 48 et de 71, des guillotineurs de 94, des congrégationnistes et des militaristes faussaires et violents. Jusqu’en Angleterre, la réaction fait sentir et peser ses griffes, tandis que le gouvernement militaire et britannique (sic) écrase toute liberté en Irlande, en Égypte, en Inde, partout où un colonisateur anglais étend sa main rapace.
De ce point de vue, l’Italie est la nation qui se trouve dans les meilleures conditions. Souvent, nous avons lu, même dans les journaux les plus conservateurs, que l’Italie est relativement le pays le plus libre parmi les vainqueurs. Certains constatent cela avec regret dans leur désir d’étrangler toute liberté, d’autres le signalent comme un reproche à une classe ouvrière qui ne saurait être assez reconnaissante aux classes dominantes de la liberté que celles-ci lui accordent. Il y a en cela du vrai, mais une vérité très relative ! Beati monoculi in terra caecorum ! dit-on. Celui qui ne possède que quelques sous peut paraître riche à celui qui n’a rien. Mais même ces quelques bribes de liberté dont on jouit en Italie au moment où nous écrivons, et qui diminuent constamment entre deux tirs de fusil ou de revolver royaux sur les foules prolétariennes, ne sont pas du tout une conséquence du libéralisme des institutions en vigueur, ni des concessions spontanées du pouvoir ni, encore moins, un fruit positif de « la belle guerre menée pour l’indépendance des peuples, pour la liberté, la justice », etc. De la guerre, elles sont plutôt une conséquence négative.
L’Italie, si mal sortie de la guerre, a eu cette chance : après une victoire militaire à la mise en scène impressionnante, elle a été diplomatiquement et économiquement privée par « ses alliés » de tout fruit concret de la victoire (mise à part l’annexion purement mécanique de quelques arpents de « terres irrédentes » et cela avec beaucoup de parcimonie) d’une manière si cynique et impitoyable qu’elle peut se considérer comme une nation plutôt vaincue que victorieuse. Ont ainsi fait défaut aux classes dirigeantes et à la maison régnante les raisons d’une suffisance militaire et morale qui auraient fait peser la victoire sur les sujets de la façon la plus oppressante. Les institutions monarchiques et bourgeoises sont donc sorties affaiblies de la guerre, presque comme si elle s’était terminée sur une défaite.
De cette défaite, le peuple a tiré l’avantage d’un affaiblissement de ses dominateurs, sans subir les dommages d’une invasion étrangère, avec toutes les conséquences désastreuses et dangereuses qui lui sont inhérentes. Puisque les libertés populaires, dans tout régime, sont une conséquence directe de la faiblesse morale et matérielle du gouvernement et que les populations sorties fatiguées et irritées de la guerre ont une certaine prédisposition révolutionnaire, obligeant le gouvernement et la bourgeoisie à être plus souples, le prolétariat bénéficie donc dans les premiers temps après l’armistice d’une liberté toujours réduite mais plus grande que celle des prolétariats de tant d’autres pays.
Mais il ne faut pas se faire d’illusion ! Le gouvernement va redevenir plus fort et sûr de lui. Et puis, même si le gouvernement en tant qu’organisation civile et politique centrale est faible, en dehors du gouvernement (et éventuellement contre lui), il y a toujours eu, et aujourd’hui encore plus visible, une force réactionnaire non négligeable que la guerre a encore accrue. Cette force est constituée par l’appareil militaire sorti intact du conflit mondial. Après avoir eu pendant quatre ans le pouvoir absolu sur la moitié de l’Italie et celui relatif sur toute, il ne veut pas consentir à devenir un rouage secondaire de l’État, ni accepter sa réduction à cause des inévitables économies. La guerre en a accru le personnel dirigeant, prélevé dans les classes parasitaires les moins fortunées, et qui a peur, maintenant, de devoir quitter les grades et emplois qui lui assurent une vie facile et des traitements substantiels et sûrs. À cette situation est relié un enchevêtrement compliqué d’intérêts. La caste militaire, composée de nombreux officier, état-major en tête, constitue un État dans l’État et, répétons-le, quand cela lui convient, contre l’État.
Le gouvernement civil cherche l’équilibre et voudrait résister aux tendances de la caste militaire, qui a besoin, pour sa survie, d’une Italie maintenue sous le régime militariste de la paix armée et de la guerre toujours à l’horizon. Mais il ne peut pas lui résister, car il en est l’esclave. En réalité, le pouvoir de l’actuel gouvernement prendrait fin si ce dernier se mettait contre la caste militaire. Il préfère donc la laisser faire, fermer les yeux sur ses illégalités les plus évidentes, l’aider ouvertement ou bien en cachette, et s’en servir de temps en temps contre le prolétariat. Le gouvernement avait bien essayé de constituer ses propres forces de police volontaires, mais comme il ne pouvait puiser ces éléments que dans l’armée, il s’est aperçu un beau jour que de telles milices étaient plutôt influencées par le militarisme nationaliste que par sa politique. Pour le prolétariat, c’est encore pire car, s’il n’aura jamais complètement contre lui la grande masse des soldats, les milices volontaires, en accord avec la majorité des officiers, constituent une armée contre-révolutionnaire non négligeable.
Et il ne manque pas d’alliés à cette minorité, bien petite par rapport à la population italienne, mais compacte et fournie de tous les moyens de défense et d’attaque, y compris la complicité tacite du gouvernement, tantôt volontaire, tantôt forcée. Et avant tout la petite mais richissime bande ploutocratique des industriels de guerre qui ont des intérêts identiques à ceux de la caste militaire, car un désarmement effectif et l’entrée en une période de paix réelle signifieraient pour eux la cessation de tous gains et peut-être la perte partielle de ceux déjà acquis. Autour de ce noyau central ploutocratique, il y a la presse qui alimente abondamment toute la cohorte des entrepreneurs, des gros intermédiaires et des fournisseurs qui tirent leurs gains considérables, sans grande fatigue, de l’industrie de guerre et de l’administration militaire.
Sans aucun doute la guerre a suscité dans les masses prolétaires une telle hostilité contre la classe bourgeoise, les a rendues si agressives et compactes, unanimes, ouvertes aux idées socialistes et anarchistes sur un éventuel bouleversement de l’ordre social, les a tellement familiarisées avec le danger et disposées à se battre avec n’importe quelle arme, a tellement exaspéré leur mécontentement, au point de constituer un élément de succès pour la révolution, tel qu’il n’existait pas avant 1914. Mais avant 1914, il n’y avait pas non plus une force contre-révolutionnaire homogène, relativement nombreuse, riche, bien armée, tenant le gouvernement à sa merci, et protégée par la muette solidarité de la bourgeoisie et du clergé réorganisés, il n’y avait pas, autrement dit, la force réactionnaire dont je viens d’énumérer les principaux éléments. La révolution ne peut certainement pas savoir gré à la guerre de cet état de chose.
Malgré ce qui est dit précédemment, on pourra peut-être mettre en doute notre opinion que la guerre a éloigné la révolution. Cependant, il est sûr que la guerre a rendu plus aléatoire une victoire de la révolution, une victoire réelle qui ne consiste pas seulement en un inutile changement de forme de gouvernement. Non seulement la guerre a fait en sorte que la révolution ne puisse pas être plus sanglante, mais la guerre a déterminé une telle crise générale économique, politique et psychologique, qu’une catastrophe est inévitable. Le choc des forces contraires ne semble pas être le fait de l’arbitre humain, on est poussé nécessairement à la révolution, même si le moment semble défavorable, à moins que l’on ne préfère le triomphe de la pire contre-révolution.
Pour toutes ces raisons, nous en arrivons à la conclusion ébauchée au début : la révolution ne peut pas être reconnaissante à la guerre de la situation particulière, révolutionnaire, qu’elle nous laisse en héritage. Le prolétariat se trouve aujourd’hui devant un carrefour : soit se jeter avec toutes ses énergies dans la lutte, et réaliser au plus tôt la révolution (et cela malgré les difficultés déjà considérées, et les autres, particulièrement à caractère économique, qui rendront le passage de l’ancien au nouvel ordre très pénible), ou bien abandonner son attitude hostile, s’adapter à travailler plus et à consommer moins. C’est-à-dire revenir aux conditions animales d’existence d’il y a cinquante ans pour recommencer, une fois reconstituée la richesse du capitalisme détruite par la guerre, un autre mouvement, qui sait quand, pourra améliorer sa condition et le rendre un peu plus libre.
En somme, la catastrophe est inévitable : ou bien faire un bond en avant, ou bien faire un pas en arrière.
Un observateur qui regarderait les événements qui se précipitent de jour en jour vers cette solution catastrophique, en se tenant assez éloigné pour ne pas être influencé par des espoirs ou des craintes, aurait l’impression de voir deux trains, partis de deux points opposés et roulant à une vitesse toujours plus importante sur la même ligne, donc destinés à se rencontrer tôt ou tard, en un point indéterminé. Le point précis de la collision nous est encore inconnu, on le connaîtra après coup. Toutefois, on sait dès maintenant que le moment du choc se rapproche toujours plus et que rien ne pourra l’éviter, car les deux forces qui vont se heurter ne savent et ne veulent pas l’empêcher. La lutte de classes est en passe de devenir guerre de classes et se terminera bientôt en une première et peut-être décisive bataille entre celles-ci.
Ceux qui, tout en souhaitant le triomphe de la liberté et du prolétariat, pensent encore qu’il est possible d’y arriver par des transactions ou des collaborations avec les forces adverses (ils sont appelés « réformistes » mais ils sont disséminés un peu dans tous les partis), nous font l’effet aujourd’hui d’aveugles et de sourds qui marchent avec des banderoles sur la voie du chemin de fer où va avoir lieu la collision. Par leur geste, ils pensent ainsi pouvoir éviter la catastrophe, ils n’en seront que les premières victimes.
Etant donné que leurs efforts impuissants à arrêter le choc ne peuvent que faire illusion et affaiblir les meilleurs dont les aspirations avoisinent les leurs, la conséquence de leur politique ne pourra être que la défaite de la révolution, de la liberté et du prolétariat, ce qui ne sauvera même pas le peu qui a déjà été acquis et dont les plus accommodants se contenteraient. Avec leurs efforts, les prolétaires, les révolutionnaires, peuvent arracher leur triomphe à l’histoire, mais leur consentement à toute voie médiane fera le jeu de l’ennemi et causera leur propre défaite.
La crise spasmodique que nous traversons va désormais vers sa phase résolutive, par la force des choses, indépendamment de ceux-là mêmes qui l’ont provoquée comme de ceux qui l’ont regrettée.
La guerre nous a précipités dans cette crise, sur laquelle il est bien inutile d’épiloguer, compte tenu que nous n’en sommes pas la cause. Nous reconnaissons que, à cause des difficultés accumulées par la guerre et des séquelles désastreuses de celle-ci, cette crise n’est pas la solution idéale pour les révolutionnaires. La révolution attendue depuis cinquante ans par le prolétariat était une toute autre révolution, riche de toute la richesse accumulée par le travail précédent, et que l’on pouvait enlever à la bourgeoisie lorsque ses greniers étaient pleins. Cependant, il n’existe aucune possibilité de choix, si la révolution se présente, appauvrie de tout ce que la bourgeoisie a dilapidé en cinq ans d’une guerre de destruction et de mort, elle n’en sera pas moins l’unique solution possible de la crise actuelle, ceci d’un point de vue supérieur de civilisation et de liberté.
En ce qui concerne l’Italie plus spécialement, la situation est telle que, même si la classe ouvrière était moins portée sur le changement et la moins révolutionnaire du monde, elle serait quand même poussée à descendre dans la rue par la crise qui s’aggrave. A force d’expédients, entre une tuerie et une autre, le gouvernement réussit à éloigner le moment crucial, mais chaque obstacle qui la retarde rendra la crise plus aiguë, le désespoir plus profond et l’éclatement plus terrible. Qu’il le fasse pour mieux se préparer à étouffer la révolte prolétaire pressentie, ou bien plus simplement pour gagner du temps et vivre au jour le jour, il est certain que l’équilibre actuel est des plus instables et ce serait une illusion de penser que la situation puisse s’améliorer, voire rester telle qu’elle en laissant intacte la structure constitutionnelle de la société.
En Italie, on consomme plus que ce qu’on produit, c’est une réalité. Les ouvriers ont parfaitement raison de ne pas vouloir renoncer à la satisfaction de leurs besoins, comme ils ont raison de trouver que, en travaillant huit heures pour le patron, ils travaillent toujours huit heures de plus que ce qui serait juste, alors qu’ils voudraient bien en travailler douze si c’était pour eux-mêmes. Mais cette excellente raison ne change pas la réalité car, si la société italienne continue à produire de moins en moins et à consommer de plus en plus, on arrivera à un point au-delà duquel on ne pourra plus avancer sinon après avoir interverti les termes, c’est-à-dire travailler plus et consommer moins, et cela que la révolution se fasse ou non.
Si la révolution se fait, cette nécessité sera encore plus grande et urgente, mais il s’agira d’un effort partagé entre tous, plus conséquent parce que les forces seront entièrement consacrées à la production utile, adouci par l’expropriation des richesses enlevées aux riches et mises en commun, surtout rendu supportable par l’idée qu’il s’agira d’un sacrifice bénéfique pour tout le monde et, qui plus est, d’un sacrifice passager. Après cela, il s’établira un bien-être réel pour chaque travailleur, mille fois meilleur que celui que l’on peut espérer de la société bourgeoise.
Si la révolution ne se réalise pas, c’est-à-dire si la bourgeoisie reste maîtresse du pouvoir et de la richesse, la période d’attente se prolongera et les sacrifices pourront être imposés aux travailleurs plus graduellement. Mais pour eux, la faim et la fatigue exténuante seront inévitables, car ils seront toujours les plus faibles, avec cela de pire que ce sera de la fatigue en pure perte, dépensée à reconstruire pour les autres et non pour soi-même. Fatigue après laquelle il ne restera plus rien et il faudra recommencer à arracher aux oppresseurs, miette par miette, un peu de pain, un peu de repos, un peu de liberté. Espérer se soustraire à cette dure destinée sans une révolution, avec les seules et simples grèves pacifiques, partielles ou générales, ne serait-ce que dans le but de garder le peu qui a été jusqu’ici obtenu, serait une illusion folle, suivie bientôt de la plus cruelle des désillusions.
C’est à cause de tout cela que nous voyons aujourd’hui avec une certaine appréhension la série de grèves dans des buts purement corporatifs et économiques. Chaque fois nous nous sentons solidaires des travailleurs et nous leur souhaitons la victoire, mais ensuite nous nous demandons à quoi en réalité ils ont réussi, excepté à avoir obtenu un avantage illusoire pour quelques-uns et rendu plus profond le malaise pour tous. Certes, cela peut servir à rapprocher la fin de la crise, mais alors à condition de ne pas nourrir d’illusions sur la portée des résultats et de se préparer à sortir du contexte des luttes partielles pour une lutte d’ensemble contre le complexe des institutions capitalistes et étatiques.
Cette lutte coûtera certainement davantage de sacrifices et de souffrances, mais par sa victoire, elle donnera à la communauté humaine une plus grande richesse, et lui assurera plus tard une existence digne d’être vécue, la satisfaction de tous les besoins et la jouissance des plus grandes libertés.
La révolution, je le répète, est imposée par la crise économique, politique et spirituelle de toute la société contemporaine, en Italie peut-être plus qu’ailleurs. Les grèves et les tumultes qui se suivent sans interruption et en mouvement accéléré en sont les préavis, les « annonciateurs de la tempête ».
Chaque fois, l’échafaudage social s’effrite un peu, des illusions tombent. On s’approche du point limite où bourgeoisie et prolétariat, gouvernement et peuple, se trouveront face à face, sans plus d’obstacle, sans plus d’intermédiaire, sans aucun isolant. Il n’y a plus de marge ni pour les concessions ni pour l’acceptation. Le surprofit dont on pouvait discuter entre patron et ouvrier avant la guerre est en train de disparaître rapidement et on ne peut plus enlever d’un côté sans un important déséquilibre de l’autre. Ce dont le prolétariat a un besoin urgent et absolu, la bourgeoisie ne peut plus le concéder sans se suicider en tant que classe. Si le prolétariat se contentait de ce qu’il a, s’il cessait de demander ou de résister, il serait contraint sous peu à la faim, à cause des nouvelles hausses des prix. Il serait contraint à vivre, de toute façon, une existence incompatible avec le degré de conscience auquel il sera arrivé.
D’où l’intransigeance à peine voilée de part et d’autre de la barricade, à chaque grève ou conflit partiel, par des tractations pendant lesquelles les uns voudraient ce que les autres jugent excessif, et ceux-ci donneraient seulement ce que les premiers jugent dérisoire. De ce fait, le conflit, assoupi pendant un instant, éclate à nouveau après un bref moment. Et les conflits nouveaux, les tumultes, les grèves se suivent les uns après les autres sans fin, insistants, angoissants. C’est la révolution qui s’approche, dit-on.
Mais cela n’est vrai que jusqu’à un certain point. Il est plus réel en tant que désir qu’en tant que fait. Nous avons parlé – tout le monde en a parlé – d’une situation révolutionnaire, mais il serait plus exact de dire que la situation était plus simplement catastrophique. Il faut donc penser qu’une catastrophe peut précipiter dans 29 un sens révolutionnaire aussi bien que dans un sens réactionnaire, et que si la volonté humaine est impuissante à créer des situations données précises, il arrive un moment, l’instant fugitif, où d’une volonté précise peut dépendre la résolution des plus importantes crises historiques dans un sens comme dans l’autre.
Pour que la révolution triomphe, afin que s’étant faite elle ne soit pas tronquée, limitée ou étouffée à son commencement, afin qu’elle soit sociale et humaine dans toute l’acceptation du mot, il faut qu’intervienne la volonté des hommes pour la diriger, pour la vivifier de son esprit idéaliste. Le choc entre les forces adverses est inévitable, et dans ce sens, la révolution revêt aujourd’hui, en tant que conséquence de faits passés, un certain caractère de fatalité. Mais il serait erroné et funeste de croire que la fatalité du choc entre prolétariat et bourgeoisie, entre peuple et gouvernement, se solde fatalement par la victoire du peuple et du prolétariat sur le gouvernement et la bourgeoisie.
Le triomphe est bien loin d’être fatal. Il sera la prime pour l’effort volontaire accompli. Effort qu’il faut préparer en ayant présent à l’esprit ce que l’on veut et la voie que l’on entend parcourir pour l’obtenir.
Le problème de l’État
Tous ceux qui examinent les conditions dans lesquelles pourrait avoir lieu, prochainement, une éventuelle révolution, oublient presque totalement la question de l’État : c’est-à-dire les rapports entre l’État et la révolution, et non seulement avant l’ouverture des hostilités – quand il n’y a plus d’autre rapport concevable que le conflit et la lutte armée entre l’État capitaliste et le prolétariat révolutionnaire – mais aussi des rapports qui devront s’établir entre la révolution qui aura abattu l’ancien régime et tout gouvernement qui se constituera très probablement sur les ruines de l’ancien, et cela dès le premier instant de la constitution du nouveau gouvernement.
Le peu d’attention que l’on prête à cet aspect pourtant si important du développement de la révolution, est la conséquence d’une évaluation imparfaite et incomplète de la question, d’un point de vue général, de l’État en tant que tel. Et cela non seulement vis-à-vis de la révolution, mais de tous les événements historiques actuels et précédents. Erreur qui a été répétée de part et d’autre, avec les mêmes résultats en ce qui concerne l’étude des causes et des effets de la dernière guerre mondiale. On n’a pas vu cela avec une clarté suffisante (et on a fini par en dissimuler l’importance) : quand et comment l’organisation des rapports et intérêts sociaux dans une constitution étatique (sous forme « gouvernementale », comme disent les Français) influe sur les événements et les détermine dans un sens ou dans l’autre.
De là, la nécessité d’attirer l’attention des lecteurs sur ce problème, afin qu’ils puissent se placer du même point de vue que le nôtre, lorsque nous examinons les événements. C’est un point de vue qui nous semble moins imparfait que tous les autres, non pas que notre vérité particulière soit meilleure, mais parce que, sans nier celle des autres, nous y ajoutons une vérité de plus. En un mot, nous sommes plus complets en regardant les questions qui nous intéressent sous des aspects que d’autres laissent dans l’ombre. Deux tendances naturelles, dans l’homme, empêchent la vision exacte des choses et la perception des réelles nécessités qu’il faut affronter en cas de révolution : la tendance à trop simplifier chaque problème et à réduire les questions les plus complexes et les causes les plus disparates à une question et à une cause uniques et la tendance à choisir les voies les plus commodes, moins embarrassantes et plus à même de recueillir le consensus des adversaires ou des indifférents, même si ces voies, et bien malgré nous, nous éloignent en réalité de notre but, ou même nous en écartent considérablement.
Ce sont là des tendances, pour ainsi dire, instinctives, dont il faut tenir compte, et qu’il ne faut pas repousser d’une manière trop absolue. Simplifier les questions signifie aussi rendre possible une action précise et décisive, impossible à réaliser s’il fallait d’abord discuter et résoudre d’une manière certaine tous les doutes qu’elle suscite tour à tour. En plus de cela, la tendance à choisir la voie la moins désagréable répond à un besoin d’économie des forces et au désir d’obtenir le maximum avec un minimum d’efforts. Il faut cependant comprendre que si on se laissait entraîner par ces deux tendances sans retenue, qui en elles-mêmes s’expliquent et peuvent, jusqu’à un certain point, nous être utiles, nous finirions par perdre de vue les nécessités réelles de la lutte et de sa finalité ; nous travaillerions inutilement, voire même avec des résultats contraires à ce que nous souhaitons.
Dans le mouvement ouvrier et révolutionnaire européen, surtout dans celui à tendance socialiste, mais aussi en partie parmi les éléments anarchistes, ce phénomène de déviation s’est manifesté là où il n’existait pas et s’est accentué là où il existait déjà : et cela à cause d’une mentalité plus accessible aux arrangements et aux transactions, qui s’est formée sous la pression coercitive de la guerre. Un climat de guerre, du fait des gouvernements militaires, ne favorise pas les attitudes révolutionnaires trop radicales, l’effort pour s’adapter à une ambiance horrible tout en réagissant aux forces mauvaises prédominantes a influencé beaucoup de monde et a proprement déterminé l’oubli des principes fondamentaux de la révolution sociale.
Je ne veux pas, ici, faire allusion au déviationnisme de tant de révolutionnaires, quelques anarchistes y compris, qui, en Italie, pendant la période de sa neutralité, avaient pris le nom d’« interventionnistes ». Leur sens partisan et leur possibilisme ont fait en sorte que la plus grande partie d’entre eux s’est retrouvée carrément hors de l’orbite socialiste, anarchiste ou révolutionnaire. Les dommages qu’ils ont provoqués ont été nombreux et assez évidents pour qu’on n’ait pas besoin de les démontrer[7].
Cependant, à partir de 1914, en Italie, presque exclusivement parmi les socialistes qui avaient une certaine prédisposition, et très peu parmi les anarchistes, une autre déviation en sens contraire, que nous appellerons « neutraliste » ou « pacifiste », a vu le jour. Celle-ci, pendant la guerre, a été un peu moins accentuée et dangereuse, mais a commencé, peu après, elle aussi, à empoisonner le mouvement révolutionnaire, justement parce qu’à ses débuts son incohérence n’avait pas encore été ressentie.
L’aspiration, plus que légitime, à la cessation de la guerre, en même temps que le désir de trouver la plus large adhésion, ont fait accepter, en cette période, des idées qui oscillaient entre le pacifisme bourgeois et le neutralisme de l’État ; tantôt plus ou tantôt moins accentuées, mais qui s’inspiraient en grande partie du concept démocratique et étatique du socialisme autoritaire et marxiste. Il n’y aurait rien d’étonnant si cela s’était produit seulement parmi les socialistes, mais le même état d’esprit a germé aussi chez certains qui se disaient anarchistes, spécialement en France, et un peu en Allemagne. Cela, cependant, ne s’est pas réalisé, tout au moins de manière évidente, en Italie. Ces idées sont pourtant restées et sont soutenues par beaucoup de monde, tout spécialement quand on discute des causes et des effets de la guerre.
Un symptôme à peine perceptible de déviation est apparu dès la fin de 1914, à Paris, dans le manifeste Pour la Paix, de Sébastien Faure. Sous certains aspects très courageux et inspiré par les plus nobles sentiments humains, le manifeste laissait déjà entendre que l’on pouvait obtenir une paix durable de par la seule bonne volonté des gouvernements, et cela, grâce à la médiation de puissance neutres comme l’Italie et les États-Unis (on a vu par la suite quelle sorte d’intervention pacifique fut la leur !), et aussi par l’œuvre des diplomates des États en guerre, réunis autour d’une table de négociation. Mais ce que savaient faire les diplomates dans les tractations de paix, cela aussi on l’a vu par la suite. Déjà à ce moment-là nous avions remarqué l’erreur[8] et y avions à peine fait allusion parce qu’il fallait alors s’occuper de bien d’autres et plus graves erreurs et dissensions. Cependant dans cette erreur, alors juste au début et sans grande importance, était en germe l’oubli de cette vérité, que l’on ne peut rien attendre de bon de l’État sans que cela soit annulé par autant de mal.
Ce même oubli, nous le retrouvons six ans après, encore plus profond, dans le camp même des révolutionnaires, dans les déclarations d’un anarchiste allemand, Erich Mühsam, qui voudrait justifier son acceptation de la dictature prolétarienne et son entrée dans le Parti communiste autoritaire parce qu’il le croit « indispensable pour la conquête du pouvoir » [9] ; c’est-à-dire pour cette même raison qui conseillerait de repousser la méthode adoptée par lui-même.
On usait peut-être d’un certain langage pendant le conflit pour donner au mouvement de résistance à la guerre les moyens de ne pas buter contre la censure ou les réactions policières. Mais ce langage a fini insensiblement par faire accepter une solution étatique de la guerre qui, pour aussi sympathique qu’elle fut, n’avait pas d’application possible, et surtout pas anarchiste ou révolutionnaire.
Cette tendance, même quand elle s’est faite plus hardie, n’a jamais été au-delà de l’affirmation marxiste et sociale-démocrate de la lutte de classes et du déterminisme économique.
La principale erreur, en ce qui concerne les causes de la guerre et la possibilité de la résoudre par une paix durable, consistait, et consiste encore, dans le fait de considérer la question sans tenir compte du problème de l’État, c’est-à-dire sans tenir compte que l’une des causes principales du long conflit tout récent a été l’existence des États et qu’il n’y aura jamais de paix véritable et durable tant que l’État existera.
Certains supposent la possibilité d’une paix stable et de longue durée, même avec la constitution étatique actuelle de la société, croyant qu’il suffit pour la garantir de pactes, du recours au référendum populaire, du désarmement, ou bien d’une plus juste répartition des richesses, etc. S’il en était ainsi, tout idéal révolutionnaire serait superflu, ou le deviendrait, car la question de la paix ou de la guerre dans les sociétés humaines ne peut être vraiment résolue si on ne résous pas, en même temps, la complexe question sociale. La première résolution implique la seconde.
Mais en réalité, il est impossible de résoudre la question sociale dans un sens qui assurerait à tous les hommes le bien-être et la liberté, si, sous une quelconque forme, on laisse subsister d’une part le monopole des richesses, et donc de l’exploitation de l’homme par l’homme, et d’autre part le monopole du pouvoir, ou, autrement dit, l’autorité coercitive de quelques hommes sur tous les autres, si l’on ne libère pas la société humaine de la double tyrannie du capitalisme et de l’État. L’État est un organisme qui gouverne par la violence ou par la menace de la violence, par le truchement d’une force qui lui a été confiée (peu importe de savoir comment) par les citoyens, mais tous doivent lui rester assujettis. C’est l’arbitraire codifié, tant sur le plan économique que sur le plan politique.
L’étude des causes de la guerre et de son déroulement a démontré cela d’une façon très claire. De là, donc, la nécessité de l’abolition de l’État et la nécessité d’une organisation sociale nouvelle, basée sur la libre coopération ; but qui, bien entendu, ne peut être séparé de la solution socialiste ou communiste du problème économique, car une société vraiment libre ne serait pas réalisable si l’on ne pouvait assurer à chacun de ses membres la satisfaction de ses besoins matériels. Pietro Gori avait l’habitude de dire : « Le socialisme est la base économique, et l’anarchie est le couronnement politique. »
Dans le premier numéro d’une revue parisienne qui adhère aux idées socialistes maximalistes des bolchéviques russes, un écrivain français assez connu dans le monde anarchiste, André Girard, disait : « Les causes profondes de la guerre, voire même de toutes les guerres, peuvent se synthétiser dans le droit de l’appropriation de la terre et de ses biens [10]. » Et il disait vrai, mais seulement la moitié de la vérité. Il aurait dû ajouter : « Et dans le droit de l’appropriation de la liberté. » Car l’exigence de l’État implique la confiscation de la liberté des citoyens. Les seuls à être vraiment libres dans un régime autoritaire étant ceux qui commandent. De la même façon, l’existence du capitalisme implique la confiscation des richesses, qui reviendraient de droit à tous les travailleurs et à eux seulement.
La cause de tous les maux sociaux, la guerre y compris, est donc simple : privilège économique (ou autorité des patrons sur les ouvriers) et privilège politique (ou autorité du gouvernement sur les gouvernés).
Réduire toute l’affaire à l’unique interprétation matérialiste, en tenant compte du seul facteur économique, est donc une erreur. Par exemple, il y a des aspects de la dernière guerre qui ne peuvent pas être expliqués par le seul déterminisme économique marxiste. Tous les impérialismes ne sont pas à prédominance capitaliste, ou pas tout à fait. Dans plusieurs pays on donne la priorité, ou tout au moins son influence est limitée par les intérêts dynastiques, intrigues diplomatiques, appétits des castes bureaucratiques et militaires, etc., qui peuvent être englobés sous le nom d’« intérêts d’État ».
Dans certaines nations, l’intérêt d’État, en précipitant les événements vers la guerre, a pesé plus que l’intérêt capitaliste ; dans certains autres, le facteur politique a pesé au moins autant que le facteur économique ; de même que dans d’autres, ce dernier a eu un poids prédominant. Dans certains pays comme l’Autriche, la Russie, l’Italie et un peu l’Allemagne aussi, certains partis, castes ou gouvernements ont vu dans la guerre le meilleur moyen pour conquérir, garder ou augmenter leur propre pouvoir politique et impérialiste, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pour l’Italie, à moins que l’on ne rabaisse le déterminisme économique jusqu’à y comprendre la vénalité de nos journalistes et hommes politiques, il n’y avait pas un véritable intérêt d’ordre économique de la bourgeoisie à faire la guerre, sinon l’intérêt de pouvoir arrêter, par la guerre, le mouvement socialiste et prolétaire, but éminemment politique. L’intérêt majeur de la guerre (tout au moins comme tentative, car il n’en a pas été ainsi dans les résultats) était celui de la caste militaire, du gouvernement et de la monarchie. La guerre a été la conséquence d’anciennes intrigues diplomatiques, bassement machiavéliques, arrivées à maturation, si bien que l’intervention dans le conflit était devenue une réelle nécessité pour les institutions de la monarchie (et non pas pour le peuple, la liberté, etc., comme déblatéraient les démagogues de l’interventionnisme). En effet, il n’y avait plus que la guerre pour les sauver, elles se trouvaient dans une situation très incommode, prises entre le marteau et l’enclume de l’hostilité des gouvernements étrangers et la menace de la révolution.
Le tsarisme russe voyait dans la guerre une diversion contre l’insurrection débordante de millions d’hommes, le moyen de se sauver en flattant le panslavisme de la bourgeoisie, en ressuscitant le rêve impérialiste de Pierre le Grand. La cour des Habsbourg y voyait l’occasion propice pour élargir son propre domaine, afin d’établir des bases plus solides à l’empire, secoué par les luttes nationalistes et menacé au nord par son allié germanique lui-même. Et l’Allemagne elle-même a cherché dans la guerre, avec les débouchés commerciaux et tous les avantages économiques dont on a tant parlé, un moyen pour consolider le pouvoir impérial contre les pressions démocratiques et socialistes internes et de rehausser par une guerre victorieuse le prestige déjà décadent de sa caste militaire.
Quelque chose d’assez semblable peut être dit aussi à propos de la France « agressée », qui porte une grande responsabilité dans la mise en route de la guerre. Tout le monde sait que l’élection à la présidence de la République de Poincaré a signifié la montée au pouvoir politique d’un élément favorable à la guerre, et non seulement pour des raisons de capital, mais aussi pour l’intérêt de la caste militaire qui, sournoisement, peu à peu, avait pris sa revanche sur l’affaire Dreyfus et avec quelques ex-dreyfusards en tête, avait repris le dessus dans la politique française. Du reste, fin 1898, Kropotkine faisait observer que l’alliance franco-russe, à laquelle on doit en partie la guerre, était le fruit du « césarisme » réactionnaire et du militarisme français, en même temps que des intrigues des cours de Londres, Saint-Pétersbourg et Berlin [11].
Si en Allemagne et en France les raisons « d’État » de la guerre s’équilibrent avec les raisons économiques (même les questions coloniales qui ont beaucoup contribué à provoquer la guerre ont eu souvent un caractère militaire et politique plus qu’économique), si en Russie, en Autriche et en Italie, les raisons furent surtout d’État, il ne faut pas oublier que, en revanche, le facteur économique a été le plus important en ce qui concerne l’Angleterre et les États-Unis. Cela vaut la peine de rappeler, spécialement en ce qui concerne l’Angleterre, ce qu’écrivait en 1912 Kropotkine, qui devait par la suite, malheureusement, oublier certaines vérités : « Soucieuse de maintenir sa suprématie sur les mers, soucieuse surtout de conserver ses colonies pour l’exploitation de ses monopoles, irritée par les succès de la politique coloniale de l’Empire allemand et par le rapide développement de la marine de guerre de celui-ci, l’Angleterre redouble d’efforts pour créer une flotte, telle qu’elle puisse à coup sûr écraser la flotte allemande… La bourgeoisie anglaise fait aujourd’hui avec l’Allemagne ce qu’elle a tenté de faire, pendant cinquante ans ou plus pour arrêter le développement de la puissance maritime de la Russie : une première fois en 1855, avec l’aide de la Turquie, de la France et du Piémont, et la seconde fois, en 1904, en lançant le Japon contre la flotte russe et son port dans le Pacifique. Et c’est pour cela que depuis deux ans nous vivons dans l’appréhension d’une très grande guerre européenne, qui peut éclater du jour au lendemain [12]. »
Mais laissons cela. Nous avons juste fait allusion aux causes complexes de la dernière guerre, sans prétendre en aucune façon le faire d’une manière exhaustive, ou simplement suffisante. Nous avons nommé quelques nations, seulement pour simplifier, mais toutes proportions gardées et à quelques exceptions près – car d’État à État il y a toujours et en toutes choses quelques différences – mais on comprend bien qu’il est toujours égal à lui-même.
Nous ne voudrions cependant pas être mal compris, en parlant du facteur « étatique » de la guerre, comme de tout autre événement historique, nous ne voulons pas parler d’un fait séparé, distinct ou forcément et toujours en contraste avec le facteur économique[13]. L’un et l’autre se relient, s’entrelacent et sont souvent inséparables, même aux yeux des plus méticuleux chercheurs de distingos. C’est peut-être cela qui rend possible, et acceptable en surface, l’erreur des ultra-marxistes, lesquels voient dans toute l’histoire humaine – et selon la parole d’Engels – « rien d’autre que la plus ou moins claire expression des luttes entre les classes sociales [14] ». L’existence d’autres facteurs n’est, d’après eux, qu’une dépendance et un effet, tandis qu’en réalité ces facteurs ne sont souvent que des causes concomitantes. Mais cela n’empêche pas que l’un ou l’autre de ces facteurs historiques prenne le dessus.
Comme exemple des variations, dans le temps, de l’importance réciproque des différents déterminants historiques, on rappellera que entre le début de la guerre et le commencement de la révolution russe, celui à caractère économique était prédominant à l’ouest, tandis que celui à caractère politique et impérialiste était prédominant à l’est. Puis le phénomène a semblé se renverser, mais partout les deux facteurs ont continué à coexister. Les marxistes ne pouvaient pas voir cela, car ils ont toujours négligé le problème de l’État, et l’ont toujours subordonné, de manière excessive (et même quand il était prédominant), comme moins important et dépendant de la propriété.
Les intérêts économiques ont sans doute influencé l’avènement de la guerre, après l’avoir préparée. Leur influence, en ligne générale, a même été prépondérante. Mais si, à côté de ces intérêts, les intérêts politiques et d’État n’avaient pas opéré leur pression, les premiers n’auraient peut-être pas suffi (tout au moins dans certaines nations), d’autant plus que dans chaque pays les intérêts qui pouvaient être favorisés par la guerre étaient contrebalancés par les intérêts, non moins formidables, auxquels la guerre aurait nui. Mais contre ceux-ci et en faveur de ceux-là, se sont alignés, pour des intérêts spécifiques à eux, les gouvernements qui par le poids de leur épée ont fait pencher la balance du côté de la guerre. Le fait que certains de ces gouvernements se soient trompés dans leurs calculs et aient recueilli de la guerre des fruits très amers, comme en Allemagne, en Russie, en Italie, en Autriche, cela n’a pas beaucoup d’importance.
Certains écrivains, pour légitimer la guerre selon le point de vue de leurs gouvernements respectifs, se sont occupés des raisons dynastiques, étatiques, impérialistes et non purement et simplement capitalistes qui ont provoqué la guerre. Mais chacun découvrait de telles causes en ce qui concernait les gouvernements ennemis, et les ignorait pour le sien. Ils disaient, eux aussi, des vérités partielles, mais toutes ces bribes de vérité, mises bout à bout, faisaient ressortir une vérité générale, assez complète pour pouvoir nous servir de guide dans la compréhension de l’ensemble de la guerre. Le grand tort de ces écrivains n’était pas tant celui de nous révéler les infamies et les responsabilités de certains gouvernements d’outre-frontière, mais bien celui de limiter à ces seuls gouvernements leurs critiques passionnées.
Et quand, par la suite, en se basant sur leurs arguments partisans, ils promettaient que la victoire des gouvernements de leur cœur aurait fait en sorte que celle-ci soit la « dernière guerre », s’ils étaient sincères, ils rêvaient vraiment les yeux grands ouverts.
Il est hors de doute que la guerre de 14–18, dont durent encore les séquelles sanglantes, douloureuses et menaçantes, même quand tout sera rentré dans l’ordre, laissera un tel vide, une fatigue telle, un tel découragement, une nausée telle et un tel besoin de repos, qu’il est facile de prévoir une assez longue période de paix. Mais croire qu’une telle paix serait vraiment durable et compatible avec l’existence de l’État n’est qu’illusion. Tous les projets de désarmement, d’arbitrage obligatoire, de Société des nations, d’États unis d’Europe, ou du monde, ne sont que des paroles en l’air qui illusionneront tant que les peuples n’auront pas oublié la leçon actuelle (une paire de générations, peut-être) et tant que de nouveaux intérêts capitalistes et étatiques en conflit ne verront pas dans une nouvelle guerre l’unique solution.
Les mêmes causes ne peuvent que reproduire les mêmes effets. De même que tout ce qui est arrivé de désastreux et d’horrible pendant les cinq dernières années était prévisible et inévitable, étant donné la constitution étatique des sociétés humaines, ainsi, pour l’avenir, on ne pourra avoir une paix « juste et durable » sinon par la résolution libertaire du double problème de la propriété et de l’État, c’est-à-dire tant qu’il ne sera pas assuré à tous les hommes la liberté et le pain, et cela par la socialisation et la mise en commun de tous les biens et l’organisation de la société sur les bases de l’association volontaire.
Une liquidation partielle de la question sociale ne suffirait pas à redonner à l’humanité la paix qu’elle désire ardemment. Même une forme de socialisme d’État, en admettant qu’elle soit capable d’assurer le pain à tous les citoyens, qui laisserait debout, sous un nom quelconque, les gouvernements, ne pourrait assurer la paix, car la constitution étatique impliquerait toujours l’existence ou la formation d’intérêts collectifs pour chaque État, et d’intérêts personnels pour ceux qui détiendraient le pouvoir. Ces intérêts pourraient devenir, et le deviendront avec le temps, antagonistes, et donc causes de futurs conflits entre gouvernés et gouvernants et entre l’un et l’autre État.
Une preuve de l’antagonisme qui peut se créer entre nation et nation (antagonisme qui met en cause les intérêts, réels ou imaginaires, des classes assujetties qui seront les classes dominantes de l’avenir), cette preuve-là, on l’a eue pendant la guerre, par la politique menée par la quasi-totalité des associations des corps de métiers et par de nombreux partis socialistes de tous les pays. Les travaillistes américains et anglais, les organisations allemandes et autrichiennes, les syndicalistes français, et avec eux, les partis socialistes français, allemand et autrichien, ont accepté le point de vue belliciste de leur gouvernement respectif, car ils ont vu ou bien cru voir leur propre intérêt de classe, présent ou futur, coïncider, en matière de guerre, avec ceux de leurs propres classes dirigeantes.
Ces grandes associations autoritaires et légales de travailleurs sont déjà, en miniature, les États centralisateurs socialistes de demain et présentent, dès maintenant, les défauts inhérents à toutes formes d’État ou de gouvernement, qu’il s’agisse de monarchie ou de république, de démocratie parlementaire ou constituante, de dictature militaire ou de dictature du prolétariat, de comité de salut public ou de commissariat des soviets.
La grave erreur des différents partis socialistes, mis à part celui anarchiste, consiste dans leur vision très peu claire de la question de l’État ; d’aucuns voient dans l’État un organisme à conquérir, utile pour administrer l’avenir de la société socialiste ; certains autres ne donnent aucune importance à la question de l’État tout en repoussant toute idée de socialisme d’État ; d’autres encore, qui par leurs aspirations se rapprochent davantage des anarchistes, haïssent l’État mais le considèrent seulement comme un simple rouage de la machine capitaliste, destiné à tomber avec la destruction de la machine. Ces derniers, donc, croient eux aussi parfaitement inutile de se préoccuper du problème de l’État.
Ce manque d’intérêt pour la question suscite comme conséquence un faible développement du sentiment de liberté, ou encore que le parti attire dans ses rangs de nombreux éléments antilibertaires. La conquête de la liberté, pour eux, est presque un mot vide de sens. Parfois, ils arrivent à voir dans la liberté une force antagoniste du socialisme. D’après eux, il est inutile, peu scientifique et même utopiste de se préoccuper de la conquête de la liberté, car « elle viendra toute seule » une fois la question économique résolue.
Déjà au temps où Marx attaquait Proudhon, les socialistes démocrates considéraient les revendications libertaires des anarchistes contre l’État comme des préoccupations de « petits-bourgeois ». Et Filippo Turati, en accord avec Pleckanov, avait dès 1893 défini l’anarchisme comme « une exagération de l’individualisme bourgeois ». Son caractère méprisant mis à part, cela est au fond vrai puisque les anarchistes portent aux dernières conséquences possibles, logiques et pratiques, les idées de liberté des révolutions passées et restées jusqu’ici d’inutiles expressions littéraires, ou alors un privilège exclusif des classes dominantes. Mais le mépris avec lequel en parlent les sociaux-démocrates dissimule très mal leur aversion instinctive pour la liberté, la vraie liberté, qui ne peut être confondue avec la liberté de voter et de mourir de faim en régime capitaliste.
Les anarchistes pour qui la conquête de la liberté est au moins aussi importante que la conquête du pain, voient dans l’État un ennemi ; non seulement parce qu’aujourd’hui il est le frère siamois du capitalisme, non seulement parce qu’il est l’agent d’affaires de la bourgeoisie et le chien de garde de la propriété privée (comme l’affirment habituellement les marxistes en disant seulement la moitié de la vérité), mais parce qu’il représente de par lui-même un mal et une tyrannie, indépendamment de sa fonction d’allié et de soutien de la classe des patrons.
L’État, c’est-à-dire l’institution gouvernementale qui fait les lois et les impose par la force coercitive, par la violence ou la menace de la violence, a une vitalité propre et constitue, avec ses composantes stables ou éligibles, avec ses fonctionnaires et ses magistrats, avec ses gendarmes et avec ses clients, une véritable classe sociale à part, divisée en autant de castes qu’il y a de ramifications de son pouvoir. Cette classe a des intérêts spéciaux, bien à elle, parasitaires et usuriers, en conflit avec ceux de la collectivité restante que l’État prétend représenter.
Cette énorme pieuvre est l’ennemie naturelle de la société d’où elle tire son aliment. Même en régime capitaliste, où l’État est l’allié naturel et la garantie matérielle, armée, du privilège économique, il n’y a pas que les seuls travailleurs conscients à voir dans l’État un ennemi. Une partie de la bourgeoisie aussi éprouve de l’aversion pour lui, car elle voit dans le gouvernement un concurrent qui lui vole, par la fiscalité, une partie de ses bénéfices, et l’empêche d’exercer et de développer, au-delà de certaines limites, son œuvre d’exploitation. Il suffit de se rappeler à ce propos certaines tirades contre l’État de Bastiat, de Spencer, etc., qui n’étaient pourtant pas des anarchistes.
Ces écrivains bourgeois, cependant, ne vont pas jusqu’aux dernières conclusions de leurs critiques : ils considèrent que l’État est un mal nécessaire… pour défendre les privilèges de la propriété contre les travailleurs. Ces sociologues bourgeois veulent tout simplement limiter les fonctions de l’État à celle de gardien armé de la propriété, et ils se gardent bien, en conséquence, d’en prôner l’abolition.
Mais ils font une grave erreur. l’État, en tant que dépositaire de la plus grande force matérielle, détient un trop grand pouvoir dans ses mains pour s’adapter à être le simple gardien des capitalistes et leur rester assujetti. Le capitalisme, en revanche, trouve dans l’État un allié, aussi puissant que lui, avec qui il partage les dépouilles de l’exploitation et de l’oppression au détriment des classes assujetties. Mais l’État, quand il le faut, fait preuve d’indépendance vis-à-vis de son allié. Le cas n’est pas rare (en des circonstances spéciales et quand la stupidité des sujets le permet) où il cherche chez les exploités eux-mêmes ou parmi certaines de leurs catégories, une aide au détriment de la classe exploitante, afin de se maintenir au pouvoir contre des rivaux préférés par cette dernière.
Bien entendu, ce sont là des disputes qui se résolvent bientôt sur le dos des travailleurs. Capitalisme et État redeviennent vite amis, comme larrons en foire. Mais cela, les socialistes autoritaires ne le comprennent pas, ou tout au moins, s’ils le comprennent, ils basent sur les conflits passagers entre le capitalisme et l’État leur espoir illusoire de se servir utilement de l’État dans la lutte contre l’exploitation, et d’en faire, à l’avenir, après l’avoir conquis, le gérant suprême de la propriété socialisée. Cela représente une grave erreur (la même, bien qu’en sens opposé, que celle des critiques bourgeoises de l’État), même si leur intention est de limiter les pouvoirs de l’État, d’éliminer certaines de ses attributions actuelles, d’amputer la pieuvre de certaines de ses tentacules ; même s’ils espèrent que la fonction de l’État disparaîtra après avoir, par la force de leur autorité, supprimé le privilège économique.
Intention illusoire et vain espoir ! Amputer la pieuvre étatique de certaines de ses tentacules signifie la voir renaître à chaque fois plus menaçante. Ne pas la frapper directement à la tête, mais se limiter à attaquer simplement le capitalisme, son allié, cela signifie se condamner aux travaux de Sisyphe.
« Si le capitalisme était détruit, tout en laissant subsister un gouvernement, celui-ci, par la concession de toutes sortes de privilèges, le créerait à nouveau car, ne pouvant contenter tout le monde, il aurait besoin d’une classe économiquement puissante qui l’appuierait, en échange de la protection légale et matérielle qu’il en recevrait[15]. »
« Il ne sert à rien, écrivait Malatesta il y a plus de vingt ans, de dire que quand il n’y aura plus de classes privilégiées le gouvernement ne pourra qu’être l’organe de la volonté collective. Les gouvernants constituent eux-mêmes une classe, et entre eux il s’établit une solidarité de classe, bien plus puissante que celle qui existe dans les classes fondées sur les privilèges économiques. Il est vrai qu’aujourd’hui le gouvernement est le serviteur de la bourgeoisie, plus parce que ses membres sont des bourgeois que parce qu’il est gouvernement ; au reste, en tant que gouvernement, lui, comme tous les serviteurs, trompe son patron et le vole.
« Celui qui est au pouvoir veut y rester et veut à tout prix faire triompher sa volonté, et, étant donné que la richesse est un instrument très efficace de pouvoir, le gouvernant, même s’il n’abuse et ne vole pas personnellement, fomente autour de lui la création d’une classe qui lui doit ses propres privilèges et serait intéressée par sa permanence au pouvoir. Les partis de gouvernement sont, dans le camp politique, l’équivalent des classes propriétaires dans le camp économique.
« … Propriété individuelle et pouvoir politique sont deux des anneaux de la chaîne qui emprisonne l’humanité. On ne peut pas se libérer de l’une sans se libérer de l’autre. Abolissez la propriété individuelle sans abolir le gouvernement, et celle-là se reconstituera par l’œuvre des gouvernants. Abolissez le gouvernement sans abolir la propriété individuelle et les propriétaires reconstitueront le gouvernement.
« Lorsque F. Engels, peut-être pour parer à la critique anarchiste, affirmait que les classes une fois disparues, l’État proprement dit n’aurait plus de raisons d’être, et se transformerait de gouvernement des hommes en administration des choses, ne faisait qu’un jeu de mots, vide de sens. Ceux qui ont la maîtrise des choses ont aussi la maîtrise des hommes ; ceux qui gouvernent la production gouvernent aussi les producteurs ; qui mesure la consommation est le seigneur du consommateur.
« La question est la suivante : les choses sont administrées selon les libres pactes des intéressés et par les intéressés eux-mêmes, et alors c’est l’anarchie, ou bien elles sont administrées selon la loi faite par les administrateurs, et alors c’est le gouvernement, c’est l’État, et fatalement c’est la tyrannie [16]. »
Si le socialisme autoritaire laisse debout l’État, des formes d’exploitation restent possible et même inévitables. Pour preuve, quand les sociaux-démocrates ont voulu concrétiser une forme d’organisation économique future, ils ont inventé le collectivisme. Le collectivisme est cette forme de salariat subordonné à l’État, que Kropotkine a si bien critiqué dans un chapitre bien connu de La Conquête du pain [17]. Les socialistes n’ont-ils pas considéré comme étant la véritable « quintessence du socialisme » cet idéal de caserne germanique, exposé comme tel dans un opuscule reproduit et traduit par les soins des socialistes dans tous les pays. Il était dû à la plume point socialiste de Schaeffle [18].
On dirait que même dans les constructions idéologiques (où il est beaucoup plus aisé que dans la réalité pratique de concilier l’inconciliable), il est impossible d’imaginer une émancipation économique complète et une vraie liberté des travailleurs sous la tutelle de l’État.
« L’humanité s’est laissée longtemps, trop longtemps gouverner, et la source de ses malaises ne réside pas dans le fait de telle ou telle autre forme de gouvernement, mais dans le principe et dans le fait même du gouvernement, quel qu’il soit[19]. »
Ainsi s’exprimait Bakounine dès 1871. Et rien n’a démontré que Bakounine avait tort, ni le cours des années depuis ce moment-là jusqu’à aujourd’hui ni l’évolution, qui à nos esprits angoissés a semblé encore plus longue, de la guerre mondiale ; ils ont même démontré le contraire, ont validé et mis en évidence cette profonde vérité.
Dans cette vérité réside la base fondamentale, la caractéristique principale de l’anarchisme. Voilà pourquoi les anarchistes, à quelques exceptions près, ne sont pas tombés, pendant la guerre, dans l’erreur d’oublier que la paix des gouvernements n’aurait jamais pu être la paix des peuples. En réalité, si les anarchistes étaient opposés à la guerre, ce n’était pas parce qu’il s’agissait d’une « guerre », mais parce qu’elle n’était pas leur guerre, la guerre pour la liberté et pour le prolétariat.
La lutte contre l’État, ainsi que la lutte contre toute forme d’autorité coercitive et violente de l’homme sur l’homme, au nom de la liberté individuelle, pour la formation d’une société nouvelle fondée sur l’entraide : voilà la raison d’être de l’anarchisme. Car les anarchistes étant des socialistes, ils ont aussi la fonction de combattre le capitalisme « ça va sans dire » (en français dans le texte) ; mais leur fonction spécifique, en tant qu’anarchistes, est de combattre l’autorité étatique, non seulement dans ses manifestations en ce qui concerne le régime capitaliste, mais aussi dans sa propre nature de pouvoir gouvernemental.
Si on n’exerce pas cette fonction, on pourra être démocrate, socialiste, syndicaliste, ce que l’on voudra, mais l’on ne pourra jamais être anarchiste.
Si ces idées sur l’État et sur la fonction de l’anarchisme n’étaient qu’une exhumation doctrinaire, en dehors de toute réalité, et à caractère purement spéculatif, on aurait alors bien raison de les ignorer, pendant que tout un monde s’écroule autour de nous, dans la crise la plus grave que l’humanité ait jusqu’ici connu. Mais il s’agit d’idées dont la démonstration pratique est faite jour par jour, et desquelles peut surgir, selon qu’on les pratiquent ou non, une ligne de conduite bonne ou mauvaise. Elles constituent, pour ainsi dire, la boussole qui aiderait à se diriger dans la tempête, à éviter les écueils et le naufrage, vers le port calme de la véritable paix humaine.
L’idée anarchiste, anti-étatique et révolutionnaire, est le meilleur guide pour une action vraiment efficace, dans l’immédiat ou dans le futur, pour délivrer le prolétariat de son état d’esclavage ; et dans le même temps, elle constitue le meilleur point de vue pour juger les événements et les situations qui se succèdent et évoluent au fur et à mesure sous nos yeux. Ceux qui, pendant la guerre, ne possédaient pas ou bien avaient perdu cette boussole, se sont trouvés désorientés, ils ne voyaient plus la réalité dans son ensemble, ou bien en la perdant de vue, ils ne savaient plus eux-mêmes ce qu’ils voulaient et cédaient tour à tour aux suggestions les plus disparates du moment comme des bateaux sans rames et sans timon, que les vents et les vagues poussent tantôt à droite et tantôt à gauche.
En plus de ceux qui s’étaient fait les partisans des gouvernements belligérants, en succombant ainsi au pire des naufrages, d’autres ont dévié dans le sens opposé. Certains, émus par la voix sympathique et si humaine de Romain Rolland, rêvaient de la possibilité d’une paix combinée par les gouvernements. D’autres, qui admiraient avec raison la courageuse initiative socialiste de Zimmerwald et Kienthal (qui possédaient en effet une extraordinaire valeur morale et civique) ne s’étaient cependant pas aperçus que « Zimmerwald a voulu reconduire l’Internationale à ce qu’elle était avant 1914 [20] » et y adhérèrent de bon cœur. Et cela malgré le fait qu’à Kienthal, la tactique autoritaire et de conquête du pouvoir politique, qui avait en partie causé la faillite de l’Internationale socialiste en 1914, eut été reconfirmée. Et je ne parle pas de ceux qui, après une insuffisante évaluation du problème de l’État, et animés par les dernières illusions sur la démocratie de leur propre pays, ont fait croire pour un instant, sur la fin de 1918, que la défense de la liberté pouvait, par exemple, s’identifier, en France, avec la défense d’un ministre sans scrupules comme Malvy, lequel s’était aidé, contre la classe ouvrière et pour corrompre les hommes, des pires systèmes d’espionnage, de trafic d’influences et de chantage. D’autres encore avaient réduit tout leur esprit révolutionnaire aux termes minimes de l’intransigeance socialiste dans l’orbite de la politique étatique, en s’arrêtant aux idées de Marx et de Jaurès.
Toutes ces conséquences de la désorientation produite par la guerre, et par la nonchalance et l’oubli du problème étatique, ne sont plus visibles maintenant, car elles ont cessé ou bien se sont résolues d’elles-mêmes, ou ont été dépassées ou annulées par d’autres événements. Même le socialisme de Zimmerwald, cette lumière qui brilla un moment si vivement et bénéfiquement, aujourd’hui a pâli et n’a plus qu’une valeur de souvenir historique. La révolution russe, par son développement renversant, l’a dépassé.
Mais la révolution russe elle-même, par le prestige de son succès et le climat de mystère dans lequel l’a tenue enveloppée pendant trois ans le bloc imbécile de la bourgeoisie occidentale, a propagé dans le monde, sous une autre forme, l’erreur autoritaire et étatique. L’expérimentation de la « dictature prolétaire » qui, en Russie, n’est pas encore achevée, a déjà, pour beaucoup de révolutionnaires la valeur d’une vérité acquise et définitive, et ils acceptent (et parmi eux beaucoup qui auparavant la repoussaient) sans autre forme de procès, l’idée de l’État en tant qu’instrument révolutionnaire.
La révolution russe les a enivrés de joie, comme elle nous a du reste tous enivrés. Mais une évaluation insuffisante du problème de l’État les empêche de voir clair dans les grands événements de l’orient européen. Et à cause de cela, ils ont perdu de vue le véritable intérêt de toute révolution, c’est-à-dire celui de rester libre de tout lien légal et étatique. Esclaves du fait accompli, ils ne s’aperçoivent pas que c’est justement dans les faits que réside la démonstration que la conquête du pouvoir peut avoir des conséquences antirévolutionnaires, et ce malgré les intentions les plus révolutionnaires des hommes montés au pouvoir. Car chaque gouvernement est un principe de réaction, même s’il se dit démocratique, ouvrier et socialiste. Les gouvernants les mieux intentionnés à servir la révolution sont condamnés à l’impuissance ou même à agir, la plupart du temps, en contradiction avec leurs propres idées.
La révolution sociale par l’État est une contradiction dans les termes, car il ne s’agit pas de substituer une dénomination par une autre, comme dans les révolutions passées, mais d’abolir toute domination de l’homme sur l’homme, et c’est donc le pouvoir gouvernemental qu’il s’agit d’abolir, et donc de combattre comme un ennemi. La révolution consiste donc en une lutte continuelle contre l’État, tant qu’il existe et quelle que soit la forme qu’il revêt ; elle consiste à en empêcher le fonctionnement et à en diminuer au maximum le pouvoir et certainement pas à lui confier les fonctions les plus délicates de la vie sociale et le développement de cette même révolution, qui devrait le détruire.
La dictature qui est la forme de gouvernement absolu et centralisé, même quand elle prend le nom de dictature prolétarienne ou révolutionnaire, est donc la négation en puissance de la révolution. Après avoir abattu les anciennes dominations, c’est encore l’État-tyran qui renaît de ses cendres.
Du socialisme autoritaire au communisme dictatorial
Après la révolution russe, le problème de l’État doit être étudié dans le sens de l’application la plus stricte de son rôle dans la révolution, c’est-à-dire la dictature ; car les socialistes, en grand nombre, qui pensent aujourd’hui à la révolution comme à quelque chose de possible et d’imminent, ont concrétisé dans la formule « dictature du prolétariat » les idées du socialisme autoritaire qu’ils ont propagées depuis Marx.
Avant 1917 ils n’avaient pas d’idées très claires à ce propos, beaucoup d’entre eux parlaient indifféremment de « constituante révolutionnaire », de « dictature prolétarienne », de « république sociale », etc., sans voir parmi ces diverses expressions des différences et des contradictions trop criantes. A partir de 1917, les faits ont contraint les socialistes à préciser leurs idées et, sous l’influence de la révolution russe, ils les ont précisées en suivant les traces de celles qui semblaient avoir le plus grand succès en Russie. Il est vrai qu’il y a des socialistes qui n’acceptent pas l’idée d’une révolution dictatoriale ; certains, d’extrême gauche, très peu, sont fort proches des anarchistes[21] par des préoccupations libertaires semblables ; d’autres, plus nombreux, de l’aile droite, pensent encore à une évolution « révolutionnaire » graduelle, s’accomplissant par des expériences social-démocrates, par des constituantes, par la collaboration, bourgeoise, etc.
De la constituante, nous en parlerons plus tard comme d’une forme de développement révolutionnaire mais toujours autoritaire, toujours, substantiellement dictatoriale. Pour le moment nous étudierons l’idée de la « dictature du prolétariat », qui a eu le plus grand succès dans le consensus spirituel de la plupart des socialistes révolutionnaires dans le monde car dans cette idée nous pouvons voir actuellement le germe qui peut tuer à sa naissance la révolution, ou bien en arrêter, en limiter ou en dévier le développement. Pour étudier l’idée : de dictature, nous ne pouvons pas faire abstraction de ce qui s’est passé et se passe en Russie, où se déroule l’expérience dictatoriale : de la révolution. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les informations qui nous renseignent sur elle et sur ce que sont les bolcheviks russes, qui constituent là-bas le parti dominant et de gouvernement. Cela entraîne un droit de critique, que nous nous étions volontairement interdit jusqu’ici par opportunité révolutionnaire. Mais il nous semble désormais qu’il puisse être exercé sans danger d’être mal interprété ou pire, d’être exploité par les ennemis de la révolution.
La Russie révolutionnaire a désormais vaincu les difficultés extérieures créées, avec le blocus et la guerre, par les États capitalistes qui oppriment les nations occidentales[22]. Sa victoire, non seulement nous rend le droit de critiquer, mais elle nous en fait un devoir, notre devoir spécifique de défenseurs de la liberté dans le socialisme et la révolution. Tant que la révolution était en danger en Russie, nous considérions, sans pour autant renoncer à nos idées et à leur propagande ni à nos activités, que notre principal devoir consistait à défendre la révolution russe contre toutes les attaques, les diffamations et les calomnies de la bourgeoisie ; que nous devions avant tout être solidaires de la révolution, quelle que soit sa direction, contre nos gouvernements capitalistes qui la menaçaient avec le blocus de la faim et l’agressaient avec des armes, traîteusement, de tous côtés.
Maintenant que ces dangers ont quasiment disparu, nous devons nous occuper de la révolution russe en reprenant notre liberté de critique, liberté propre à tout mouvement minoritaire, même au sein de la révolution, et qui est une condition essentielle de progrès pour la révolution elle-même. Une telle critique n’a pas a priori un caractère hostile, elle ne cherche pas à couper les cheveux en quatre pour trouver à tout prix quelque chose à redire, elle consisterait plutôt en une étude de faits confirmés du point de vue révolutionnaire, qui nous guide et nous fasse comprendre quels actes et quels faits ont été utiles ou néfastes à la révolution, lesquels auraient pu être évités ou non, quels autres ont apporté des bénéfices à la cause de la liberté et du bien-être pour tous, et lesquels en revanche n’ont apporté que des dommages. Cela, non pas dans le sens d’une inutile récrimination a posteriori, mais au contraire, en nous efforçant de comprendre de quelle façon certains effets, et donc certaines erreurs étaient véritablement inévitables. Car certaines erreurs ne peuvent être reconnues comme telles qu’après expérience.
Les fruits de l’expérience russe ne doivent pas rester inutiles. Car il faut prévoir que tôt ou tard, même dans nos pays, on assistera à des événements révolutionnaires, et alors l’étude critique de la révolution russe nous sera d’une aide appréciable, non pas dans un but culturel stérile, mais afin que les révolutionnaires occidentaux puissent régler leur action de manière à éviter, si possible, les erreurs que l’expérience russe peut éventuellement avoir mises en évidence.
Malheureusement, nous sommes trop peu renseignés sur ce qui se passe en Russie, et tout ce que nous connaissons, nous le devons à des sources qui ne sont pas suffisamment fiables. Les journaux bourgeois sont pleins de renseignements sur la Russie, mais si évidemment faux ou falsifiés, tellement tendancieux et suant la haine, qu’il est absolument impossible de les prendre au sérieux d’aucune manière. Même si quelquefois un peu de vérité arrive à s’y glisser, il est tellement difficile de la discerner du faux, on en est si peu sûr, qu’il est impossible d’en retirer un quelconque renseignement, une quelconque argumentation.
La presse socialiste est infiniment plus crédible, et, pour nos discussions, nous nous fondons presque exclusivement sur son contenu. Au moins elle est sincère, elle est mue par des sentiments en grande partie semblables aux nôtres, elle est désintéressée, car elle fait l’intérêt d’un parti ou d’une idée et non celui bas et vénal des professionnels du journalisme bourgeois. Et pourtant, bien qu’elle soit plus crédible et sympathique, même la presse socialiste n’est pas objective, elle tend, contrairement à la presse bourgeoise, à montrer qu’en Russie tout se passe au mieux, et selon ses principes, elle est naturellement portée à voir les faits sous une lumière partiale, et à ne pas voir ceux qui contredisent sa thèse.
Elle nous laisse dans l’ignorance totale ou presque, tout spécialement en ce qui concerne des faits qui nous intéressent, nous anarchistes, au plus haut degré : rapports entre le gouvernement bolchévique et les oppositions révolutionnaires (socialistes révolutionnaires de gauche, anarchistes, maximalistes immédiatistes), rapports entre les soviets et le gouvernement central, fonctionnement de la police et des divers organes exécutifs, etc. C’est-à-dire que nous en connaissons les rapports théoriques, la diversité des idées, les relations établies dans les lois et les règlements, les fonctions légales des différents organes, etc. ; mais il nous manque absolument une exposition de la manière dont se traduisent ces rapports, théories, relations et fonctions dans les faits, ceux mis en pratique, ceux restés sur le papier, quels en ont été les résultats, etc.
Pas une seule voix, en aucune manière, qui ne soit celle officielle du gouvernement bolchevique et de ses partisans, ou bien celle de l’opposition bourgeoise et réactionnaire. Jusqu’à il y a quelques mois, par exemple, on savait qu’il y avait en Russie des journaux anarchistes, quotidiens et hebdomadaires, et des revues, mais depuis un moment on n’en entend plus parler nulle part. Et pourtant, les anarchistes, qui se sont rapidement multipliés depuis 1905 et qui ont été un puissant coefficient révolutionnaire, aussi bien en mars qu’en octobre 1917, ne se sont certainement pas volatilisés ! Il est sûr que si nous avions une source d’informations anarchiste et si nous nous fondions uniquement sur elle, nous serions de même toujours partiaux, exposés au danger d’appréciations erronées, mais elle nous serait très utile pour compléter le matériel informatif et documentaire, et aussi comme élément de confrontation et de contrôle. Son absence nuit à une évaluation sérieuse des faits, car nous manquons justement de cette source dans laquelle nous pourrions avoir confiance pour étudier les problèmes qui intéressent le plus les anarchistes, les autres étant enclins à s’en désintéresser et, le plus souvent, à les ignorer carrément.
Nous n’arrivons pas à savoir quels sont les obstacles qui empêchent la voix des anarchistes d’arriver jusqu’à nous, nous préférons en imputer la faute à l’Entente, qui empêche les communications de traverser le « cordon sanitaire » malgré les puissants moyens du gouvernement russe. Certes, si à cet empêchement s’ajoutait celui du gouvernement bolchévique, cela équivaudrait à rendre un mauvais service, non seulement à nous et à la vérité, mais surtout à la révolution et à eux-mêmes, car tout cela pourrait donner l’impression que toute voix anarchiste, toute opposition révolutionnaire est empêchée, étouffée par le gouvernement léniniste. Nous espérons et nous souhaitons qu’il n’en soit rien[23]. Malgré tout, des observations de notre part sur les faits en Russie sont maintenant rendues possibles (bien que d’une manière incomplète et inexacte) avant tout par l’abondante littérature socialiste en la matière, ensuite par des écrits de quelques journalistes anglais et nord-américains qui se sont révélés plus objectifs et impartiaux que d’autres, et enfin par ce qu’ont pu en dire un petit nombre d’anarchistes, soit par lettres, soit en arrivant de Russie, il y a de cela quelque temps déjà.
La Russie est en train d’expérimenter, une fois encore, un engagement autoritaire de la révolution. Quels en sont les fruits et les enseignements ? Une réponse définitive ne pourra être donnée que quand toutes les frontières seront ouvertes, que nous pourrons avoir des relations avec nos compagnons là-bas et entendre les témoignages les plus probants de notre point de vue.
Néanmoins, dès maintenant, nous pouvons constater et déduire bon nombre de choses. La Russie prolétaire a suivi, dans sa révolution, la même trajectoire que la révolution bourgeoise française de 1789 : renversement du gouvernement avec l’aide d’une partie des troupes, et ensuite tentatives toujours plus poussées d’arrangements constitutionnels d’abord, républicains ensuite. Mais à la fin, avec le renversement du gouvernement bourgeois (qui, en France, aurait pu correspondre en 1793 au triomphe des hébertistes, qui en revanche furent guillotinés), les choses ont pris une tournure différente, c’est-à-dire que ce furent les représentants des prolétaires qui montèrent au pouvoir, et donc les partisans de l’égalité économique, mais au niveau politique, en ce qui concerne le gouvernement, sa formation avait pris une forme et un caractère très semblable à celle du gouvernement centralisé et dictatorial des jacobins et de Robespierre.
Dans leurs polémiques avec les anarchistes, les socialistes traitent souvent ceux-ci de « jacobins », sans qu’on puisse comprendre pourquoi[24]. Car l’orientation jacobine de la révolution est justement celle préconisée par les socialistes partisans de la dictature prolétarienne. On peut dire, en effet, que ce furent les jacobins qui créèrent la première dictature révolutionnaire. Les amateurs de similitudes historiques peuvent remarquer en effet que les commissaires du peuple, avec Lénine en tête, sont en Russie ce qu’était en France le « Comité de salut public » avec Robespierre à sa tête, et les soviets locaux russes avec le soviet central de Moscou, ce qu’étaient les sociétés ou clubs jacobins en différents points de France, avec à leur tête la société mère de Paris.
D’ailleurs, cette comparaison avait été acceptée par Lénine lui-même lorsque, en 1904, les mencheviks russes avaient cru l’offenser en l’accusant de jacobinisme : « Le jacobin, avait-il répondu, qui lie son destin à celui de la classe sociale la plus avancée de son temps, c’est-à-dire au prolétariat, est le révolutionnaire social-démocrate. » Quatorze ans après, le 6 septembre 1918, pendant un discours à l’assemblée des soviets de Pétrograd, le lendemain de l’attentat contre Lénine, un des hommes les plus en vue du mouvement bolchévique, Zinoviev, faisait l’apologie de cette réponse de Lénine aux mencheviks, et il ajoutait : « La figure du prolétaire jacobin Lénine obscurcira le souvenir des plus fameux jacobins de la grande révolution française[25]. » Les termes nouveaux, les barbarismes introduits dans le langage socialiste, ne doivent pas nous cacher l’essence des choses. Les bolcheviks, ou maximalistes, ne sont autres que la fraction majoritaire du parti russe, appelé avant la guerre social-démocrate, c’est-à-dire une des tendances les plus autoritaires et centralisatrices du socialisme international, celle-là même contre laquelle ont continuellement polémiqué les anarchistes depuis le temps de Bakounine. Ils vont jusqu’à admettre (ainsi du reste que Marx) la disparition de l’État, mais dans l’avenir, et seulement comme une conséquence automatique de la montée du pouvoir du prolétariat, et de la socialisation conséquente de la richesse sociale. Donc ils ne combattent pas directement l’État, au contraire, ils essayent de s’en rendre maîtres, ce sont en pratique des autoritaires, comme l’étaient les jacobins.
En conséquence, pour bien comprendre les directives adoptées par les bolcheviks, dans leur politique et dans leur façon de gouverner, et avant d’examiner les faits de Russie qui sont arrivés à notre connaissance, il est nécessaire de connaître leurs idées et de suivre l’évolution de celles-ci, depuis l’ancien socialisme autoritaire ou social-démocrate jusqu’au socialisme révolutionnaire dictatorial, qui a pris le nom de « bolchevisme ».
Le « Parti social-démocrate ouvrier russe » fut fondé en 1898 pendant un congrès, en opposition aux autres partis socialistes russes qui avaient, à ses yeux, le tort soit d’avoir des tendances trop politisées (dans le sens du libéralisme bourgeois), ou trop anarchistes. Son programme était le même que celui de la social-démocratie allemande, du Parti ouvrier français de Guesde, des socialistes intransigeants italiens de Lazzari. C’était toujours le collectivisme, ou communisme étatique, que l’école doctrinaire des communistes allemands avait hérité du socialisme gouvernemental et jacobin de Louis Blanc, de Pecqueur, etc. Ce parti tint son deuxième congrès en 1903 où se dessina la scission entre ceux qui, étant majoritaires, s’appelèrent bolcheviks (mot russe qui signifie justement majoritaire) et les autres, qui, étant minoritaires, s’appelèrent mencheviks (c’est-à-dire minoritaires) [26].
Au congrès suivant, le troisième, qui se tint à Londres en 1905 le Parti socialiste démocratique ouvrier était composé des seuls bolcheviks, les mencheviks s’étant organisés à part. A ce moment-là les conceptions du parti étaient toujours favorables à la constitution d’une république démocratique russe, issue d’une assemblée constituante, avec son gouvernement provisoire correspondant, etc. En ce temps, Lénine, en accord avec le congrès de Londres, rejetait entièrement les « idées ineptes et à moitié anarchistes de la réalisation immédiate du programme maximum et de la conquête du pouvoir par une révolution socialiste [27] ». Dans le même écrit, publié en russe à Genève, Lénine vantait les bolcheviks comme étant des jacobins de la démocratie socialiste contemporaine.
L’année où Lénine publiait le livre dans lequel il exprimait ces idées éclata la première, glorieuse et malheureuse révolution russe C’est alors que sont nés les soviets, c’est-à-dire les assemblées permanentes des représentants des travailleurs appelés plus proprement en italien « conseils ouvriers ».
On confond souvent le bolchevisme et le « sovietisme », à cause justement du peu de précisions de ces deux mots employés tels quels au lieu d’être traduits en une autre langue. Le bolchevisme, comme on vient de le voir, n’est qu’une doctrine de parti, celle du marxisme révolutionnaire. Le « sovietisme » est tout autre chose, c’est un système pratique d’organisation des rapports ouvriers et révolutionnaires, une façon de poursuivre la vie sociale, même en temps de révolution et une fois le pouvoir renversé, soit en accord avec le nouveau pouvoir, soit indépendamment de lui. A un certain moment, les soviets russes devinrent bolcheviques, parce que, spécialement dans les grandes villes, les bolcheviks sont devenus majoritaires en leur sein. Ils purent, ainsi, imposer leur système aux autres, au moyen du pouvoir politique conquis par le prolétariat industriel des plus grands centres.
Mais il n’est pas dit que les soviets, en tant que tels, soient forcément bolcheviques. Au contraire, on se rappellera que, au début de la récente révolution russe, certains d’entre eux étaient socialistes révolutionnaires, d’autres mencheviks, d’autres plus modérés encore, et d’autres encore plus avancés. En certains lieux la prédominance était anarchiste. Pendant la première révolution de 1905, les bolcheviks avaient exercé une grande influence sur les soviets ou à travers les soviets, simplement par leur forte organisation de parti et par leur esprit révolutionnaire et d’initiative. L’insurrection de Moscou a été le fait des bolcheviks. Kropotkine notait en 1907 [28] qu’une des raisons de la défaite de la révolution fut alors l’esprit trop sectaire, étroit et exclusif dont étaient animés les sociaux-démocrates. Mais ceci est une autre question.
En ce qui concerne les soviets, Zinoviev raconte dans la biographie de Lénine que celui-ci assistait en spectateur, en 1905, à la séance du soviet de Pétrograd, lequel était, du reste, de tendance surtout menchevik ou, comme on dit chez nous, réformiste. Cela était possible entre autres parce que Lénine était à Pétrograd illégalement et que les camarades lui avaient défendu de s’exposer. Mais il est permis de supposer, ainsi que le dit Zinoviev, qu’à partir de ce moment-là, Lénine a eu l’idée du régime « soviétiste », ou, plus proprement ajouterions-nous, l’idée d’utiliser les soviets pour asseoir sur des bases plus sûres le pouvoir du Parti social-démocrate ou bolchevique.
En réalité, les soviets ont surgi indépendamment du bolchevisme. Ils sont nés de l’esprit d’initiative des ouvriers des villes et des villages, poussés par le besoin de se procurer immédiatement et de façon organisée, pour les nécessités pratiques de la révolution, l’alimentation pour les masses, l’armement, et d’assurer les relations et la production. Ils avaient une organisation simple, fédéraliste ou autonome. Tous étaient en rapport pour les nécessités de la vie sociale dans leur propre village, quartier ou ville. L’entente entre les différents soviets s’établissait sur des bases égalitaires, et sans coercition des uns sur les autres.
La brève expérience de 1905 fut utile. À peine éclatée la seconde, et cette fois-ci victorieuse, révolution, en mars 1917, les soviets se sont reconstitués sur une échelle beaucoup plus large, jusqu’à recouvrir d’un réseau compact la Russie toute entière. Les caractéristiques des soviets, à peine visibles douze ans auparavant se sont précisées et définies beaucoup plus nettement. La nouvelle institution était devenue tellement forte qu’aucun gouvernement n’aurait pu exister sans être au moins toléré par elle. Les bolcheviks avaient bien compris cela et travaillèrent systématiquement pour se trouver majoritaires, tout du moins dans les villes les plus peuplées et les plus importantes, où du reste le prolétariat industriel les suivait amplement et leur facilitait la besogne et où il était plus aisé de se rendre maître du gouvernement par des coups de mains et des insurrections.
Un artiste américain, Robert Minor, d’idées et de tendance anarchistes, en Russie depuis les premiers temps du régime bolchevique, précise cela en ces termes : « L’existence des soviets n’est pas le fait des leaders bolcheviques qui ne les ont ni créés ni guidés pendant plusieurs mois, même quand ils étaient supposés en être les dirigeants. Les bolcheviks ont trouvé les soviets surgis pour ainsi dire de terre, création de milliers de mentalités incultes, en une tentative de régler les choses sans gouvernement[29], ceux qui au début ont soutenu les soviets peuvent être considérés comme anarchistes et communistes. La grande entreprise consistait donc à se rendre maître de cette grande force anarchiste, de la domestiquer et de la guider. »
Les soviets, en somme, sont dus surtout aux tendances anarchistes des masses russes et si les bolcheviks ont réussi à les transformer en organismes de gouvernement à eux, cela n’empêche pas que l’idée soviétique anti-autoritaire et fédéraliste contredise et heurte l’esprit autoritaire et centralisateur du bolchevisme, autrement dit, du concept social-démocrate et marxiste de la révolution. Tant il est vrai que les anarchistes russes, partisans enthousiastes des soviets dans leur version originale, rencontrent en Russie la plus grande hostilité justement chez les bolcheviks, lesquels doivent pourtant à l’institution des soviets leur pouvoir et leur fortune politique.
Et cela ne peut s’expliquer que d’une façon : les anarchistes, en défendant la liberté et l’autonomie des soviets contre l’envahissement et les abus du gouvernement central aux mains des bolcheviks, empêchent ceux-ci de se consolider et en rendent la dictature « moins forte ».
Certes, dans l’hostilité envers les anarchistes, il y a aussi l’influence de la vieille « haine théologique marxiste », qui ne s’est jamais éteinte chez les bolcheviks, et s’est seulement tue au moment où l’aide des forces anarchistes était nécessaire pour vaincre. Lénine tout spécialement ne laisse jamais passer une occasion de parler avec mépris des anarchistes, en affichant ostensiblement cette ignorance de leurs idées que l’on rencontre très souvent chez les écrivains sociaux-démocrates. Ainsi, Lénine se complaît à attribuer à l’anarchisme, répétant en cela Karl Marx dans sa polémique avec Proudhon, un caractère petit bourgeois, qu’il faudrait plutôt attribuer au socialisme autoritaire et parlementaire.
P.-J. Proudhon, auteur aussi désordonné qu’encyclopédique, peut être considéré comme le dernier des socialistes utopiques et le premier des socialistes modernes, dits improprement « scientifiques ». Il a laissé une énorme production intellectuelle dont une partie est fortement anarchiste, qui fait appeler Proudhon le « père de l’anarchie ». Mais il y a aussi toute une partie utopiste où Proudhon propose différentes réformes pour donner une solution au problème social, que les anarchistes n’ont jamais fait leur, et c’est celle qui a été la plus critiquée par Marx et littéralement pillée par le socialisme réformiste, auquel on pourrait attribuer plus opportunément l’épithète « petit bourgeois ».
Mais Lénine n’a cure de tout cela. De la même manière que, avant 1917, il rejetait en l’appelant « anarchiste » la tactique qu’il fit sienne par la suite, celle de la conquête du pouvoir par la révolution socialiste, aujourd’hui il se moque, comme étant petites bourgeoises, des préoccupations libertaires qui inspirent aux anarchistes leur hostilité à la dictature : « Il est tout à fait clair pour nous, dit-il, combien est correcte la proposition marxiste selon laquelle l’anarchisme et le syndicalisme anarchiste sont de tendances « bourgeoises », inconciliables avec le socialisme, la dictature prolétaire et le communisme [30]. » On comprend difficilement comment cela puisse être clair, ne serait-ce qu’aux seuls yeux de Lénine, puisque aux temps de Marx le syndicalisme n’existait pas, et que l’anarchisme et le syndicalisme, bien qu’opposés à la dictature, sont partis de mouvements prolétaires essentiellement socialistes et tout le monde sait que les anarchistes sont en matière économique des communistes.
Cependant, Lénine précise assez bien (et de telle façon que nous sommes d’accord avec lui) la distinction entre anarchisme et socialisme (ou, pour être plus précis, entre socialisme anarchiste et socialisme autoritaire) dans l’un de ses écrits cités par un journal socialiste [31] mais dont nous ignorons la source d’origine : « La différence fondamentale entre socialistes et anarchistes à propos du « gouvernement » ne doit pas être laissée de côté. Les socialistes veulent utiliser les présentes institutions gouvernementales dans la lutte pour la libération de la classe ouvrière, et pour cela ils insistent sur la nécessité de se servir du gouvernement pour créer une forme de transition du capitalisme au socialisme.
« Cette forme de transition, qui est donc une forme de gouvernement, est la dictature du prolétariat. Les anarchistes veulent abolir le gouvernement, l’abattre ; les socialistes sont pour une extinction, une graduelle élimination du gouvernement, après expropriation de la bourgeoisie. Les anarchistes font observer que tout cela n’est que l’ancien socialisme marxiste et blanquiste traduit en russe. L’expropriation par l’État et l’élimination graduelle ultérieure de celui-ci sont précisément les idées du socialisme autoritaire, qui remontent à 1870. Depuis le temps de Bakounine, les anarchistes ont toujours polémiqué avec ce socialisme, en soutenant que la période de transition de la société bourgeoise à la vraie société socialiste sera caractérisée non pas par la dictature, mais par la révolution permanente, l’opposition à toute autorité constituée, la lutte directe des ouvriers contre les résidus de l’ancien régime et leur libre association pour la production et la distribution. »
En revanche, Lénine conçoit la dictature « à la poigne de fer », dans le sens classique et despotique du terme. Qu’il la préconise pour une bonne finalité ne change pas l’essence de la chose. Et puisque beaucoup se creusent la cervelle sur la signification du mot « dictature », pour y voir seulement un synonyme de violence prolétaire, conciliable avec la liberté du mouvement individuel et collectif de la classe ouvrière et des forces révolutionnaires en action, on nous pardonnera de reproduire, tirée du fameux discours programme tenu par Lénine au congrès panrusse des soviets en avril 1918, une longue mais claire exposition de sa conception de la dictature :
« Si nous ne sommes pas anarchistes, nous devons admettre la nécessité de l’État : donc, de la coercition pendant la période de transition du capitalisme au socialisme. La forme de contrainte est déterminée par le degré d’évolution de la vraie classe ouvrière, ensuite par certaines circonstances spéciales, comme les séquelles d’une longue guerre réactionnaire, et aussi par certaines formes de résistance de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie. Il n’y a donc pas, absolument pas, contradiction de principe entre la démocratie des soviets et l’usage du pouvoir dictatorial de la part des particuliers. La distinction entre une dictature prolétaire et une dictature bourgeoise consiste en ceci : la première, même si elle est exercée par des particuliers, l’est non seulement par la masse des travailleurs exploités, mais aussi par les organisations qui sont formées de telle sorte qu’elles élèvent la masse au travail créatif de l’histoire. Les soviets font partie de cette espèce d’organisation.
« Quant à la deuxième question sur la signification du « pouvoir dictatorial individuel » en raison des problèmes spécifiques de la présente période, nous devons dire que toute grande industrie mécanique – source productive matérielle et base du socialisme – requiert la plus illimitée et la plus rigide « unité du vouloir » qui « dirige » le travail commun de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de personnes.
« Cette nécessité tombe sous le sens du point de vue historique, technique et économique, et a toujours été reconnue comme telle par tous ceux qui ont donné au socialisme quelques idées. Mais comment assurer une unité inébranlable de « vouloir » ? Par la subordination de la volonté de milliers de personnes au vouloir d’un seul.
« Cet assujettissement, si les participants au travail commun sont idéalement conscients et disciplinés, peut ressembler à la faible direction d’un conducteur d’orchestre ; mais peut aussi assumer la forme extrême d’une dictature, s’il n’y a pas de discipline idéale et consciente. Mais, de toute façon, « la subordination incontestée à une volonté unique » est absolument nécessaire pour la réussite des processus du travail, qui sont organisés sur le type de la grande industrie mécanique. Cela est doublement vrai pour les chemins de fer. Et justement ce passage d’une tâche politique à une autre qui apparemment n’a aucune ressemblance avec la première, constitue la caractéristique de la présente période.
« La révolution vient de rompre les plus anciennes, les plus fortes, les plus lourdes chaînes auxquelles les masses ont été contraintes de se soumettre. Il en était ainsi hier. Et aujourd’hui la même révolution – et vraiment dans l’intérêt du socialisme – exige la soumission absolue des masses à la volonté unique de ceux qui dirigent le processus du travail[32]. »
Comme nous pouvons le voir, il ne s’agit plus ici de violence et de contrainte au détriment seulement des anciens exploiteurs et des restes de la bourgeoisie, mais de violence exercée aussi sur la masse populaire. La dictature de classe devient effectivement la dictature d’un parti, la dictature personnelle des dirigeants de ce parti, que ce soit dans le domaine de l’organisation politique ou dans celui de l’organisation économique.
Il est vrai que, à propos de la première, Lénine fait observer que la dictature y est exercée « contre la minorité des exploiteurs dans l’intérêt de la majorité exploitée ». Mais on ne discute pas, pour le moment, des intentions, qui peuvent sans aucun doute être très bonnes. Ce sont les conséquences pratiques qui nous donnent du souci. Hélas ! toutes les dictatures, tous les gouvernements ont prétendu et prétendent se trouver au pouvoir par la volonté des majorités contre les rébellions et les abus des minorités, mais en réalité, cela ne reflète seulement que leur volonté propre, et celle du petit nombre de gens qui les entourent.
« Une dictature – c’est toujours Lénine qui parle en une autre partie du discours déjà cité[33] – est un gouvernement rigide composé de révolutionnaires audacieux, décidés, et sans pitié pour la suppression des exploiteurs comme des fripons. » Malheureusement, un gouvernement, fût-il révolutionnaire, tend naturellement à voir des fripons dans tous les opposants. Par exemple, Lénine lui-même ne parle presque jamais des anarchistes sans les accuser de tendances bourgeoises ou petites bourgeoises, de là à les traiter de « fripons », et donc à en vouloir la suppression, le pas est beaucoup plus petit qu’il n’y pourrait paraître à première vue.
En somme, à la lecture des programmes dictatoriaux « à poigne de fer » que l’on voit nommés par-ci, par-là (et pas trop clairement d’ailleurs, car, hormis Lénine, les autres s’expliquent très peu sur cet aspect du problème révolutionnaire), une question nous vient logiquement à l’esprit : lorsque le nouveau pouvoir nous aura libérés de l’ancienne domination étatique bourgeoise, autrement dit de la dictature capitaliste, qui nous délivrera de ce nouveau gouvernement ? Qui nous libérera des dictatures prolétaires, ou agissant au nom du prolétariat ?
Selon l’expression même des chefs bolcheviques, « la dictature du prolétariat » – en tant qu’organisation politique et non du point de vue économique – est un gouvernement comme tous les autres, avec les mêmes défauts et les mêmes conséquences pernicieuses inhérentes. Il s’agit en substance de la dictature d’un parti sur toute la population, ou mieux encore des dirigeants d’un parti, et précisément, en ce qui concerne la Russie, du parti bolchevique. Parti qui, bien qu’ayant un nom différent, reste toujours le parti des « jacobins de la démocratie socialiste » d’avant la guerre et d’avant la révolution.
Il ne faut pas se laisser abuser par le kaléidoscope des termes. Les bolcheviks russes, et leurs sympathisants de partout, récusent aujourd’hui l’ancienne appellation de « sociaux-démocrates », et se lancent vivement contre ceux qui l’ont maintenue, tout spécialement contre les majoritaires et les indépendants allemands. Pour se distinguer des sociaux-démocrates, ils ont repris le nom de « communistes » que Marx et Engels avaient accepté lors de leur adhésion à la ligue du même nom peu avant 1848 ; mais par la suite, tous les socialistes, ou presque, l’avaient abandonné, vers 1880, pour se dire « collectivistes ». Le collectivisme se distinguait du communisme par une différente conception de la répartition des produits en régime socialiste, mais celle-ci était une question secondaire à laquelle peu de monde prêtait attention. En fait, le collectivisme n’était autre chose que l’ancien communisme d’État des socialistes allemands. A partir de 1880, les anarchistes incorporent le communisme – et communistes ils le sont encore, sauf une petite minorité d’individualistes – mais en l’expurgeant des liens étatiques, et en l’adoptant comme l’organisation de la production et répartition de la richesse sociale, plus apte à rendre possible une société humaine sans gouvernement, reposant sur la coopération volontaire et le libre accord. Mais de cela, nous en reparlerons à part.
La conception du communisme, de l’avenir social et des rapports humains dans une société socialiste est en revanche pour les bolcheviks celle-là même ultra minoritaire de la démocratie sociale de jadis, avec cette plus grande intransigeance révolutionnaire, que de tous temps lui ont donné les socialistes russes. Ce qu’il y a de nouveau, c’est une plus grande précision donnée au concept de dictature, qui était peu clair chez Marx (si peu clair qu’il semble douteux qu’il lui ait donné le sens que lui donnent aujourd’hui les bolcheviks), et tout spécialement l’adoption du système pratique des soviets auquel les bolcheviks ont su s’adapter, ou mieux ont su profiter pour en faire un instrument de domination. Les caractéristiques principales de l’ancien marxisme et de l’ancienne social-démocratie (l’esprit ultra-autoritaire, l’hostilité pour l’anarchisme, l’antipathie pour la libre initiative, la discipline coercitive, la centralisation des pouvoirs et des fonctions, et spécialement le but de la conquête du pouvoir) demeurent chez les bolcheviks. Ce sont là les mêmes caractéristiques que le communisme des temps de Marx et d’Engels.
Seulement, la conquête du pouvoir que la social-démocratie allemande concevait, depuis 1870, à travers le mécanisme parlementaire bourgeois les bolcheviks russes (plus en harmonie avec leur tradition révolutionnaire) l’ont faite au moyen de l’insurrection et du coup de main, après avoir conquis par les élections les soviets, tout au moins les plus importants stratégiquement.
Les soviets ont été acceptés par les bolcheviks, mais pour être transformés en une espèce de système électoral et parlementaire compliqué, dans lequel renaît l’idée directrice de la social-démocratie, du droit des majorités plus ou moins fictives, peu importe, à imposer leur propre pouvoir (c’est-à-dire le pouvoir de leurs propres chefs) aux minorités. Ce qui est différent, c’est que ce régime démocratique est composé (ou du moins devrait l’être par la loi) par l’émanation des seuls travailleurs et seulement d’eux, de révolutionnaires et de socialistes en excluant les membres restants des classes bourgeoises. Mais c’est une nouveauté, en ceci qu’elle a été imposée par la révolution. Avant, elle aurait été impossible. En effet, avant 1917, comme nous l’avons vu, Lénine lui-même était partisan du suffrage universel, de l’assemblée constituante, de la conquête électorale des pouvoirs publics, etc.
Il est certain qu’en accédant au pouvoir en Russie, un parti qui, parmi les socialistes, est celui qui est le moins animé par les sentiments de la liberté, il ne fallait pas espérer que la cause de la liberté puisse bien facilement triompher. Nous espérons qu’elle triomphera par la suite, lorsque l’état de paix permettra aux partis de la liberté, et tout spécialement aux anarchistes de relever la tête sans aucune crainte. Mais pour le moment, sur la foi du matériel d’information dont on dispose, ce n’est pas une hérésie de dire que l’État russe, socialiste dans ses aspirations, est autoritaire comme tous les États, et donne, ou laisse, à ses sujets pas plus de liberté qu’ailleurs, peut-être moins…
Mais avant de continuer l’examen des rapports entre la dictature révolutionnaire et la liberté, qu’il soit bien entendu que, en parlant de la liberté, nous ne nous référons pas à celle des ennemis de la révolution, qui peuvent ou entendent s’en servir pour nuire à la révolution elle-même. La liberté dont nous nous occupons, que nous défendons, est celle qui est du ressort de la révolution, c’est-à-dire exclusivement la liberté populaire, des prolétaires, des révolutionnaires, des oppositions de gauche ; liberté individuelle et collective, de presse, de réunion, d’association, de propagande ; liberté d’action dans le sens révolutionnaire, soit pour l’attaque des vieux privilèges, soit pour l’expérimentation de nouveaux systèmes ; liberté de développer ses propres activités sans les empêchements bureaucratiques, étatiques, etc. En un mot, « liberté d’opposition », toujours dans l’ambiance de la solidarité révolutionnaire contre les ennemis bourgeois.
Afin qu’il n’y ait pas de malentendus, nous insistons beaucoup sur la remarque que les violations des libertés qui nous préoccupent sont celles dirigées contre le prolétariat, ses forces révolutionnaires de gauche et d’extrême gauche et non pas des menées prétendues socialistes, social-démocrates ou social-patriotiques, qui favorisent ouvertement la réaction et qui doivent nécessairement être combattues. Nous sommes persuadés que ces forces, ainsi que d’autres forces réactionnaires, peuvent être combattues par les moyens révolutionnaires du peuple, mieux que par des moyens autoritaires, de gouvernement, de façon que les armes employées contre les réactionnaires ne puissent pas être retournées contre la révolution elle-même. Toutefois, ce n’est certainement pas la défaite et l’étouffement des oppositions contre-révolutionnaires, par des moyens quels qu’ils soient, qui peuvent nous donner des soucis ou nous procurer de la peine.
Maintenant, dans quelle mesure, et jusqu’à quel point a été limitée ou respectée la liberté prolétaire et révolutionnaire par le gouvernement bolchevique ? Jusqu’à quel point peut-elle se concilier, et à partir de quel point ne se concilie-t-elle plus avec la centralisation dictatoriale de la révolution. C’est ce que nous allons essayer d’établir, avec la plus grande objectivité et impartialité dont nous sommes capables, et sur la foi du peu de matériel documentaire mis à notre disposition.
Dictature et liberté en Russie
Cette pénurie d’information sur l’état de la liberté en Russie autorise, de par elle-même, la suspicion ; on peut très bien penser que non seulement la liberté des bourgeois et des contre-révolutionnaires soit réduite à des proportions minimes mais aussi celle des prolétaires et des révolutionnaires. Pas mal de choses ont été racontées par la presse conservatrice et réactionnaire de l’Europe occidentale à ce propos. Si celles-ci sont vraies, on pourrait penser qu’il n’existe actuellement de par le monde aucun gouvernement plus tyrannique que celui de Lénine. Bien sûr, nous refusons, nous, délibérément, de tenir compte de ces témoignages, car nous en connaissons la tendance diffamatoire ; mais nous ne pouvons cacher notre étonnement sur un fait : la presse socialiste, sans doute la mieux renseignée, ne se soucie aucunement de démentir ces calomnies (si calomnie il y a), tandis qu’elle a su, à coup sûr, en démentir tant d’autres.
Au moins, le fait de ne pas se soucier de rétablir la vérité sur cette question démontre chez les socialistes une mentalité non seulement mesquine, mais en plus dangereuse pour la cause de la liberté, à laquelle d’ailleurs ils semblent donner bien peu d’importance. Il nous semble qu’il serait de leur devoir, en même temps que de leur intérêt, de nous démontrer, par des faits, que là où la révolution socialiste a gagné, là où la domination bourgeoise a été écrasée, tous les travailleurs et tous les révolutionnaires jouissent d’une plus grande liberté que sous l’ancien régime capitaliste. Le socialisme a promis aux ouvriers, non pas tant et non seulement le pouvoir politique pour ses représentants, que et surtout pain et liberté. Les socialistes semblent trop se soucier de démontrer que nous avons tort de craindre qu’en Russie le pain et spécialement la liberté ne sont pas assurés justement à cause de l’autoritarisme et du centralisme excessif du pouvoir politique.
La révolution russe, tout en s’appuyant sur l’irritation populaire due à la famine et aux carnages occasionnés par la guerre, a été surtout caractérisée par une grande soif de liberté. Il ne pouvait pas en aller autrement dans un pays régi par le pire des despotismes, où la liberté dans ses différentes conceptions – des démocrates aux socialistes, des républicains aux anarchistes – apparaissait comme le bien suprême, la plus ardente des aspirations, la voie unique pour le bien de tous.
Les bolcheviks l’ont bien compris, eux qui entre mars et novembre se sont servi de cette soif générale de liberté, d’une liberté toujours plus grande, en l’exploitant à fond pour abattre tous les restes de l’ancien régime, pour empêcher la formation d’un pouvoir « démocratique » et bourgeois stable, pour secouer l’autorité de l’État dans toutes ses branches, dans la bureaucratie, dans l’armée et parmi les ouvriers des services publics.
Tant qu’il est resté dans l’opposition, le parti bolchevique a favorisé toutes les forces qui pouvaient dissoudre le gouvernement de Kerensky et compagnie : en fomentant l’esprit de désobéissance et l’indiscipline contre le parti dominant adverse, en utilisant toutes les tendances libertaires déchaînées par la révolution, en promettant toutes les libertés, en faisant, en somme, tout ce que de bons révolutionnaires devaient faire, et ce qu’ont fait aussi, de leur côté, les anarchistes. C’est pour cela, d’ailleurs, qu’ils n’eurent pas d’alliés plus ardents que les anarchistes, qui aidèrent puissamment toutes les tentatives de révoltes contre Kerensky, et jusqu’à la défaite définitive de celui-ci. Plus tard, l’anarchiste Gordine, dans le journal Burewstnik, pouvait avec amertume rappeler à Lénine qu’il avait été deux fois blessé, pour l’avoir défendu dans la lutte contre le gouvernement bourgeois de transition.
Le langage des bolcheviks était alors très près de celui des anarchistes, leurs tendances étaient jugées nettement anarchistes, non seulement par les journaux bourgeois, qui se font un devoir de ne rien comprendre dans les affaires de ce genre, mais aussi par presque toutes les autres écoles socialistes et jusque parmi les anarchistes eux-mêmes.
Ces anarchistes, d’ailleurs, aux premiers temps de la révolution, et tout spécialement en dehors de la Russie, exprimaient leur admiration pour les bolcheviks d’une façon exagérée, et c’est en grande partie à cause de cela que certains anarchistes ont cru bon d’accepter, ne serait-ce que pour un temps très bref, et avec une tout autre signification, la formule de « dictature prolétarienne », qui est pourtant si divergeante, comme expression et comme signification, de toutes les idées de l’anarchisme[34]. En ce qui concerne les anarchistes russes, il serait intéressant, d’une part, de considérer leur participation à la révolution, et, d’autre part, d’approfondir l’histoire de leurs rapports avec les bolcheviks. Mais on ne peut que mentionner tout cela, soit par manque de renseignements complets, soit parce que l’on sortirait du cadre de cette publication. J’en dirai donc, incidemment, seulement ce dont on a connaissance et qui est en relation avec notre argumentation, au fur et à mesure que les occasions se présenteront.
Du reste, non seulement les journaux anarchistes russes, mais aussi les chroniques des correspondants étrangers, tant bourgeois que socialistes, ont longuement parlé de la participation des anarchistes à la révolution russe, aussi bien dans la première phase en mars, que dans la deuxième en octobre. John Reed, membre du Parti socialiste américain, directeur de The Communist, en Russie pendant la révolution, est arrivé à écrire : « Il est indéniable que les anarchistes ont promu et fait la révolution. » Bien entendu, il a rajouté, chose naturelle de la part d’un socialiste autoritaire : « Par la suite, les bolcheviks au pouvoir ont été dans l’obligation de freiner les excès visant à pousser la révolution vers des conséquences impossibles. » Mais ce qui est certain, c’est que les anarchistes sont restés à côté des bolcheviks jusqu’au moment où ceux-ci s’installèrent au pouvoir. Ensemble, ils ont lutté et vaincu le tsarisme d’abord, et la bourgeoisie démocratique ensuite. Tant et si bien que, les premiers temps, beaucoup de monde confondait les uns avec les autres.
Les anarchistes, en nombre trop restreint et peu organisés, ne pouvaient certainement pas rivaliser avec les bolcheviks pour la prise du pouvoir. Ces derniers, peu à peu, grâce aussi à leur infatigable activité et à leur ligne de conduite intransigeante, opposée à la continuation de la guerre, ont fini par devenir majoritaires au sein des soviets qui avaient le pouvoir étatique le plus à leur portée, et quand ils ont été sûrs d’avoir pour eux une base populaire suffisante, forts de l’appui des soldats fatigués par la guerre, à la première occasion qui s’est présentée, ils ont renversé Kerensky et les autres démocrates et sociaux-patriotes, pour en occuper la place, bien plus solidement qu’eux.
A ce moment-là, les choses ont changé. Une fois au pouvoir, petit à petit, les bolcheviks cherchèrent à rétablir l’esprit de discipline et d’obéissance, à combattre les tendances anarchistes et les différentes formes de libertés.
Ils soutenaient que tout cela était nécessaire pour sauver la révolution de la réaction intérieure, et de celle pressante de l’extérieur. Compte tenu de leur mentalité autoritaire, ils ne pouvaient pas songer qu’une conduite anarchiste de la révolution aurait pu être plus rapide et efficace, moins sanglante dans la lutte contre les réactionnaires indigènes et étrangers. Nous ne mettons pas en doute leur sincérité ni leur bonne volonté. Par ailleurs, les dangers qui guettaient la révolution russe étaient énormes. À plusieurs reprises, elle a été sur le point d’être étouffée : d’abord par le militarisme allemand, ensuite par les bandes armées levées contre elle par l’Entente.
Bref, tout conspirait à faciliter la tâche des bolcheviks dans leur objectif de devenir dictateurs de la révolution, aussi bien les éléments positifs, c’est-à-dire leur nombre, leur audace, la clarté de leurs idées, l’attrait de leur propagande, etc., que les éléments négatifs, à savoir non seulement la faiblesse des partis adverses, mais surtout les dangers de la contre-révolution et de l’invasion étrangère qui, avec la menace d’une autre et encore plus terrible dictature, faisait tolérer celle dite « prolétarienne », même par ceux qui lui étaient les plus opposés. Ceux-ci craignaient à raison que s’ils l’avaient combattue jusqu’à ébranler la révolution par des luttes intestines, ils risquaient, sans le vouloir, de faire le jeu des réactionnaires bourgeois et tsaristes.
Ceci explique, au moins partiellement, faute de preuves et de nouvelles directes, pourquoi les anarchistes après avoir été si durement traités, comme on le verra en avril 1918, passé le premier moment de fureur, n’ont pas poussé au-delà de certaines limites leur opposition ; en revanche, quelques anarchistes ont cru bon de collaborer avec les bolcheviks à la réalisation d’œuvres d’intérêt et d’utilité publics.
Le journaliste anglais Arthur Ransome écrivait dans le Daily News de Londres qu’un anarchiste, Will Shatoff, était en mars 1919 le commandant de Petrograd. Shatoff déclarait qu’il collaborait avec les bolcheviks, car à travers eux on attaquait la révolution, mais qu’il serait le premier à les renverser, une fois la révolution sauvée, autrement dit une fois que cesseraient les attaques réactionnaires contre eux[35]. Nous ne voulons pas, ici, discuter du fait en lui-même, ni prêter des intentions, nous voulons seulement rapporter l’information à titre documentaire donnée par Ransome qui était sur place. En Ukraine, ce sont les bandes volontaires des partisans de l’anarchiste Makhno qui ont le plus contribué à mettre en déroute les troupes de l’Entente commandées par l’aventurier Dénikine[36]. Et pourtant, malgré cette collaboration occasionnelle, imposée par les dangers menaçant la révolution, les anarchistes continuaient à rester dans l’opposition. La victoire des bolcheviks, et la consolidation de leur pouvoir, avait désormais fait perdre toute illusion, même aux anarchistes qui en avaient eue. De leur côté les bolcheviks, arrivés au gouvernement avec la promesse d’assurer une plus grande liberté au prolétariat révolutionnaire, du fait même qu’ils étaient devenus « le pouvoir », furent contraints d’oublier leurs promesses, voire faire tout le contraire, limiter toujours plus la liberté des citoyens : liberté de réunion, de presse, de parole, d’association, d’autogouvernement local, etc.
En conséquence, l’opposition des anarchistes, en principe plutôt modérée, fondée sur des principes théoriques plutôt que pratiques, et seulement de contrôle et de critique, peu à peu devint une opposition active et combative.
Opposition motivée par les limitations de libertés, non plus dirigées seulement contre les réactionnaires et les contre-révolutionnaires, alliés à l’ennemi extérieur, mais aussi contre les ouvriers qui n’étaient pas d’accord avec les bolcheviks, contre toutes formes d’opposition, même les plus farouchement révolutionnaires. Le conflit s’était fait plus aigu, tout spécialement au printemps 1918, après la paix de Brest-Litovsk, contrée par les anarchistes et les socialistes révolutionnaires de gauche ; ces derniers, jusqu’alors, étaient d’accord avec les bolcheviks et avaient même participé au gouvernement[37]. La paix de Brest-Litovsk et la reprise des relations diplomatiques et commerciales avec l’Allemagne obligeaient le gouvernement bolchevique à se donner l’apparence d’un gouvernement fort et ordonné, capable d’empêcher les excès de la révolution et de mettre un terme à « l’anarchie ». Les anarchistes, désormais, étaient plus une gêne qu’une aide et compromettaient le gouvernement qui les tolérait aux yeux des militaires qui foulaient le sol russe (et il n’y avait pas que les Allemands).
Le colonel Thomson de la mission militaire américaine, ayant demandé à Lénine pourquoi il permettait que les anarchistes dominent la situation à Moscou, s’entendit répondre par le dictateur : « A Moscou, il y a plusieurs groupes anarchistes, tous armés, décidés à tout pour faire triompher leur idéal. Mon gouvernement est encore trop faible pour les combattre. Aussitôt que nous aurons assuré notre position, nous saurons bientôt nous en défaire. »
Jacques Sadoul, le 6 avril 1918, écrivait de Moscou à A. Thomas : « Le parti anarchiste est le plus actif, le plus combatif des groupes d’opposition et probablement le plus populaire. Il est aussi le seul à pouvoir s’appuyer sur des forces assez conséquentes pour pouvoir s’attaquer aux baïonnettes bolcheviques. Il semblerait même que dans les villes ils gagnent du terrain[38]. »
Toujours est-il que le gouvernement bolchevique, à un moment donné, imposa aux anarchistes de déménager des immeubles occupés et de se soumettre. Comme il essuya un refus, dans la nuit du 11 au 12 avril 1918, il les fit cerner par la troupe armée de mitrailleuses et de canons ; en un rien de temps ils furent dispersés. Il en fit arrêter quatre ou cinq cents, et en fit fusiller quelques douzaines en les faisant passer pour des criminels de droit commun. Il n’est pas exclu, naturellement, qu’il y en ait eu, mais le but réel des bolcheviks n’était certainement pas, ainsi qu’ils l’ont prétendu ensuite, de « purifier l’anarchie des malfaiteurs qui la déshonoraient », mais bien seulement de se défaire d’une opposition qui commençait à devenir gênante.
Sadoul écrivait à son ami Thomas qu’après « le nettoyage des nids anarchistes, Trotsky était radieux », et que « même la bourgeoisie avait été heureusement surprise » par la bonne réussite d’une « telle vigoureuse opération de police ». Cela avait été un coup (dit toujours Sadoul) pour tous les partis de l’opposition, à tel point que, après la défaite des anarchistes, ils furent démoralisés. Cependant, si la bourgeoisie en fut heureuse, c’est bien parce que les oppositions réactionnaires ne furent pas frappées, mais uniquement les révolutionnaires. En effet, les bolcheviks commençaient à virer à droite. Dans un article du journal anarchiste déjà cité, Burewstnik, suite aux événements précédents, les bolcheviks sont accusés de monopoliser à leur profit le droit d’expropriation et de solliciter la coopération des éléments bourgeois. Sadoul lui-même se félicite, dans une lettre du 6 avril 1918, que « les bolcheviks enterrent jour après jour le bolchevisme comme justement ne cessent de le répéter les anarchistes et les spécialistes révolutionnaires de gauche[39] ». Précédemment, le 27 mars, il note que « les bolcheviks marchent à pas de géants vers la nécessaire collaboration des classes[40] ».
Ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, nous ne discutons pas des motivations, nous enregistrons des faits. D’un côté on repousse, voire on combat comme des ennemis les anarchistes, et d’un autre côté, on recherche la collaboration technique et militaire d’éléments bourgeois ; collaboration toutefois (cela il faut bien le dire) qui n’a rien à voir avec une collaboration étatique ou de classes en régime bourgeois, du type dont sont partisans les réformistes du socialisme occidental.
Cette accusation de collaborationnisme, portée par les anarchistes et les socialistes révolutionnaires de gauche à l’encontre des bolcheviks, n’empêche nullement les uns de collaborer avec les autres.
Par exemple, ainsi qu’on a déjà eu l’occasion de le dire, beaucoup d’anarchistes avaient collaboré avec les bolcheviks à la gestion administrative et à la défense révolutionnaire de la révolution. Sadoul notait, pendant la période même où les contradictions entre bolcheviks et anarchistes étaient les plus aiguës, que « les intellectuels anarchistes, qui dirigeaient » leur mouvement, pouvaient facilement être influencés par les bolcheviks et conduits à collaborer provisoirement avec eux[41].
Même après le conflit des premiers jours d’avril, passé les premiers orages, les anarchistes n’avaient pas oublié que, au-delà de leur hostilité pour les bolcheviks, il restait toujours la nécessité de défendre la révolution. A différentes reprises, et tout spécialement aux moments les plus critiques, ils revenaient collaborer avec leurs frères ennemis. Robert Minor assurait que, aussitôt après le violent « nettoyage des nids anarchistes », malgré tout, la plupart des anarchistes ne feront rien pour affaiblir le pouvoir bolchevique, car dans le cas contraire la révolution aurait pu être perdue, aussi et parce que les anarchistes acceptent l’idée des soviets[42].
Il y a certainement quelque chose d’inexact dans le propos tenu par Minor, mais le concept central, bien clair, est que les anarchistes ne veulent pas nuire à la révolution pour le seul plaisir de se venger, en mettant les bolcheviks dans l’embarras. Ce comportement des anarchistes, vraiment révolutionnaire, n’a jamais dévié ou changé, même par la suite. Dans un compte rendu du bolchevik Victor Serge sur les terribles jours d’octobre-novembre 1919, pendant lesquels Judenik était aux portes de Petrograd avec son armée, et que la catastrophe paraissait imminente, voilà ce que l’on peut lire :
« Il y a lieu de relever que la fédération anarchiste de Petrograd, pauvre en effectifs, s’est trouvée en ces moments graves comme au temps de Kerensky, totalement à côté du parti bolchevique ; non sans esprit d’opposition et non sans dissensions. Le manifeste anarchiste placardé dans les rues commençait par une allusion (bien méritée et terriblement injuste en même temps) aux soldats « mobilisés à coups de bâtons et qui abandonnaient leur poste devant l’ennemi », et appelait les révolutionnaires à contribuer librement, en tant que partisans, à la défense.
« Et les partisans anarchistes, formant deux ou trois groupes choisis, forts du plus étroit des accords, ont rejoint leur poste avant même que l’appareil infiniment plus lourd et compliqué du parti ne se fût mis en branle. Pendant la première nuit d’alerte (25–26 octobre) les anarchistes, quasiment seuls à être entièrement prêts, sont venus occuper, par une curieuse ironie des circonstances, afin de les défendre éventuellement, les locaux de la Pravda, dont le marxisme rigoureux leur est plutôt hostile[43]. Cela signifie donc que devant l’ennemi commun, la grande famille révolutionnaire – qui abrite en son sein tant de frères ennemis – reste une.
« Du reste, bolcheviks, anarchistes, communistes, en ces heures de lutte, oublient forcément toutes leurs divergences de vue, ce qui est capital devient secondaire dès qu’il s’agit de la vie même de la première société socialiste [44]. »
Si les anarchistes et les socialistes révolutionnaires de gauche reprochaient aux bolcheviks de rechercher une coopération technique avec des membres de la classe bourgeoise, à coup sûr, cette coopération n’a pas seulement consisté dans la fourniture de services matériels, par ailleurs très bien payés, cela a dû signifier aussi (sinon la critique de l’opposition socialiste et anarchiste n’aurait pas été justifiée) l’absorption et l’élévation de ces éléments bourgeois à la direction de la chose publique, à côté des bolcheviks. Ce n’est certainement pas une supposition arbitraire, car les journaux ont assez parlé de hauts fonctionnaires du gouvernement bolchevique qui, sous l’ancien régime, appartenaient à la bourgeoisie industrielle, commerciale, bancaire, et même à la caste militaire.
De tels phénomènes d’adaptation réciproque, entre le nouveau régime et certains éléments de l’ancien, se sont vérifiés aussi pendant des révolutions passées. Le nouveau pouvoir, pour son besoin de consolidation, cherchait des techniciens de l’art de gouverner, et ces techniciens, petit à petit, introduisaient dans l’appareil gouvernemental plusieurs défauts de l’ancien régime ; ils atténuaient la poussée révolutionnaire, repoussaient toujours plus dans l’opposition les idéalistes et les plus ardents révolutionnaires de la première heure. Il se formait ainsi une nouvelle classe dirigeante, celle de vainqueurs arrivés au pouvoir, et composée aussi des éléments les plus adaptables de la classe vaincue, rescapés de la tempête. Si cela s’est vérifié en Russie, le résultat n’a pu que contribuer à modérer l’élan de la révolution, et à en rendre plus despotique encore le gouvernement.
Le passage à l’opposition des socialistes révolutionnaires de gauche (S.R.G.), qui constituaient la fraction socialiste la plus proche des bolcheviks, en moins dogmatique et autoritaire, a dû être déterminé aussi par un tel phénomène, bien que la poussée principale en ait été la paix de Brest-Litovsk.
Après la ratification du traité de paix avec les Allemands, les S.R.G. s’étaient retirés du gouvernement en reprenant leur liberté d’action soit contre les bolcheviks, soit contre la politique étrangère du gouvernement. Ils auraient voulu empêcher et rendre nulle la paix avec les Allemands, qu’ils supposaient désastreuse et hypocrite de la part de ceux-ci, et ils soutenaient qu’en contraignant les Allemands à une plus longue guerre, avec quelques sacrifices, il aurait été possible à la fin de déclencher la révolution en Allemagne, tandis que la paix de Brest-Litovsk y renforçait l’impérialisme.
Pour le moment, il n’est pas encore possible de formuler un jugement définitif sur la paix de Brest-Litovsk. Que serait-il arrivé si la Russie révolutionnaire avait refusé de ratifier cet acte d’infamie ? L’esprit refuse d’y songer. On aurait peut-être assisté à la tragédie de l’arrivée à Petrograd, et peut-être même à Moscou, des hulans du kaiser, et cette hypothèse suffit à faire absoudre les bolcheviks de cet acte terrible, dont ils ont assumé la responsabilité devant l’Histoire. Car cela aurait pu être le naufrage de la révolution et le retour du tsar derrière les baïonnettes prussiennes. Pour sauver la Russie d’un tel désastre, n’aurait-il pas fallu demander à son peuple un énorme sacrifice immédiat, supérieur à ses forces ?
Cependant, la plus grande partie des S.R.G. ne le pensaient pas, ainsi que les anarchistes et une minorité de bolcheviks, sans parler, bien entendu, des mencheviks, sociaux-patriotes et socialistes de droite, qui subordonnaient la cause de la révolution à celle de la démocratie bourgeoise et à celle de la guerre en faveur de l’Entente. Les opposants révolutionnaires de la « paix à tout prix » pensaient qu’un effort héroïque était possible, et qu’il aurait mieux valu pour la révolution subir une plus vaste invasion ennemie, plutôt que de subir l’outrage de la paix de Brest-Litovsk. Bien que les faits aient donné raison aux bolcheviks, il ne faut cependant pas croire que les opposants aient eu tous les torts.
L’absence absolue de scrupules du militarisme germanique nous assure que, si cela avait été possible, il n’aurait pas interrompu sa marche sur Petrograd ou Moscou et cela malgré les protocoles signés.
S’il ne l’a pas fait, c’est parce que, soit il n’en avait pas la possibilité, soit il ne se sentait pas tout à fait sûr de lui. En effet, là où il l’a pu, comme en Ukraine, le traité de paix lui a servi pour continuer la guerre d’invasion et de rapines. Peut-être que le refus de signer la paix, le fait de contraindre les armées allemandes à avancer dans les interminables plaines de Russie, la désillusion du peuple allemand qui espérait en avoir fini avec la guerre sur le front oriental, le contact prolongé des troupes allemandes avec un pays en révolution, ainsi que, d’autre part, le désespoir de la révolution et du pays en danger extrême, tout cela aurait précipité les événements vers un dénouement moins désastreux pour la Russie et plus révolutionnaire pour l’Allemagne. Peut-être… Qui sait ? On comprend toute la faiblesse d’une argumentation fondée sur ces mots et qui se heurte au fait accompli : mais le succès et le fait accompli ne sont pas suffisants pour rendre définitif un jugement historique. Nous nous limiterons donc à dire que si les bolcheviks avaient des raisons très fortes et honnêtes pour agir comme ils l’ont fait, leurs opposants ne manquaient pas de raisons tout aussi fortes et peut-être plus pures et plus nobles.
Dès que l’opposition des S.R.G. passa de la discussion aux actes, le gouvernement bolchevique la réprima par les moyens les plus violents et despotiques. Tout de suite la lutte prit un aspect tragique.
Le 4 juillet 1918 a lieu à Moscou le cinquième congrès panrusse des soviets, tandis qu’en Ukraine a lieu l’insurrection contre la récente domination allemande. La haine contre les excès impérialistes prussiens éclate en manifestations frénétiques sous les yeux des attachés de l’ambassade allemande qui y assistent depuis la tribune diplomatique.
Les orateurs des S.R.G. – les plus forts à l’Assemblée après les bolcheviks —- se montrent d’une violence inouïe contre le traité de Brest-Litovsk, contre les diplomates allemands qu’ils traitent de misérables et de bandits, contre le gouvernement bolchevique, contre la personne même des gouvernants. Les bolcheviks répondent. Ce n’est pas une discussion, c’est un incendie dans lequel tous les adversaires des deux camps brûlent de la même flamme révolutionnaire. Spiridonova pour les uns, Lénine pour les autres, tous deux aussi aimés et estimés par le peuple ou presque crient leur passion sincère pendant ce heurt désormais décisif. Mais Lénine l’emporte facilement, et, la nuit du deuxième jour, une très grande majorité approuve la politique intérieure et extérieure du gouvernement révolutionnaire. Au lendemain du vote, le 6 juillet, éclate la réponse des S.R.G. Deux d’entre eux, Blumkine et Andreïef, se présentent sous un prétexte quelconque auprès de l’ambassadeur de l’empire germanique, le comte Mirbach, et le tuent avec un revolver, puis ils se retirent en lançant deux bombes derrière eux. Au-dehors, dans les quartiers où ils ont le plus grand nombre de partisans, ils tentent l’insurrection. Mais les bolcheviks sont les plus forts. Quelques heures après l’attentat, tous les représentants au congrès des soviets sont pris en otages. Le compte rendu que fait Jacques Sadoul de cette scène est impressionnant, et rappelle les luttes tragiques de la Convention française contre les girondins, les dantonistes et les hébertistes, etc.
« La nouvelle de l’assassinat de Mirbach est communiquée aux représentants du congrès. Pendant que continuent les discussions et que les prévisions se succèdent, peu à peu, et sous prétexte de réunion de fraction, les internationalistes, les bolcheviks, tous les partis à l’exception des S.R.G., sont appelés en dehors de la salle. Vers huit heures du soir ne restent plus dans la salle que les représentants des S.R.G. et leurs partisans. Moi, je cherche à sortir. Le grand théâtre est entouré de gardes rouges qui barrent le passage. Alors les S.R.G. se sentent entre les mains de l’ennemi implacable. Ils paieront pour tous, évidemment.
« Dans la salle, vide aux trois quarts, et rendue encore plus sinistre par la lumière des lampadaires, règne un silence tragique. Les présents décident de constituer un comité et y nomme à la présidence Spiridonova. Tous debout, gravement, ils chantent d’abord une marche funèbre – se sentent-ils déjà condamnés ? Puis l’internationale, ensuite encore d’autres chants révolutionnaires d’une tristesse poignante.
« Mais bientôt tous ces jeunes combatifs, ces femmes ardentes, retrouvent leur équilibre dans une gaieté un peu nerveuse. Des discours émouvants sont prononcés, et même certains encore pleins d’humour.
« Les heures passent. Un ami bolchevique me conseille de sortir, car, lorsque les S.R.G. seront faits prisonniers, ma qualité d’officier français pourrait m’exposer inutilement aux brutalités des soldats. Vers trois heures du matin, je suis son conseil et je sors après beaucoup de difficultés, malgré le saufconduit. Dans les rues obscures il n’y a pas un seul passant. Au loin, on entend quelques coups de fusils… »[45].
Après celle des anarchistes, même l’opposition bien plus énergique des S.R.G. est mise hors de combat en quelques heures. Les bolcheviks sont désormais les plus forts, contre tous, que ce soit à leur droite ou à leur gauche. Toute opposition est devenue impossible. Le 10 juillet, le congrès soviétique se clôt par un discours de Trotsky pour le service militaire obligatoire : l’appel de dix-huit à quarante ans, le rappel au service des officiers de l’ancien régime. « Dans 1 armée, dans l’industrie, partout, dit-il, il faut rétablir la discipline, le respect des chefs, l’ordre et la méthode. »
En considérant froidement l’ensemble des événements, l’assassinat du comte Mirbach, qui à ce moment-là avait semblé bien inopportun à presque tous les révolutionnaires, paraît aujourd’hui comme un acte de courage conscient, une page qui a sa place glorieuse dans l’histoire de la révolution russe. Donc, le mouvement de sympathie spontanée avec lequel nous avions accueilli la nouvelle de l’assassinat n’était pas erroné : ils avaient fait justice en abattant le représentant à Moscou du pire despotisme, quelqu’un qui assumait déjà des attitudes de patron en Russie, l’ennemi le plus proche et donc le plus dangereux de la révolution.
On craignait de se tromper et, dans le doute, nous avions un peu réservé l’expression de nos sentiments[46], chose qui pouvait paraître comme une adhésion aux idéologies intéressées de la presse anti-allemande et anti-bolchevique, mais aujourd’hui il apparaît hors de doute que l’assassinat a eu beaucoup de poids pour faire réfléchir les impérialistes allemands et pour les faire renoncer à l’invasion de la Russie, beaucoup plus que les atermoiements, aussi justifiés fussent-ils, du gouvernement bolchevique. L’action justicière d’initiative populaire paraissait voir plus loin et montrait que le peuple avait eu l’intuition de la nécessité du moment, bien mieux que les organes centraux et officiels de la révolution.
Jacques Sadoul lui-même (nous le citons souvent car sa qualité de bolchevik et de défenseur des bolcheviks rend son témoignage insoupçonnable), qui le 6 juillet désapprouvait l’attentat, le considérant comme un acte qui risquait d’aggraver la guerre civile et ne pouvait que desservir la révolution et l’Entente, et servir seulement l’Allemagne, modérait son impression le 12 juillet, en notant : « lorsqu’ils proclament le danger de guerre occasionné par l’assassinat de Mirbach, les bolcheviks exagèrent. A mon avis l’Allemagne est trop fatiguée pour s’en irriter et l’incident devrait, au contraire, rapprocher les deux gouvernements[47] ».
En effet (et ces considérations sont en partie de Sadoul), si l’armée allemande rencontrait tant de difficultés dans une Ukraine désarmée et gouvernée par des serviteurs du kaiser et où les révoltés couvraient tout le territoire, quelle aurait été la résistance rencontrée alors dans une Russie encore armée que l’invasion aurait unie en bloc, et dont l’assassinat de Mirbach avait été un indice éloquent de ses sentiments hostiles ! Bien que vaincue et écrasée, l’opposition révolutionnaire obtient des faits la plus lumineuse justification et peut, d’une certaine manière, pour sa part, se vanter d’avoir contribué à sauver la révolution.
Mais l’opposition des S.R.G., n’avait pas seulement un caractère politique ou de politique extérieure. Il se peut que la paix ait été l’occasion unique pour précipiter une dissidence latente, à propos d’un argument d’importance vitale pour la Russie : la question agraire.
Cette dissidence n’est certes pas récente. Au contraire, elle remonte à longtemps avant la révolution et concerne un des points les plus importants sur lesquels étaient divisés, dès leur apparition, le Parti révolutionnaire et le Parti socialiste démocratique ouvrier russe. Il serait trop long ici d’en esquisser les différences d’une manière complète[48]. Qu’il suffise de dire que le premier (dont les S.R.G. constituaient l’aile extrême qui s’en étaient détachés pendant la révolution) était celui qui se rapprochait le plus des mouvements socialistes, favorable aux accords avec d’autres partis révolutionnaires contre le tsarisme, favorable à une république démocratique fondée sur le suffrage universel et donnant beaucoup d’importance au mouvement politique, sans exclure la possibilité d’attentats terroristes. Le second, d’origine plus récente, strictement marxiste (et dont les bolcheviks sont l’élément le plus avancé) donne une importance prédominante et presque exclusive aux revendications économiques de la classe prolétaire, à la lutte de classes sur le terrain industriel, et rejette tout le reste en seconde ligne. Le premier avait le plus grand nombre de partisans parmi les paysans des différentes catégories, le deuxième recrutait spécialement parmi les travailleurs de l’industrie des villes.
Certains de leurs caractères se sont modifiés à la suite de la révolution, mais la composition des deux partis (paysans et ouvriers) a toujours exercé la même influence. Les S.R.G. avaient voulu qu’on laisse en paix les « paysans travailleurs », une espèce de petits propriétaires qui, sans avoir de salariés à leur service, travaillent eux-mêmes leur terre et ils auraient voulu aussi que ces paysans, dans les soviets de campagne, organisent la production et règlent eux-mêmes les échanges avec les villes et les autres soviets. Les bolcheviks, en revanche, voulaient imposer aux paysans leur type d’organisation et envoyaient soldats et fonctionnaires réquisitionner les produits de la terre. Les S.R.G. soutenaient que, avec ce système, « on aurait fait devenir adversaires de la révolution le plus grand nombre de paysans [49] ».
L’accusation de « sacrifier les masses paysannes au profit de la classe ouvrière » avait été portée de nouveau par Spiridonova pendant la séance du 5 juillet 1918 du congrès pan-russe des soviets[50]. En Russie, cette affirmation est très importante, car le prolétariat proprement dit, y compris les paysans salariés, est une petite minorité, et cela spécialement après la révolution, par rapport au très grand nombre de paysans qui possèdent la terre qu’ils travaillent. Il est donc évident que, même si la locution « dictature du prolétariat » correspondait effectivement (chose impossible) à la division de l’autorité étatique entre chacun des prolétaires, cela signifierait quand même toujours la dictature d’une minorité de travailleurs sur une majorité d’autres travailleurs, d’une catégorie ouvrière moins nombreuse sur une classe ouvrière plus nombreuse.
Rien de plus naturel, en conséquence, que, pour soumettre par la force une classe aussi nombreuse et indispensable de travailleurs, les plus rigoureuses mesures de dictature furent nécessaires, ainsi que le fait remarquer Radek. Celui-ci, encore en 1918, ne pouvait pas concevoir une révolution sans une lutte des ouvriers contre les paysans jusqu’à ce que ces derniers, vaincus, comprennent qu’il est de leur intérêt de s’aligner sur la révolution[51].
Mais heureusement, depuis 1918, il semble que la situation ait changé : c’est-à-dire que d’un côté, les bolcheviks, ayant compris quelle profonde erreur représentait le fait de vouloir imposer avec violence leur propre système à la majorité de la population travailleuse et productrice, sont venus à de meilleurs sentiments. D’autre part, les paysans semblent avoir compris que, après les dures leçons que leur ont infligées Koltciack, Dénikine, et Judénik – généraux de l’Entente en Sibérie, en Crimée, en Ukraine et dans la région d’Arkhange – pendant leur domination antirévolutionnaire (ils y dominent encore en quelques points), qu’il y a une très grande différence entre les réquisitions léninistes pour approvisionner les villes, et les spoliations, les destructions en masse, les carnages, la soumission imposée aux anciens patrons perpétrés par les généraux tsaristes et franco-anglais.
Toutefois l’expérience dictatoriale, dans les premiers temps, a mis en évidence par son exemple désastreux le fait que, une fois les patrons expropriés et la possibilité d’exploiter les autres enlevée à chacun, en ce qui concerne tout le reste, il vaut mieux s’entendre dans le respect réciproque des libertés, même sur la façon d’organiser la production et les échanges, plutôt que de vouloir imposer à tous par la violence un système unique fixé par un gouvernement central.
Une répercussion de cette erreur autoritaire, aggravée par l’erreur de la centralisation politique et militaire, s’est manifestée en Ukraine, avec le funeste complot, entre le général anarchiste Makhno et le gouvernement de Moscou. Les bandes de Makhno eurent des partisans en réaction aussi « à la politique agraire du Parti communiste, lequel, n ayant pas tenu compte des conditions particulières du pays, s est attirée 1 inimitié d’une partie de la population [52] ».
Mais cet épisode de la révolution russe qui concerne le général Makhno mérite d’être plus amplement connu, car il démontre un des côtés faibles du système dictatorial : c’est un document sur les conditions de la liberté en Russie qui met en évidence tout un aspect de l’activité anarchiste pendant la révolution.
L’anarchiste Makhno, de famille paysanne, instituteur en Russie méridionale avant 1905, ayant participé pendant la révolution de cette même année aux différents mouvements par une série d’attentats terroristes, fut condamné aux travaux forcés. Libéré par la suivante et victorieuse révolution de 1917, il rentra chez lui. Il y organisa la défense armée ouvrière contre les forces réactionnaires et les cosaques, qui avaient commencé leur néfaste activité. Avec de petits détachements, Makhno molestait déjà considérablement les cosaques de Kalédine et de Korniloff, lorsque, en octobre, les bolcheviks devinrent maîtres du pouvoir suprême en Russie. Ses forces augmentèrent alors, et son prestige parmi les paysans se fit encore plus grand.
Après la paix de Brest-Litovsk, il dut combattre non seulement la réaction locale, mais aussi les troupes allemandes qui occupaient la région. Les détachements de Makhno furent mis en déroute. Alors Makhno organisa la guérilla avec des bandes armées qui attaquaient les trains, désarmaient les soldats allemands, emportaient des vivres, des armes et des munitions. Les partisans de ces bandes étaient de plus en plus nombreux. Il y avait là des volontaires ouvriers, mais plus précisément des paysans. Avec ces bandes, Makhno réussit, vers la fin de l’occupation allemande, à engager de véritables batailles rangées contre les envahisseurs.
A la fin de l’occupation allemande, en 1918, l’influence de Makhno s’était étendue à Ekaterinoslav, Cernigor et Podolia. La petite armée se trouvait alors en conflit ouvert avec les troupes du directoire ukrainien et même, parfois, avec les forces bolcheviques qui ne voulaient pas reconnaître la formation indépendante. Mais par la suite, les bolcheviks, à cause de l’immense popularité de Makhno, finirent par s’entendre avec lui, et l’autorisèrent à défendre à sa manière les territoires sur lesquels il agissait. Mieux encore : pendant l’hiver 1918, le gouvernement bolchévique, inquiété par les menaces de Dénikine, confia à Makhno la charge de combattre la contre-révolution en Crimée. Et Makhno délivra l’entière péninsule.
Profitant d’une période de tranquillité, Makhno et ses amis anarchistes songèrent à établir les bases de la nouvelle société, selon leurs propres critères, sur les vastes territoires qu’ils occupaient. Ils fondèrent donc des colonies communistes anarchistes, administrées par des soviets autonomes, en rapport continu entre eux, par le truchement de représentants qui se réunissaient selon les nécessités des différentes communautés. C’était un mode d’organisation absolument différent de celui, centralisé et centralisateur, des bolcheviks, et les bolcheviks ne voyaient pas d’un très bon œil la généralisation de telles expériences.
Au début, et surtout parce que les bandes armées de Makhno savaient se faire respecter, le gouvernement bolchevique toléra les communautés anarchistes ; mais quand en avril celles-ci décidèrent de se réunir en congrès, celui-ci fut interdit. Le congrès fut quand même tenu : y furent prises des décisions importantes sur la culture de la terre, les échanges, la défense militaire, etc. Un deuxième congrès, également interdit, fut tenu en mai, et un autre encore en juin. Pendant ce dernier, il fut discuté de la situation devenue désespérée du fait de l’avance de Dénikine, dont l’armée avait été abondamment équipée par l’Entente. Bien que les bolcheviks aient déjà refusé d’envoyer des armes et des munitions, il fut décidé de renouveler une demande en ce sens à Moscou, à cause d’un danger qui menaçait non seulement les communautés anarchistes de la Russie méridionale, mais aussi toute la Russie soviétique.
Le gouvernement bolchevique refusa toute aide, ne voulant pas laisser vaincre la réaction. Makhno proposa alors de donner sa démission et de céder le commandement à ses généraux ayant la confiance du gouvernement central. Cela ne servit à rien ! Les forces de Makhno, trop faibles pour résister, furent démembrées et dispersées par l’invasion réactionnaire. Les communes libertaires disparurent. Pour mieux faire connaître la personnalité de Makhno, rappelons cet épisode : pendant la période décrite, au moment où les rapports entre Makhno et le gouvernement de Moscou étaient les plus tendus, le général Grigoriev, un traître qui s’était rebellé contre le gouvernement soviétique et qui était passé dans le camp de la réaction, crut pouvoir se servir de Makhno et le fit appeler pour créer avec lui un front commun contre les bolcheviks. Makhno y alla et dès qu’il fut en sa présence, il le tua à coups de révolver. Malgré la manière dont il avait été traité, Makhno ne changea pas d’idée. Dans l’ombre, il recommença la lutte contre la réaction, il constitua de nouvelles bandes sur les arrières de Dénikine, souleva contre lui les populations méridionales, et c’est à lui que revient le mérite si le féroce général tsariste fut battu et du fuir au-delà de la mer[53].
Vers le milieu de l’année 1920, d’après les journaux, il semblerait que Makhno ait complètement rompu avec les bolcheviks. Ses bandes tiendraient une large partie de la Russie méridionale, échappée presque complètement à la domination du gouvernement de Moscou. C’est que Makhno et ses partisans, une fois éloigné le danger contre-révolutionnaire, ont repris l’opposition intransigeante et armée contre la dictature, pour la liberté et l’autonomie. Cependant, dès que le général tsariste Wrangel, niché dès le début de 1920 en Crimée avec l’aide de l’Entente, sembla mettre de nouveau en péril la révolution, en octobre, on retrouva l’anarchiste Makhno collaborant militairement avec les bolcheviks, jusqu’au point d’accepter des missions de guerre de la part du gouvernement de Moscou. Quelque temps après, arriva en Europe occidentale la nouvelle que même Wrangel, cette autre lance brisée du capitalisme et du tsarisme, était mis complètement en fuite.
De tout ce qui a été dit, on peut tirer la conclusion suivante, à savoir que non seulement le régime dictatorial n’a pas donné la liberté à la Russie (cela lui était impossible à cause de circonstances indépendantes de sa volonté), mais aussi qu’il est incapable de la donner de par sa propre nature qui tend à la limiter et non pas à en élargir l’emprise.
Nous ne dirons pas que la constitution soviétique, dans ses statuts, est plus réactionnaire que d’autres constitutions existantes : tant s’en faut ! Elle est même susceptible d’applications ultra-libérales, nous dirons même presque libertaires. Mais l’ennui consiste dans le fait qu’elle peut aussi bien être appliquée en sens inverse, au moins jusqu’à un certain point. C’est la même question que l’on débattait autrefois avec les républicains : République d’accord ! Mais voyons un peu ce qu’on y met dedans ! Il n’existe pas, par exemple, une constitution plus libre au monde que celle des États-Unis d’Amérique ; pourtant tout le monde sait quelle sorte de république ploutocratique, autoritaire, négatrice et violatrice de toute liberté individuelle et collective, de pensée et d’action elle est devenue !
Ne nous dites pas que nous faisons des comparaisons odieuses. La concentration de l’autorité politique et militaire, telle qu’elle est appliquée en Russie, n’est pas moins pernicieuse pour la liberté que. la concentration de la richesse telle qu’elle existe aux États-Unis. La première n’a certes pas le caractère odieux de la seconde. Et puis, en Russie, il y a la révolution, au pouvoir il y a des hommes honnêtes : socialistes et ouvriers, des hommes neufs pas encore corrompus par l’exercice du pouvoir, pleins de bonnes intentions. Cependant, du point de vue de la cause de la liberté, l’aspect de la question ne change pas.
Ce que l’on entend par dictature, nous l’avons su de la bouche même de Lénine. Sa définition, pour ainsi dire officielle, est donnée par Stutka dans son œuvre de vulgarisation de la constitution russe, diffusée dans toutes les écoles qui dépendent des soviets : « Par dictature du prolétariat, nous entendons la conquête de tout le pouvoir de l’État et une consolidation contrôlée de ce pouvoir[54]. » Comment concilier cette consolidation à tout prix de la dictature avec la notion de temporalité à laquelle font souvent allusion les socialistes, cela reste un mystère. En ce qui concerne ceux qui sont investis du « pouvoir fort », Stutka explique lui-même qu’ils sont « les meilleurs lutteurs et les plus avancés ». C’est-à-dire que toute la bonté du régime repose sur la bonté des chefs, ou de ceux que la masse retient comme bons. Mais il reste toujours la possibilité de l’arbitraire, donnée à très peu d’hommes, sur le sort de la grande majorité des assujettis.
Il est vrai qu’existe la révocabilité des mandats, mais le fait est que, depuis plus de trois ans, il y a au gouvernement russe à peu près toujours les mêmes hommes. Si d’un côté cela représente le témoignage de leur honnêteté et de leur habilité, ainsi que de l’ascendant qu’ils exercent sur la foule ; d’un autre côté, cela démontre aussi la possibilité d’une consolidation non seulement du pouvoir d’une catégorie de personnes, mais aussi de personnes déterminées, prises individuellement : la dictature individuelle, selon l’expression léniniste. La loi des soviets elle-même, bien que très libérale par ailleurs, ouvre la porte à l’arbitraire aux dépens des individus ou des groupes d’individus par son article 23 qui dit : « En s’inspirant des intérêts de la classe travailleuse dans son ensemble, la République socialiste fédérale des soviets de Russie prive les individus ou les groupes isolés des droits dont ils pourraient user pour nuire aux intérêts de la révolution socialistes [55]. »
Cette formule nous en rappelle une autre, celle du statut du royaume d’Italie, selon laquelle « la presse est libre, mais la loi en punit les abus ». La république et donc son pouvoir suprême, peut, selon la constitution russe, priver de leurs droits, c’est-à-dire des droits de presse, de parole, d’association, de réunion, de vote, de propagande, de participation aux soviets, etc., aussi bien les individus que les groupes ou organisations qui en feraient un usage jugé nuisible pour la république elle-même. Par conséquent, non seulement sont visés les bourgeois restants, les réactionnaires et leurs instruments, mais aussi tous les individus et les groupes qui ne pensent pas comme les bolcheviks.
Toutes les oppositions, même les plus révolutionnaires, peuvent, par l’article 23, être mises hors la loi si on tient compte des critères autoritaires et exclusifs des bolcheviks, qui voient en toutes forces et activités indépendantes d’eux, en tous partis différents ou opposés, une menace pour la révolution ; c’est le cas des anarchistes par exemple, traités par Lénine avec tant de dureté et présentés comme des bourgeois ou petits bourgeois. Les bolcheviks eux-mêmes qui osent ne pas être d’accord avec leurs chefs sont sujets à suspicion et privés de leurs droits. Jacques Sadoul raconte, le 18 mars 1918, que le camarade Dybenko, commissaire ou ministre de la Marine, très aimé par les soldats révolutionnaires, avait été arrêté ce jour-là à cause de son opposition au traité de Brest-Litovsk, et ce dans l’intention de donner un exemple aux chefs bolcheviques qui seraient tentés de l’imiter et de passer dans l’opposition[56] ».
La composition même du régime soviétique, dont l’activité est ordonnancée du haut vers le bas et qui va du centre vers la périphérie[57] favorise, comme tout régime centralisateur, la formation et la consolidation de la tyrannie de la part des individus, des groupes ou des partis qui détiennent le pouvoir.
L’autorité gouvernementale est exercée en Russie, par le conseil des commissaires du peuple (ce qui correspond au ministère ou conseil des gouvernements bourgeois), et cette autorité n’est pas seulement exécutive, mais également législative : elle donne des instructions et des ordres et émet des décrets (art. 37 et 38 de la Constitution)[58]. Cette espèce de ministère gouverne en collaboration avec le Comité central exécutif panrusse, qui exerce l’autorité administrative, législative et de contrôle ; ce comité constitue en quelque sorte un parlement de deuxième instance, élu par le plus large congrès panrusse des soviets, qui est à son tour l’organe correspondant à nos parlements. Le congrès panrusse des soviets est, nominalement, l’autorité suprême de la république : il est composé de représentants nommés par les soviets des villes et par les soviets des provinces. Il est convoqué deux fois l’an, ou plus si cela est demandé par le comité exécutif ou par les soviets locaux, par au moins un tiers d’électeurs. Les soviets des villes sont nommés directement par les électeurs et les soviets provinciaux sont composés de délégués des soviets des villages ou des campagnes. Ont droit au vote seulement les travailleurs qui accomplissent des travaux productifs et utiles, et qui n’exploitent pas le travail d’autrui à leur propre profit.
Nous ne voulons pas procéder à un examen détaillé de la constitution russe. Nous désirons simplement faire une remarque : la volonté de la masse, pour arriver à travers les multiples élections, depuis les soviets urbains et de village jusqu’au conseil des commissaires, passe par des tris consécutifs. Chaque élection en élimine une partie, et en dernière instance, cette volonté n’est nullement représentée. En effet, si les commissaires actuels représentent les masses russes, ainsi que nous l’assurent les organes bolchéviques, cela ne se réalise pas à cause du système électoral adopté, mais malgré lui : peut-être parce que les commissaires se tiennent directement en rapport avec la masse, avec l’âme populaire, de laquelle ils tirent directement leur propre force.
Mais l’hypothèse que les actuels dictateurs en Russie représentent réellement la volonté des grandes masses reste à démontrer. Le système électoral par lequel ils se maintiennent au pouvoir, ou légalisent et justifient ce pouvoir, n’est pas à lui seul une garantie suffisante, bien au contraire.
Techniquement, le pouvoir soviétique se forme à partir de là périphérie pour arriver au centre. Les soviets de villages et de campagne forment les soviets de province, les soviets de province et les soviets des villes forment le congrès panrusse, celui-ci forme le comité central, et le comité central forme le conseil des commissaires. Tout cela avec un nombre décroissant de participants. Mais comme on l’a déjà remarqué, si la volonté de la masse, à chaque nouvelle élection (avec la relative diminution du nombre de représentants) est toujours moins représentée, il advient le contraire en ce qui concerne le pouvoir de l’autorité centrale.
La plus grande autorité, le pouvoir majeur de faire et de défaire, ne réside pas chez les soviets urbains et de village, mais chez les commissaires du peuple, et diminue, degré par degré, chez les organismes inférieurs : chaque organisme inférieur a sa liberté d’action diminuée par l’organisme immédiatement supérieur [59]. Le congrès panrusse détient aussi l’autorité suprême, y compris celle de révoquer les membres du comité et des conseils ; mais cette autorité est très réduite, du fait qu’elle est partagée entre des milliers de représentants, qui pourraient reformer une majorité en conseil, en profitant du pouvoir exécutif qu’il détient et des longs intervalles entre un congrès et un autre.
Cela est d’autant plus vrai que le pouvoir effectif, la plus grande autorité de fait, appartient au conseil des commissaires : et non seulement parce que la loi lui donne la faculté d’émettre des ordres et des décrets, aussi bien délibératifs qu’exécutifs, mais aussi et surtout parce qu’il a à sa disposition tout le bilan financier et toute la force armée de l’État. En définitive, le conseil des commissaires constitue le véritable « pouvoir gouvernemental », en ceci que l’organisme économique et l’organisme militaire sont les moyens indispensables pour l’exercer. Tous les gouvernements se servent de ce moyen pour se maintenir au pouvoir, c’est la loi de la conservation, valable aussi bien pour les individus que pour les collectivités. Le gouvernement bolchevique n’est pas une exception à la règle. « Les bolcheviks n’ont pas du tout envie d’abandonner le pouvoir, et avant tout parce que beaucoup d’entre eux y ont pris goût[60]… »
Quand on a la force dans les mains et la ferme conviction d’être les seuls possesseurs de la vérité et les sauveurs du genre humain (le défaut dogmatique de Torquémada, mais aussi de Robespierre et de Lénine), les législations écrites n’ont plus aucune importance. Et puis avec un peu de bonne volonté, il y a toujours moyen de mettre d’accord la loi et l’arbitraire… Les sujets de tous les gouvernements savent très bien qu’il est possible de subir les pires injustices avec toutes les formalités sacrées de la loi.
Il semblerait bien que quelque chose de semblable soit connu aussi par les sujets de la dictature bolchevique. Le 15 avril 1918, Sadoul[61] écrivait à son ami Thomas : « Les partis de l’opposition, dont les S.R.G. et les anarchistes, dénoncent la politique bonapartiste de Lénine et de Trotsky, qui disposent comme ils veulent des soviets[62], en leur arrachant le pouvoir petit à petit, et en s’acheminant à grands pas vers la dictature. En effet, les bolcheviks font une politique des plus despotiques. Ils dissolvent l’un après l’autre les soviets locaux suspects d’hostilité au gouvernement. Les membres des soviets ne sont plus des parlementaires, mais des fonctionnaires. Chacun d’eux est affecté à une commission administrative dans laquelle il a une tâche déterminée, en obéissant en cela aux directives du Comité central exécutif, représenté dans les régions par les commissaires qui peuvent exercer le pouvoir le plus absolu. »
Tout de suite après, Sadoul, dans l’intention de défendre les bolcheviks contre les accusations de despotisme lancées par la presse de l’Entente, ajoute : « Certes, les critiques de l’opposition sont fondées, mais en quoi ces tendances dictatoriales peuvent-elles gêner les alliés de l’Entente ? Après tout, ces tendances n’ont d’autre but que de centraliser l’autorité, de créer un gouvernement qui légifère selon un programme, qui est de plus en plus proche de celui qu’ont mis en œuvre pendant la guerre les dirigeants des républiques bourgeoises. »
N’oublions pas que ces informations et impressions de Sadoul remontent à plus de deux ans, et que les défauts auxquels il fait allusion peuvent aussi bien avoir diminué qu’augmenté ou… avoir été consolidés. Certes, l’argument porté par Sadoul pour défendre les bolcheviks, à savoir que leur système de gouvernement ressemble de plus en plus au système bourgeois en temps de guerre, du point de vue révolutionnaire socialiste et anarchiste est l’accusation la plus atroce. Si les impressions et les nouvelles de Sadoul sont exactes (personne jusqu’ici ne les a démenties, alors qu’il y a toujours de nouveaux éléments qui les confirment), la grossière équivoque de ceux qui confondent soviets et dictature deviendrait évidente même pour un aveugle et serait sans aucun doute balayée.
Non seulement soviets et dictature ne sont pas la même chose, mais l’un est l’opposé de l’autre, ils ne peuvent coexister sinon nominalement, c’est-à-dire à condition que l’un des deux renonce à vivre pour lui-même, et donc à sa raison d’être, pour devenir l’instrument de l’autre. Et il est naturel qu’entre les deux institutions, la plus faible, à savoir celle qui est en bas de l’échelle de l’autorité et sans moyen propre de défense et d’attaque, le soviet, soit condamnée à perdre sa personnalité et sa raison d’être et soit subordonnée à l’institution la plus forte, c’est-à-dire à l’État dictatorial qui se trouve au sommet du pouvoir et dispose, selon son propre arbitre, de toute la richesse et de toute la force armée du pays.
L’histoire des rapports entre les soviets et la dictature n’est en somme qu’un nouvel épisode de la lutte éternelle entre la liberté populaire et l’autorité de l’État.
La dictature bourgeoise de la révolution
Le gouvernement dictatorial socialiste de Russie n’est pas la réalisation d’un programme élaboré de longue date, voulu par un parti ou désiré par les hommes de ce parti ; il s’est plutôt instauré parce que, à un certain moment et contrairement à ce qu’ils avaient pu penser auparavant, ces hommes ont vu dans la prise du pouvoir le meilleur moyen, offert à eux par les circonstances, pour imposer leur propre domination et essayer de réaliser leurs propres idées.
Avant la révolution de mars 1917, l’expression « dictature du prolétariat » n’était usitée que de manière assez vague par la plupart des socialistes, mais aussi par les bolcheviks. Elle sous-entendait l’idée d’une réalisation autoritaire de la révolution au moyen de l’État, sans bien préciser la forme étatique à adopter. En somme, c’est l’idée que le prolétariat puisse finalement imposer son autorité de la manière la plus absolue, à la façon des dictateurs de jadis, mais sans insister sur la manière dont l’État socialiste s’y prendrait pour exercer une telle dictature.
Bien mieux, chaque fois que les socialistes, bolcheviks russes y compris, parlaient de l’État en tant qu’organe exécuteur de la volonté d’expropriation du prolétariat, ils le concevaient toujours selon l’ancienne signification démocratique : une « constituante » élue au suffrage universel. On a déjà noté que telles étaient les idées de Lénine avant la révolution. Le troisième congrès du Parti socialiste démocratique russe de 1905, qui peut, en fait, être considéré comme le premier congrès du parti bolchevique, mettait comme base de son programme la substitution d’une république démocratique à l’absolutisme : « L’installation d’une république démocratique en Russie, pour les intérêts du prolétariat et pour le but final du socialisme, n’est possible qu’en tant que résultat d’un soulèvement victorieux du peuple et l’organe du peuple sera le gouvernement révolutionnaire provisoire, seul capable d’assurer la pleine liberté électorale et de convoquer, sur la base du suffrage universel, égal et direct, à bulletin secret, une assemblée constituante qui exprime la véritable volonté du peuple[63]. »
La même année, le Parti socialiste démocratique (bolchevique) en Russie, aux premiers mouvements insurrectionnels, fit circuler dans le peuple un manifeste qui se concluait justement par le cri : « Vive la révolution ! Vive la Constituante ! Vive l’assemblée des représentants du peuple[64] ! »
Ce programme est resté le programme du parti bolchevique jusqu’à la révolution de 1917. Ce fut de mars à novembre 1917 que les bolcheviks commencèrent à douter de ce que, à l’image de tous les sociaux-démocrates, ils considéraient comme une vérité. A savoir que le suffrage universel puisse effectivement soustraire le gouvernement à la bourgeoisie, et qu’il suffirait pour l’obtenir d’assurer aux travailleurs l’entière liberté de vote, égal et secret. Ils comprirent l’importance et l’influence des soviets et ils s’efforcèrent de devenir majoritaires en leur sein, spécialement dans les grands centres. Ils comprirent l’importance et la nécessité de la force armée, et s’assurèrent la sympathie des soldats par leur politique antiguerre, pour la paix à tout prix et par leur propagande contre la discipline militaire. Ils réussirent à avoir l’armée de leur côté et à l’encadrer pour l’insurrection.
Mais jusqu’à ce que la Constituante se réunisse, et qu’il apparaisse évident que les élections ne pouvaient pas donner une véritable majorité au prolétariat ni arracher le gouvernement aux mains de la bourgeoisie et de ses alliés sociaux-patriotes et sociaux-réformistes, les bolcheviks conservèrent encore l’illusion, un peu atténuée peut-être, de pouvoir se servir de la constituante comme d’un instrument révolutionnaire et d’une arme à leur complète disposition.
Au mois de juillet 1917, pendant que dans les rues de Pétrograd faisait rage la bataille entre les soldats encore fidèles à Kerensky et les bolcheviks, ces derniers diffusaient et prônaient un programme qui était encore social-démocrate ; c’est-à-dire qui demandait une république plus démocratique, sur la base du suffrage universel et d’un parlement élu pour deux ans[65]. Parmi les critiques qu’ils formulaient à l’adresse de Kerensky, il y avait justement celle de retarder toujours davantage la convocation de la Constituante, considérée comme « un pas en avant nécessaire » par Lénine lui-même, alors que ses partisans étaient encore minoritaires au sein des soviets.
Dès la fin d’avril, Lénine demandait le « transfert du pouvoir au prolétariat, aux classes les plus pauvres des paysans, et une république des conseils ouvriers », mais l’incompatibilité d’une telle demande avec la Constituante n’apparaissait pas bien clairement aux bolcheviks, et elle devait être prouvée dans les faits seulement au mois de janvier suivant. Et même en janvier, ils essayèrent d’expliquer, au moins en partie, et de s’excuser de la dissolution de la Constituante par le fait que les élections avaient eu lieu sur la base de listes trop anciennes qui ne répondaient plus à une exacte représentation des partis et, qu’en conséquence, « les électeurs avaient été mis dans l’impossibilité d’exprimer leur volonté[66] ».
Tant qu’ils avaient eu un espoir d’y être majoritaires, les bolcheviks n’avaient pas répudié la Constituante. En effet, ils participèrent si activement à la campagne électorale, avant et après la révolution d’Octobre, qu’ils s’assurèrent un nombre de mandats tel qu’ils faisaient de leur parti le plus fort de la Constituante. Seulement, ils étaient toujours minoritaires face à la coalition des autres partis, bien que les socialistes révolutionnaires de gauche fussent avec eux…
Les élections eurent matériellement lieu sous le contrôle des bolcheviks, et c’est par un décret des commissaires du peuple qu’elles furent fixées au 12 novembre, et se prolongèrent au-delà du 25 du même mois. Les hostilités contre la Constituante commencèrent dès que l’on sut que les résultats assuraient la majorité aux partis bourgeois et socialistes modérés coalisés. Le gouvernement bolchevique, bien que la considérant comme adversaire, la respectait tout de même encore, mais pas le peuple. Les premières réunions non officielles de la Constituante, les 28 et 29 octobre, furent dissoutes par la foule des révolutionnaires, spécialement par des soldats et des marins sans ordres du gouvernement. Le 18 décembre, le conseil des commissaires du peuple fixa la date d’ouverture « officielle » de la Constituante pour le 5 janvier 1918.
Dans sa première séance, et à la majorité, la Constituante refusa de sanctionner le principe du pouvoir des soviets. Les bolcheviks se retirèrent et l’assemblée continua sur des discussions sans intérêt, sous les huées de la foule amassée dans les tribunes. Le lendemain, 6 janvier, la Constituante fut déclarée dissoute, en tant qu’assemblée contre-révolutionnaire. En réalité, même sans ce décret dictatorial, elle était déjà un corps mort, car elle avait contre elle tout le peuple des prolétaires, les soviets et les soldats. Comment aurait-elle pu exister encore sans une assise parmi les masses et sans l’appui des militaires ? Le gouvernement bolchevique n’avait fait que cueillir le fruit déjà mûr.
Sans la révolution d’Octobre et la liquidation de la Constituante, on n’aurait pas pu empêcher la dictature.
Les démocrates, les socialistes modérés et les réformistes se disent scandalisés par la « tyrannie bolchevique » et certaines de leurs critiques sont justifiées ; mais, quand ils affirment qu’avec la Constituante on aurait eu une plus grande liberté ou une tyrannie moins pesante, ou bien ils se font des illusions, ou bien ils veulent nous tromper. On aurait évité une dictature socialiste bolchevique, mais on aurait eu une dictature bourgeoise de la révolution. En Russie, de mars à octobre, les partis au pouvoir avant d’être balayés par les bolcheviks n’eurent qu’un but : donner à la révolution une dictature bourgeoise et la consolider autant que possible. Il était donc nécessaire de combattre cette tentative et, en le faisant, les bolcheviks, avec le concours des anarchistes, ont rendu à la révolution un service inestimable.
La conception bourgeoise démocrate d’une révolution qui confie son développement ultérieur, après avoir abattu l’ancien gouvernement, à une constituante élue au suffrage universel, est désormais discréditée, grâce à la révolution russe, aux yeux du prolétariat occidental, et tout spécialement en Italie. Ici, pour le plus grand tort de cette très malheureuse idée, ceux qui s’en font les interprètes sont justement ceux qui pendant quatre ans, à partir de 1914, ont essayé de justifier la politique de guerre de nos gouvernements, avec leurs parlotes et leurs illusions sur la Société des nations, les États Unis d’Europe, l’indépendance des nations, l’autodétermination des peuples, etc.
Parmi les socialistes, y adhèrent les courants les plus modérés, réformistes et collaborationnistes.
Que peut-il y avoir de révolutionnaire, en effet, dans la propagande menée par certains partis en faveur de la constituante ? Nous ne le voyons guère. Ne le voient pas non plus les plus éclairés des conservateurs bourgeois et monarchistes, qui déclaraient l’accepter il y a de cela quelque temps, en lui donnant la même signification que celle du parlement, lequel selon l’idée de Camillo Cavour (qui est au-dessus de tout soupçon) peut toujours modifier les lois de l’État par des lois successives. En effet, la constituante n’est jamais qu’une chambre des députés qui se propose de revoir la constitution, ou d’en faire une nouvelle. Mais, si les députés le veulent, ils peuvent le faire dès maintenant avec le parlement tel qu’il est et avec les lois actuelles.
Bien que le statut Albertin (statut accordé par Charles-Albert, roi de Savoie, en 1848) soit un des plus arriérés d’Europe, il n’est tout de même pas semblable à celui d’il y a soixante-dix ans. Lorsque les députés l’ont bien voulu, c’est-à-dire quand le gouvernement l’a permis, ils y ont apporté des modifications substantielles. La dernière est la récente et toute nouvelle loi électorale. Bien sûr, cela n’a fait que démontrer que plus on change, plus c’est la même chose.
Déjà auparavant, on avait proposé au peuple italien la convocation de la Constituante. C’est en 1900 que l’on sortit en pleine séance de parlement cet épouvantail. Parmi ceux qui la proposaient, il y avait le républicain Pantano, qui finit par devenir ministre monarchiste, tandis que Bissolati l’appuyait en criant « A bas le Roi », et que les députés socialistes faisaient de l’obstruction à la tête de toute l’extrême gauche parlementaire.
Mais à ce moment-là, ce fut à l’Avanti ! lui-même de convenir que toute la politique de l’extrême gauche parlementaire, y compris donc la proposition de la Constituante, avait pour but d’éviter l’éventualité d’un soulèvement populaire dans la rue.
Nous nous rappelions pour notre part[67] avoir mis en garde un grand nombre d’éléments ouvriers qui, attirés par la nouveauté de la chose (tout comme aujourd’hui par la dictature prolétarienne), se chauffaient un peu trop à ce feu de paille. Nous démontrions la nécessité de s’opposer à cette idée hybride de la constituante qui menaçait de devenir un piège dangereux pour la partie du peuple qui avait déjà acquis une relative conscience de ses buts et de ses forces. A ces travailleurs, nous leur expliquions qu’ils donnaient l’impression de ne pas s’être débarrassés des vieux préjugés jacobins et autoritaires, et que leur volonté révolutionnaire semblait donc être plus verbale que positive, plus impulsive que consciente.
Mais cette petite poussée de fièvre à propos de la Constituante passa en peu de temps et l’on n’en parla plus.
Nous en reparlons, nous, en précisant nos idées à ce propos, à la lumière de nouveaux faits historiques très récents et de la situation actuelle. Ne fût-ce que pour démontrer comment l’esprit bourgeois conservateur n’a même pas la capacité de trouver des armes et des habits nouveaux, et qu’il ne sait recourir qu’à des vieilleries, rouillées ou en haillons.
Qu’est-ce donc que la constituante ? La constituante n’est pas autre chose qu’une assemblée de représentants, élus par le peuple au suffrage universel, pour revoir ou rénover la charte constitutionnelle de l’État ; charte qui représente le pacte légal entre gouvernants et gouvernés. La critique de cette idée englobe toute la critique que les anarchistes portent au suffrage universel.
Après 1848, la manière de voter a changé plusieurs fois, et le suffrage a été toujours davantage élargi. Ainsi en 1880 (pour ne parler que des innovations les plus importantes), en 1912, et il le sera encore plus à l’occasion de la prochaine législature, avec l’admission au vote des femmes. Tout cela cependant n’a pas changé, et il est aisé de prévoir que cela ne changera pas la constitution organique et la composition du parlement. Le commandement reste, en tant que classe, à la bourgeoisie, et politiquement à la monarchie. Qu’est-ce qui laisse espérer aux républicains, aux socialistes réformistes, aux parlementaristes de gauche, qu’en changeant le nom du parlement, on en change aussi la substance ?
Il ne faut pas croire que, seulement parce que l’on aura dit au peuple : « Va voter pour les membres du parlement » que la masse électorale (appelée aux urnes en régime actuel) cesse d’être la même, change et se comporte autrement que lors des élections précédentes. Car, de toute façon, le manche reste dans les mains du gouvernement monarchiste, et le capitalisme conserve toute sa force de cohésion, de coercition et de corruption ; tandis que le peuple, lui, dans sa grande majorité reste désarmé et ignare. La manœuvre électorale ne pourra donner autre chose qu’une constituante qui ressemblera au parlement actuel, comme une goutte d’eau ressemble à une autre goutte d’eau. Il n’y aura rien de changé.
Mais on se sera moqué du peuple, on l’aura endormi avec une nouvelle illusion. Entre-temps, la bourgeoisie aura réussi à se renforcer, à rendre plus solides ses appuis étatiques, secoués et usés par la guerre, elle aura réussi à gagner du temps, et à traverser sans trop de secousses la crise actuelle, en évitant ainsi la révolution, sauvant en même temps ses propres privilèges, économiques et politiques.
Pour qu’à ce changement de nom puisse correspondre un certain changement de substance, aussi petit soit-il, il faudrait que cela soit obtenu par une révolution et non par voie légale. Entendons-nous bien, même en un tel cas, nous serions opposés, en tant qu’anarchistes, à la conception étatique de la constituante car si la révolution s’arrêtait à cela, ce serait la tuer à la naissance. Mais en somme, un changement, tout au moins de forme, se serait réalisé. Les républicains pourraient pour le moins espérer leur république ! Mais que les républicains, les socialistes, même réformistes, et certains ex-syndicalistes anti-étatiques de notre connaissance brandissent le grand drapeau de la constituante, en espérant y arriver par l’agitation électorale, cela est tellement ridicule que l’on ne peut croire que ce soit sérieux.
En effet, il n’est pas difficile de discerner, parmi les partisans de la constituante, à côté de quelques adorateurs de bonne foi des utopies les plus fossilisées d’une démocratie dépassée, des monarchistes déclarés et certaine racaille qui, sous le masque démagogique ultralibéral, cachent les pires desseins de dictature militaire et la plus profonde des haines pour la classe ouvrière.
Mais il est inutile de s’arrêter sur cette conception de la constituante obtenue par l’action électorale et parlementaire, il serait peut-être plus utile d’examiner le rôle qu’elle pourrait remplir dans la révolution, au cas où celle-ci prendrait une direction autoritaire et modérée, jusqu’au point de faire confiance à l’œuvre législative d’une assemblée nommée au suffrage universel.
Donner à la révolution une constituante comme guide et comme point de départ, après le renversement des gouvernements actuels, signifie tout simplement remettre entre les mains de la bourgeoisie le pouvoir suprême de l’État, c’est-à-dire la dictature. La constituante implique par elle-même une forme de gouvernement, et donc un arrêt de la révolution ; et à ce propos nous répétons les dommages possibles qui en dérivent pour la cause révolutionnaire. Nous en avons déjà parlé dans ces pages, et nous insisterons encore sur le fait que l’influence d’un État, quel qu’il soit, dictature ou autre forme quelconque de gouvernement, est extrêmement néfaste pour une révolution quelle qu’elle soit, même si cet État, cette dictature ou ce gouvernement, se disent prolétaires ou révolutionnaires. Mais avec la constituante il y aurait ceci de pire que la dictature, le gouvernement ou l’État seraient assurés, sans faute, dès le premier moment, à la bourgeoisie.
La dépendance économique des travailleurs demeurant ce qu’elle est, et les capitalistes restant toujours la classe dominante, la nouvelle assemblée législative et constituante ne pourrait être autre chose que le reflet de telles conditions ; autrement dit, la bourgeoisie dominerait l’assemblée, tout comme elle domine la vie sociale toute entière. Elle aurait la majorité et le gouvernement serait formé par ses propres soins. Ainsi les travailleurs seraient toujours exploités et malmenés, comme sous l’ancien gouvernement. Il n’est même pas improbable, le cas s’étant déjà vérifié, que les assemblées élues, issues de la révolution, restaurent le trône mis à bas ou tout au moins en changent le monarque.
Il pourrait sembler étrange que l’idée de la constituante ait eu tant de prestige dans le passé parmi les révolutionnaires, ce qui nous amènerait à penser qu’en politique les gens donnent beaucoup plus d’importance aux apparences qu’à la réalité. Puisque constituante il y a eu chaque fois qu’on a fait une révolution, on a fini par confondre celle-là avec celle-ci ; sans songer que, après chaque révolution, les classes dominantes ont cherché, justement dans l’assemblée constituante, le moyen de se sauver, d’arrêter la révolution, d’ériger une digue contre les croissantes prétentions du peuple, en n’hésitant pas à perpétuer souvent de véritables massacres à l’encontre de ceux qui avaient eu confiance en elle.
Cela s’est vérifié dès la première révolution française, où l’assemblée représentative fut continuellement remorquée ou poussée, piques aux reins, par les masses insurgées, par les révolutionnaires des sections et des faubourgs. Chaque fois que l’émeute et l’action populaire devaient faire une halte, l’assemblée s’orientait immédiatement vers la contre-révolution, en sauvant à peine les apparences. À l’assemblée, avant l’émeute du 10 août 1792, les républicains pouvaient se compter sur les doigts de la main. Mais quand le peuple, au cours de l’année, eut la supériorité dans la rue, alors tous les députés devinrent républicains. Déjà ce fut l’assemblée constituante qui avait envoyé, en juillet 1791, la garde nationale disperser à coups de fusils une démonstration pacifique au Champ-de-Mars, simplement parce qu’elle était antimonarchiste. De même trois ans 109 après, c’est la Convention elle-même qui commença la contre-révolution en abattant les montagnards, en préparant la route à Bonaparte et au retour des Bourbons, profitant de la fatigue populaire et de l’énergie amoindrie des masses révolutionnaires pour instaurer la plus féroce des dictatures bourgeoises et conservatrices.
Ainsi après la révolution parisienne de 1848, qui depuis février avait pris une allure décidément républicaine socialiste, il a suffi d’organiser des élections et de former la Constituante pour arrêter le mouvement. L’assemblée était devenue le centre de la réaction, et lorsque les ouvriers et les socialistes, qui avaient eu la malencontreuse idée de laisser un répit à la bourgeoisie par amour de la république, s’aperçurent du piège et essayèrent de s’en sortir, il était désormais trop tard. La Constituante fit écraser, par le dictateur militaire Cavaignac, toutes les velléités de résistance ouvrière avec les massacres de juin. Il y eut aussi ce que Malon appela la « deuxième défaite » du prolétariat français, qui permit l’abjecte expédition contre la république romaine en Italie pour défendre le pape, ainsi que l’accès au trône du deuxième Bonaparte. La révolution fut ainsi punie pour avoir confié son sort aux résultats du suffrage universel.
Alors, peu à peu, cette grave erreur fut remarquée et déplorée par deux esprits clairvoyants, bien qu’ils fussent les précurseurs de deux orientations tout à fait opposées du socialisme, l’une anarchiste et l’autre autoritaire, c’est-à-dire Pierre-Joseph Proudhon et Karl Marx.
Le 29 avril 1848, Proudhon écrivait : « Un des premiers actes du gouvernement provisoire, acte duquel il s’est ensuite vanté, ce fut l’application du suffrage universel ; et le jour même de la promulgation du décret, nous avions écrit ces mots précis : « le suffrage universel est la contre-révolution ». À ce moment-là, ces mots semblaient un paradoxe ; mais par la suite les événements lui ont donné raison, hélas ! » Il continuait par une magnifique démonstration prouvant pourquoi le suffrage universel ne peut donner que de tels résultats. Et il concluait : « Plus on se servira de ce système, et tant que la révolution économique ne sera pas un fait accompli, plus on reculera vers le monarchisme, le despotisme et la barbarie… »
L’article intitulé « La réaction » avait été écrit, remarquons-le, dans Le Représentant du peuple de Paris, juste après les élections de la Constituante, qui avaient eu lieu le 16 avril 1848. Il débutait par un cri d’angoisse : « La question sociale est ajournée… La cause du prolétariat, proclamée avec tant de passion sur les barricades de février, est perdue aux élections d’avril. À l’enthousiasme du peuple a succédé la consternation : c’est la bourgeoisie qui réglera, tout comme avant, les conditions des travailleurs [68]. »
Quatre ans après, en 1852, Karl Marx, en étudiant les causes du coup d’État de Napoléon III, faisait les mêmes réflexions, avec un langage différent et plus froid, dans plusieurs articles pour une revue américaine ; articles qui ont été par la suite recueillis en un volume[69]. Selon lui, la Constituante de 1848 avait été la constitution de la république bourgeoise. Il écrivait : « Elle (la Constituante) était une vivante protestation contre les journées de février, et elle avait pour but de limiter les résultats de la révolte à la réalisation des requêtes de la bourgeoisie elle-même. Et c’est en vain que le prolétariat parisien, le 15 mai, avait essayé par la force de défaire et de décomposer dans ses différents éléments cet organisme chez lequel s’était installé l’esprit réactionnaire de la nation. »
Mais est-il vraiment nécessaire de remonter aussi loin dans l’histoire et de consulter les auteurs du passé alors qu’on a devant les yeux la sanglante réalité du présent ?
Deux révolutions sont en cours en Europe, sous nos yeux, et leurs expériences s’accomplissent d’une manière opposée l’une à l’autre. En Russie la révolution a assumé un caractère décidément prolétarien et socialiste, mais pour se mettre sur cette voie, il lui a fallu d’abord débarrasser le terrain du piège de la constituante. Les bolcheviks eux-mêmes, qui sont des socialistes d’État, et bien qu’ils aient participé aux élections en tant que parti le plus important de la Constituante (mais non pas majoritaire), après quelques hésitations, ont dû ratifier le fait accompli de l’insurrection populaire, et prononcer sa dissolution. Les insurgés, ouvriers et soldats, avaient rendu impossible de façon révolutionnaire l’existence de l’assemblée. Les socialistes maximalistes sanctionnèrent sa fin par un décret officiel de dissolution. Ce qui leur a permis de s’installer au pouvoir. Mais une des raisons pour lesquelles la révolution a été sauvée des pièges de la réaction intérieure fut justement ce fait, le premier dans l’histoire des révolutions, d’avoir supprimé le parlementarisme bourgeois et mis fin au mensonge du suffrage universel..
En Allemagne la révolution s’est déroulée tout autrement. Après les premiers jours, pendant lesquels la révolte populaire avait pris une orientation intéressante, la bourgeoisie et le militarisme, aidés par les sociaux-démocrates, reprirent le dessus. Et ils s’empressèrent de donner à la révolution, la vieille et classique orientation étatique, en commençant par l’élection de l’Assemblée constituante au suffrage universel. Et ce qui devait arriver arriva, il se reproduisit en plus grand le phénomène de la révolution française de 1848. Les paroles de Proudhon pouvaient être répétées pour l’Allemagne. Là aussi, le premier jour des élections a été le premier jour de la contre-révolution et de la réaction. Les « spartakistes » le comprirent et donnèrent l’alerte. Ils s’abstinrent aux élections, mais ce fut inutile. La majorité du prolétariat, habituée à agir comme un troupeau de moutons, tomba dans le piège tendu par la bourgeoisie libérale et par la social-démocratie.
Le régime de la constituante, encore une fois, tout comme en 1794, en 1871, etc., n’a pas été autre chose dans l’Allemagne de 1918–1919, que l’enterrement en grandes pompes de la révolution ; le masque social-démocrate de la dictature bourgeoise fut personnifié à un certain moment par Noske. D’ailleurs, ce qui rend dictatorial ce régime, malgré les apparences démocratiques, c’est le fait que le pouvoir économique reste dans les mains d’un groupe de privilégiés, de patrons. Et tant qu’il y aura des patrons, on peut dire que, dans un certain sens, ils seront et resteront les vrais dictateurs.
En Russie la révolution vit encore, en Allemagne elle semble déjà morte. C’est pourquoi le capitalisme franco-anglais (pour l’intérêt duquel le tsar a fait massacrer des millions de Russes sur le front oriental, et contre lequel la Russie n’est jamais entrée en guerre) hait la république slave et essaye d’affamer, par un blocus des plus meurtriers, des millions et des millions de ses habitants. C’est pour la même raison d’ailleurs que le capitalisme franco-anglais, toujours lui, pactise et commerce pacifiquement avec son ennemie désormais instruite, la République allemande. Il se pourrait même qu’il préfère lui envoyer ses produits et ses denrées alimentaires, plutôt qu’à certains États « alliés fidèles » de notre connaissance, mais plus pauvres, et donc source d’ennuis et d’embarras.
Mais il n’a pas tous les torts : car la république issue de la constituante allemande a sauvé de la révolution toute l’Europe centrale ; et elle est devenue un des points d’appui de la bourgeoisie internationale, la digue contre l’avancée de la révolution, d’orient en occident. Le social-démocrate Noske, en reconstituant d’après le mandat de la Constituante le militarisme allemand, en assassinant Liebnecht, Rosa Luxembourg, Landauer et les insurgés communistes de Berlin et de Münich, assurait la réaction internationale et la domination incontestée du capitalisme sur le prolétariat au bénéfice des États d’Occident. Et la bourgeoisie, même la plus intransigeante pendant la guerre contre le militarisme prussien, remettait de ses propres mains le kaiser sur le trône, pourvu qu’elle puisse continuer, sans être dérangée, à garder soumise la classe ouvrière.
Ceci explique pourquoi, aujourd’hui, ceux qui sortent du tas d’immondices de la vieille démocratie décrépie cette idée dépassée de la constituante (remise en vogue par l’Allemagne bourgeoise pour piéger le prolétariat avec le suffrage universel et le priver ainsi des fruits de la révolution) sont pour la plupart les mêmes qui bannissaient tout ce qui était allemand. Justement, les mêmes, qui voient s’accomplir en Allemagne pour la énième fois une ignoble tromperie, demandent que parmi nous aussi soit instauré le piège de la constituante contre le prolétariat en route vers sa liberté intégrale, d’une manière pacifique ou « révolutionnaire ».
L’expérience russe est déjà une preuve de la supériorité révolutionnaire de tout mouvement capable d’éviter le piège de la constituante. Mais il ne faut pas se fier seulement aux apparences, à des formules qui ne renferment rien, ni aux nouvelles appellations qu’on a substitués aux anciennes.
Il est indéniable que la révolution russe est plus radicale et qu’elle a avancé sur la voie du socialisme beaucoup plus loin que la révolution allemande. Mais en Russie, aussi, reste en germe le danger que les assemblées soviétiques, elles-mêmes, dégénèrent dans une forme de parlementarisme, avec les défauts et les conséquences désastreuses des constituantes bourgeoises, jusqu’à ce que l’expropriation ne soit pas un fait réellement accompli. Au cas où les formations capitalistes arriveraient à s’y maintenir ou si une quelconque possibilité d’accaparement et d’exploitation était encore envisageable (ne serait-ce que sous l’aspect de concessions au capital étranger ou d’arrangements transitoires avec le capital indigène), on risque de voir la bourgeoisie restante finir par s’insinuer dans les assemblées et dans le gouvernement même, et que peu à peu, par la force de son pouvoir économique, elle parvienne à se rétablir et à imposer, peut-être sous de nouvelles appellations puisées dans le vocabulaire socialiste et révolutionnaire, sa propre domination, fidèle en cela à sa nature propre d’adaptation.
Mais de cette nécessité immédiate de l’expropriation pour consolider la révolution, nous en parlerons par la suite. Les révolutionnaires, pour le moment, doivent faire attention à ne pas creuser eux-mêmes la fosse dans laquelle ils pourraient être engloutis, en confiant le sort du futur mouvement libérateur à ces assemblées où les agneaux croient pouvoir s’asseoir d’égal à égal à côté des loups et les exploités à côté des exploiteurs. Qu’ils en soient conscients ou non, ils prépareraient pour le peuple qui s’avance la pire et la plus sanglante des trahisons, le piège le plus dangereux sur la voie du progrès. Que le peuple lui aussi guette le danger et en temps voulu sache l’esquiver.
Communisme autoritaire et communisme anarchiste
En examinant les idées des socialistes « bolcheviques » – qui ont repris le nom de communistes en 1848 –, on avait incidemment fait remarquer que pendant les dernières quarante années, ce sont presque exclusivement les anarchistes qui se sont appelés communistes et ont donné le nom de communisme à leur idéal de reconstruction sociale dans le domaine économique.
Les socialistes autoritaires avaient cessé de se déclarer communistes bien avant 1880 et préféraient donner à leur idéal de réorganisation sociale le nom de collectivisme. Cet idéal concevait la future société politiquement sous forme républicaine pour chaque État, et économiquement avait pour but la socialisation des moyens de production et d’échange, avec la distribution des produits pour les travailleurs selon le travail de chacun.
En revanche, les anarchistes qui avec Bakounine, De Paepe, etc., s’étaient jusqu’à cette époque appelés collectivistes, abandonnèrent ce nom (sauf en Espagne où la majorité des anarchistes continua à se dire collectiviste jusqu’après 1890). Et au cours des derniers congrès de la moribonde Internationale, tout spécialement dans le Jura et en Italie de 1877 à 1882, ils embrassèrent le communisme, trouvant que cette conception répondait davantage, par son organisation de la production et de la consommation, à la société libre, sans gouvernement, de leur propre idéal. Ceux qui contribuèrent le plus à cette nouvelle orientation de l’anarchisme furent les Italiens Malatesta, Cafiero, Costa et plus tard Kropotkine et Reclus.
Le congrès de l’internationale italienne, tenu clandestinement aux environs de Florence en 1876, approuva une motion communiste sur proposition de Errico Malatesta. En 1877, l’Arbeiter Zeitung de Berne élaborait les statuts d’un « Parti anarchiste communiste de langue allemande ». Et en 1880, le congrès de la Fédération internationaliste du Jura à La Chaux-de-Fonds approuva le mémoire présenté par Carlo Cafiero sur l’Anarchie et le Communisme. Cet opuscule, sous ce même titre, a été depuis publié nombre de fois pour la propagande.
Les anarchistes s’appelaient alors indifféremment socialistes ou anarchistes, et ils préféraient, même, se faire appeler socialistes. Mais quand ils voulaient préciser, ils se disaient socialistes anarchistes ou, ainsi qu’il en est encore maintenant, « communistes anarchistes ». Leur idéal, concrétisé synthétiquement dans le mot « anarchie », pris dans sa propre signification d’organisation libertaire d’une société socialiste, s’est aussi toujours appelé, et peut encore s’appeler maintenant socialisme anarchiste, et plus précisément « communisme anarchiste ».
Presque toute la littérature anarchiste est socialiste dans le sens communiste depuis bientôt quarante ans et peu de temps avant la guerre, c’était nous, les anarchistes, les seuls communistes, car les socialistes autoritaires, à quelques très rares exceptions près, étaient tous et partout des collectivistes. Le collectivisme légaliste et étatique d’un côté, et le communisme anarchiste et révolutionnaire de l’autre, étaient les deux écoles du socialisme de 1880 jusqu’à 1917, date à laquelle Lénine, de Russie, voulut rompre avec la deuxième Internationale des traîtres en changeant même de nom.
Pendant les congrès de celle-ci et jusqu’à ce qu’ils en soient violemment et injustement exclus, les anarchistes défendaient l’idéal communiste et ces défenseurs s’appelaient Kropotkine et Reclus, Malatesta et Gori, Louise Michel et Most, etc. Que de polémiques ont-ils engagées, en ces années-là, avec les socialistes marxistes pour soutenir la formule communiste contre leur collectivisme de caserne, si impossible et en même temps si opportuniste ! Il y avait certes de l’exagération dans nos disputes autour d’une formule, pour soutenir que la répartition des produits en régime socialiste devait être effectuée selon les besoins (communisme) et non selon le travail (collectivisme). La question avait alors moins d’importance que tant d’autres nettement plus urgentes ; alors qu’aujourd’hui, il faudrait penser davantage à ce qu’il conviendrait de faire concrètement après la victoire prolétaire.
Les collectivistes et les communistes étaient d’accord dans la lutte contre le monopole de la propriété et voulaient la socialisation de la terre, des moyens de production et d’échange. Ils étaient d’avis contraires cependant, sur la manière de répartir la production. Comme nous l’avons déjà dit, pour les collectivistes cela devait avoir lieu en donnant « à chacun le produit de son travail » ou mieux en rétribuant « selon son propre travail » ; pour les communistes, en revanche, cela devait être fait « à chacun selon ses besoins ». Les anarchistes se rallièrent à la deuxième formule, et les socialistes à la première, sauf quelques rares exceptions de part et d’autre.
Karl Marx, dans son écrit posthume Pour la critique de la démocratie socialiste, déclare ouvertement sa préférence pour la formule communiste « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » qui seule grâce à son application « peut complètement dépasser l’étroit horizon juridique bourgeois », mais il croit aussi qu’on ne peut arriver à cela que dans une seconde phase communiste « après que, par le développement général des individus, se seront aussi développées les forces productives et que toutes les sources de richesses sociales couleront pleinement[70] ».
Toutefois, cette divergence de vues sur la répartition des produits en régime socialiste n’était pas ce qui constituait le véritable point de rupture entre socialistes anarchistes et socialistes autoritaires. On pouvait rencontrer, et on rencontrerait encore, des collectivistes parmi les anarchistes ; de même, il y avait quelques communistes parmi les autoritaires. Ce qui séparait de fait les uns et les autres était la conception différente de la société socialiste en tant qu’organisation politique, et leurs positions différentes vis-à-vis du problème de l’État.
Nous avons déjà parlé de cela, il suffira de répéter que les autoritaires entendaient se servir de l’État, conquis légalement ou par une révolution, pour émanciper le prolétariat, exproprier la bourgeoisie et organiser le socialisme. Les anarchistes, eux, répliquaient que cette voie était erronée, l’émancipation du prolétariat, l’expropriation de la bourgeoisie et l’organisation du socialisme ne pouvant être obtenues que par le moyen de la révolution populaire et de la lutte contre l’État, avant comme après la révolution.
La division sur ce point est restée telle quelle depuis Marx. Que les socialistes s’appellent communistes, puis collectivistes, puis de nouveau communistes ; et que les anarchistes se disent d’abord collectivistes puis communistes : tout cela est secondaire. Ce qui importe pour les uns et pour les autres, et tout spécialement aujourd’hui, c’est la question de l’État dans la révolution, la révolution au moyen de l’État ou la révolution contre l’État.
En outre, en ce qui concerne le communisme, à nouveau accepté par les socialistes révolutionnaires maximalistes pour se distinguer de la social-démocratie qui restait légaliste et réformiste, rien pour 1 instant ne laisse supposer que par ce changement de nom il y ait eu un changement d’idées en ce qui concerne le programme économique de réorganisation sociale. Comme on l’a dit plus haut, les actuels socialistes n’entendent pas par « communisme » un système particulier de réorganisation sociale, en opposition avec les autres systèmes socialistes (ainsi que l’entendent les anarchistes), mais seulement un moyen de se différencier, qui se réfère plutôt à la méthode critique et marxiste d’évaluation des faits historiques. En effet, beaucoup l’appellent « communisme critique ».
A notre avis, cela est une erreur et n’a rien de proprement marxiste. Karl Marx a accepté le nom de communiste quand il est entré dans la « Ligue des communistes », un peu avant 1848, se chargeant d’écrire le manifeste-programme, devenu depuis célèbre. Mais bien qu’il n’ait pas donné beaucoup d’importance aux reconstructions du futur, par communisme il entendait, ainsi d’ailleurs que tous ses compagnons, rien de plus que l’idéal de la mise en commun de la propriété soustraite au monopole privé, et non sa manière particulière d’interpréter les faits historiques et sa méthode dialectique de critique et de polémique.
De 1848 à la fin de 1870 – c’est-à-dire jusqu’au moment où l’on commença à parler de collectivisme et à préciser ses différents systèmes –, on entendait par communisme l’idéal de la communauté des biens en général, sans toutes les distinctions qui vinrent ensuite. Cependant, il s’agissait là d’un idéal autoritaire, jacobin, centralisateur, tout le contraire, en somme, sur le terrain politique, du communisme anti-autoritaire et anarchiste d’après 1880. C’était justement le communisme autoritaire tant contrecarré et tant critiqué par Proudhon et Bakounine. Et ceci est le communisme des bolcheviks, des socialistes maximalistes, qui comme leurs camarades d’avant 1870 n’accordent à ce mot que la signification d’une socialisation globale de la future organisation de la propriété. On peut y englober aussi, à condition qu’ils soient d’accord sur le reste, tous ceux qui conçoivent une société socialiste selon le système collectiviste.
« Les marxistes – écrivait Bakounine en 1872 – sont les adorateurs du pouvoir de l’État et nécessairement les prophètes de la discipline politique et sociale, les champions de l’ordre établi de haut en bas, toujours au nom du suffrage universel et de la souveraineté des masses, auxquelles on réserve la félicité et l’honneur d’obéir à des chefs et à des maîtres élus. Les marxistes n’admettent aucune émancipation que celle qu’ils peuvent avoir par leur Volkstaat, l’État prétendu populaire[71]. »
Si l’on néglige quelques petites différences de langage et si l’on tient compte de la tendance polémique de ces mots de Bakounine, on peut dire des communistes d’aujourd’hui ce qu’il disait, lui, de ceux de son temps.
On peut trouver la confirmation de tout cela dans un petit livre très intéressant, Le Programme des communistes du socialiste russe Nicolas Boukharine, édité à un million d’exemplaires par les soins des bolcheviks en Russie et dans toutes les autres nations. Il est considéré comme un document qui, mieux que tout autre, reflète les idées des programmes du Parti communiste russe (bolchevique), et de tous les autres partis qui dans les différents pays suivent la même ligne de conduite.
Il n’y a, dans ce livre, rien de nouveau, rien qui n’ait déjà été dit par tant d’autres. Plus qu’autre chose, ce livre est un résumé clair et précis, ce qui fait sa valeur, des idées des bolcheviks. La critique de la société capitaliste, l’analyse des conditions des classes pauvres, la recherche des causes de la guerre, etc., sont les mêmes que celles des anciens socialistes, avec le même langage, propre à tous les partisans du marxisme : critiques, recherches et analyses avec lesquelles on peut tous être d’accord, si on fait abstraction du défaut déjà analysé par nous, l’importance exclusive donnée au facteur économique et la négligence absolue des facteurs politiques.
La réorganisation sociale y est considérée du point de vue de la production ; en revanche, comment et selon quel critère on doit assurer la consommation n’est pas dit de façon claire et exhaustive. Du reste, Boukharine examine cet aspect du problème seulement pour la période transitoire, révolutionnaire, pendant laquelle sont encore présents beaucoup de défauts d’organisation et beaucoup d’éléments et causes des maux de la vieille société, pas encore définitivement vaincue, autrement dit, pour une période pendant laquelle n’existe pas encore une véritable société socialiste.
Le lecteur peu attentif, ou habitué à accorder peu d’importance aux questions de liberté, en lisant le programme des communistes russes aura d’abord une impression favorable. Le système de production communiste de Boukharine comme indication de ce qu’on pourrait faire de mieux, compte tenu de certaines conditions ambiantes, peut être accepté par tous en règle générale. Cependant, par la suite, on s’aperçoit qu’il ne tient pas compte des conditions ambiantes et qu’il prétend que ce système peut être appliqué dans tous les milieux, pour toutes les conditions, à tout prix… ou par la force.
De temps en temps, on rencontre les expressions les plus exclusives et les plus coercitives. Boukharine parle d’un plan unique de travail, d’un bureau central qui dirige, d’un plan rigoureusement calculé et pondéré, d’une grande industrie centralisée, et peu à peu on s’aperçoit que son système manque de toute souplesse et qu’il conçoit la discipline du travail à peu près comme une discipline militaire. La tendance du communisme autoritaire, telle qu’elle résulte d’après la lecture du programme de Boukharine, est une tendance à une véritable militarisation du travail.
Etant donné cette tendance, on comprend l’hostilité de Boukharine envers les anarchistes et même son incompréhension absolue des doctrines anarchistes, auxquelles il dédie un ou deux chapitrés en faisant preuve de la plus plate superficialité et d’une totale ignorance en la matière. S’il est vrai, ainsi que l’affirment les éditeurs de la traduction italienne, que Boukharine est un excellent théoricien du marxisme, il faut en déduire que le marxisme est la science de parler et de critiquer les idées que l’on ne connaît pas.
Boukharine nie que la différence entre anarchistes et socialistes communistes consiste en la question de l’abolition de l’État car, dit-il, les communistes non plus ne veulent pas d’État, mais seulement une administration. Évidemment, selon Boukharine, pour abolir l’État, il suffit de l’appeler autrement. Qu’est-ce que la dictature, en effet, sinon un État despotique et centralisé en quelques mains ou en une seule ? Ainsi l’État est justement une forme d’administration qui impose à tous ses critères administratifs et se fait obéir, verbalement, par la force, la violence ou la menace de la violence, dans l’intérêt des administrateurs, dictateurs dans les faits.
Les anarchistes aussi admettent (comment d’ailleurs pourraient-ils ne pas le faire ?) la nécessité d’une administration des intérêts sociaux communs, mais ils ne lui accordent pas le caractère étatique, autrement dit, ils ne donnent pas aux administrateurs les moyens ni les possibilités d’imposer leur propre volonté, ils leurs attribuent seulement une fonction exécutive. Cette différence entre administration libre et administration autoritaire, ou mieux, entre l’administration des choses et le gouvernement des hommes, les mentalités dressées au culte de l’autorité (comme celle de Boukharine) ne la comprennent pas. Et même lorsqu’ils parlent d’administration des choses, ils ne séparent pas le concept d’administration de celui de possession. Ainsi, en attribuant à l’État la fonction d’administrer la richesse sociale, ils créent la propriété d’État, c’est-à-dire qu’ils substituent au capitalisme privé un gigantesque capitalisme d’État.
Pour donner un exemple de l’incompréhension marxiste de l’« excellent théoricien Boukharine », voilà de quelle façon il présente l’anarchisme à ses lecteurs : « Les anarchistes pensent que les hommes pourraient mieux vivre si toute la production était divisée en petites coopératives de production, en petites communes. On formerait une société par associations volontaires, une coopérative de dix personnes, et ces dix personnes commenceraient à travailler à leurs risques et périls. Dans un deuxième temps, se formera une société similaire, puis ensuite une troisième. Plus tard, ces coopératives commenceraient à avoir entre elles des rapports d’échange et de négoce. L’une d’entre elles manque d’une certaine chose, l’autre manque d’une autre chose encore, insensiblement, elles finissent par se trouver d’accord et concluent des « contrats libres ». Toute la production est fondée sur l’ensemble de ces petites communautés. Chaque individu reste libre de sortir quand cela lui plaît de la libre fédération de ces petites communautés (coopératives de production) [72]. »
Après ce bref exposé de « comment pensent les anarchistes » suit la critique, aisée certes, et d’une manière diffuse, il expose plus amplement la pensée des bolcheviks. Il est parfaitement inutile de réfuter cette critique, elle se fonde sur du vide, car les anarchistes ne pensent pas de la manière infantile qu’imagine Boukharine. Il se laisse plus entraîner par un esprit d’hostilité envers les anarchistes que par un esprit de sereine justice. Il dit, à preuve que les anarchistes sont partisans du fractionnement de l’organisation de la production jusqu’à l’absurde, qu’à Petrograd existe un groupe d’anarchistes qui s’appelle « Union des cinq opprimés ». Il en déduit que la future communauté anarchiste pourra être petite jusqu’au point de ne comporter que deux personnes.
Et il continue : « Selon la théorie anarchiste, il peut exister aussi une « confédération des deux exploités ». On peut imaginer ce qui pourrait advenir quand cinq ou six personnes, indépendamment du reste des hommes, commencent à réquisitionner et à confisquer, et se mettent ensuite à travailler à leurs risques et périls. En Russie, il existe environ un million de travailleurs. S’ils constituent des « cinq opprimés », la Russie serait le siège d’une Babel de vingt mil-lions de communautés… Que Dieu sauve la Russie d’un tel chaos et d’une telle… anarchie ! [73] »
Nous avons cité les paroles mêmes de Boukharine pour donner un exemple de sa réfutation. Si les anarchistes, en Russie, ne représentaient pas une grosse épine dans le pied des socialistes dictatoriaux, ces derniers n’auraient pas besoin pour les combattre d’armes telles que les stupidités ou même le ridicule, toujours faciles à employer surtout quand on a tort. Estropier les prémices d’une idée adverse jusqu’à l’absurde reste toujours le vieux système polémique dont Plekhanov fut le maître…
Malgré Boukharine et ses âneries, la véritable différence entre anarchistes et socialistes autoritaires (le bolchevisme n’étant que le nom exotique sous lequel se présente le vieux socialisme marxiste) consiste dans la différente solution du problème de l’État. Les uns et les autres veulent arriver à son abolition (Marx et Engels étaient aussi de cet avis et pour un instant acceptèrent le mot anarchie aussi) mais, tandis que les socialistes anarchistes pensent que l’on peut y arriver seulement par la lutte antiétatique menée du dehors et contre l’État, les socialistes autoritaires croient que l’État périra fatalement avec la cessation des divisions de classes. Ils pensent pouvoir atteindre ce but en conquérant l’État et, au moyen de sa force coercitive, instaurer le communisme. Les anarchistes sont pour la lutte contre l’État, jusqu’à ce que celui-ci soit détruit, les socialistes luttent pour conquérir l’État qui organisera le socialisme, abolira ensuite l’État… en l’an 3000 !
Résumer les divergences entre socialistes et anarchistes par la différence d’organisation de la production au lendemain de la révolution signifie renverser la question, c’est-à-dire donner une plus grande importance à ce qui en a le moins et élargir à l’avance une dissension qui est seulement tendancielle. Les socialistes ont des tendances centralisatrices et les anarchistes fédéralistes (comme on disait au temps de la première Internationale), mais s’il s’agissait seulement de cela, on trouverait certainement un moyen de réduire les dissensions, surtout si l’on pouvait convenir sur ce point capital pour les anarchistes, que la nouvelle organisation soit volontaire, par un consentement mutuel, par la reconnaissance de l’intérêt réciproque, et non imposée par des sanctions légales ou violentes. Alors, selon les circonstances, les fonctions à exercer, les besoins à satisfaire pour des objectifs et dans des branches déterminées de production, pourra-t-on aussi concevoir des plans uniques de travail, des bureaux centraux, etc., sans que cela ne devienne une menace pour la liberté des citoyens et un obstacle à la production, mais représente bien une aide.
Quand les anarchistes défendent l’idée de la décentralisation des fonctions, ils ne le font pas de façon abstraite comme si la centralisation était un mal en soi ; ils sont, dans les faits, opposés en règle générale à la centralisation et favorables à la décentralisation, justement parce qu’ils croient que celle-ci est plus adaptée à une organisation communiste de la production. Il est bien entendu que selon 1 idée anarchiste, la décentralisation subordonnée à l’abolition de 1 État doit être entendue de façon relative, car il peut y avoir des secteurs de production auxquels convient une certaine centralisation, mais cela n’est pas une règle abstraite à appliquer pour tous les cas.
En outre, il ne faut pas, ainsi que le fait Boukharine, confondre 1 état de lutte et d’oppression dans lequel on se trouve aujourd’hui avec l’état de liberté que pourrait nous assurer le triomphe d’une revolution. Boukharine affirme que si les parasites qui se sont enrichis pendant la guerre ne veulent pas se soumettre à la discipline générale, ils doivent y être contraints par les ouvriers et les paysans pauvres. Mais si de tels parasites n’ont pas été supprimés pendant la lutte, on leur aura du moins enlevé les moyens de profiter, c’est-à-dire qu’ils auront été expropriés et s’ils veulent manger, il faudra bien qu’ils travaillent, du moment que la révolution ne leur aura pas laissé autre chose que leurs bras pour vivre !
Boukharine reproche aux anarchistes d’être « ennemis de toute violence, et donc aussi de la violence des ouvriers et des paysans contre la bourgeoisie ». Allons ! que Boukharine aille raconter cela aux procureurs des rois et des républiques des différents gouvernements européens… s’il arrive à se faire croire ! Nous pensons, certes, qu’au sein de la société socialiste, la violence n’aura plus de raison d’être, mais avant et pendant la révolution, elle est inévitable, nécessaire, indispensable de la part des opprimés contre les oppresseurs, des exploités contre les exploiteurs, « des ouvriers et paysans pauvres contre la bourgeoisie ». En somme, nous pensons exactement le contraire de ce que croit ou feint de croire Boukharine. Et si nous sommes contre tout pouvoir gouvernemental, fût-il révolutionnaire, ce n’est pas par crainte de sa violence contre la bourgeoisie, que la révolution doit détruire en détruisant ses pouvoirs et ses privilèges, mais parce que nous sommes certains qu’il lésera surtout la liberté des ouvriers et minera, avec une violence réactionnaire, le succès même de la révolution.
Dans la propagande, pour nous faire comprendre, nous disons souvent que nous concevons la société anarchiste comme un vaste réseau de coopératives de production et de consommation, comme une organisation du simple au composé, de l’individu à la fédération. Il se peut aussi que parfois quelques propagandistes anarchistes, pour se faire entendre, parlent de « contrats libres mutuels » dans les petits groupes ; non pour soutenir que la production peut être développée seulement au moyen d’associations numériquement si restreintes, mais comme un exemple visible ‘et facilement contrôlable de la façon dont pourraient être constituées, par libre et mutuel appui, les vastes organisations de production de l’avenir et comment elles étendront leur dense réseau, selon un système de décentralisation, des communes à la province, aux régions, aux continents entiers, jusqu’à constituer un jour une famille humaine unique.
Le marxiste Boukharine prend, comme exemple type de la société souhaitée par les anarchistes, le « Groupe des cinq opprimés » de Petrograd. Il pourrait être complètement inventé et, même si c’était vrai, il ne prouverait rien car on peut très bien se réunir à cinq pour des buts très modestes sans croire pour cela qu’il suffit d’un aussi petit nombre de participants pour toutes les associations et tous les buts. Il aurait mieux fait de donner un exemple plus persuasif, par exemple quelques livres, opuscules ou journaux dans lesquels les anarchistes, un tant soit peu connus et reflétant l’opinion moyenne qui prévaut parmi leurs compagnons, aient soutenu des idées aussi saugrenues !
Nous renvoyons Boukharine à un livre un peu ancien : La Conquête du pain de Kropotkine dans lequel, contrairement à ce que croit le néomarxiste russe bolchevique, on prend justement comme point de départ l’état actuel des industries où tout s’interpénètre et se soutient réciproquement, où chaque branche de la production se sert de toutes les autres[74]. Loin de prendre comme type d’organisation le petit groupe limité, Kropotkine ne parle que de vastes associations, aujourd’hui capitalistes, mais qui demain pourront et devront devenir communistes, pour le bénéfice de tous : les grandes sociétés ferroviaires, les associations culturelles, l’Union postale internationale, l’Association anglaise de sauvetage, les sociétés de navigation, la Croix-Rouge, etc. Certains propos de Kropotkine sont aujourd’hui discutables mais cela importe peu. Nous l’avons mentionné seulement pour montrer jusqu’à quel point la ridicule tendance à la « confédération des deux exploités » attribuée aux anarchistes par Boukharine est complètement imaginaire et très peu intelligente.
Lorsqu’il s’est agi de discuter l’organisation communiste de la production et de la consommation de la richesse sociale, les anarchistes n’en ont jamais fait une question de nombre d’associés ; Boukharine ne fait que le supposer, car il croit que le consentement mutuel n’est seulement possible qu’entre un petit nombre de personnes. Nous pensons, au contraire, que le consentement mutuel et libre est possible pour toutes les formes associatives, aussi bien les grandes que les petites.
Mais pour qu’elles soient réalisables, pour qu’il n’y ait pas besoin pour les maintenir de la violence coercitive, il faut que chacune de ces associations de producteurs réponde à une nécessité véritable, soit organisée en harmonie avec les buts et l’environnement spécifiques, qu’elle réponde aux tendances et besoins généraux des masses qui doivent en bénéficier, qu’elle jouisse donc d’une relative liberté et autonomie qui lui rendent facile l’adaptation aux diverses circonstances environnantes. Donc, le nombre même des associés dépendra des besoins précis, propres soit à chaque localité, soit à la branche de production, selon que les produits sont de faible ou de grande consommation, à usage local ou à exporter, etc.
Il pourra et devra donc y avoir des associations très vastes de producteurs et d’autres plus restreintes. L’important est qu’elles répondent à deux nécessités principales : une certaine autonomie dans ses propres activités et une coordination avec les autres activités sociales, nécessités non inconciliables, au contraire, s’intégrant réciproquement si elles ne sont pas entravées et désorganisées par la pernicieuse intrusion d’un pouvoir d’État, qui ne veut qu’imposer, pour chaque cas, lieu et temps, bureaucratiquement et par la violence, un type unique de rapports, d’organisation, de discipline et de travail.
Le communisme dont Boukharine expose le programme nous semble pencher justement en ce sens. C’est cette violence-là qui nous fait peur et qui serait employée non contre les bourgeois, mais contre la classe ouvrière tout entière, contrainte de se plier à une discipline de caserne. Parce qu’en régime de caserne, on obligerait chaque usine ou établissement à organiser la production selon un modèle unique, un schéma fixe, a priori plutôt inspiré par la doctrine que par l’expérience vécue de la vie. Plus précisément par une doctrine : le marxisme, qui se fonde sur une seule manifestation de l’activité de production, l’industrie en régime capitaliste, et qui n’en déduit que des conclusions unilatérales, et donc défectueuses ou déficientes. Mais cet argument-là, nous en reparlerons plus tard.
Ce qui nous étonne, ce n’est pas que les socialistes maximalistes reviennent, même par le nom, au communisme autoritaire allemand de 1871, dont Bakounine avait analysé en ces années-là les sophismes avec beaucoup de verve. C’est que les socialistes opèrent leur retour non seulement comme si la longue parenthèse de 1880 à aujourd’hui n’existait pas ou qu’ils l’avaient oubliée, mais en revendiquant un droit de propriété particulier sur l’idée de « communisme », ils essayent ainsi de nier la qualité de communistes aux anarchistes. Et même, ainsi que le fait Boukharine, en parlant de communisme et d’anarchie comme de deux termes antinomiques, comme de deux idées contraires et adverses, ils créent entre les deux termes une incompatibilité inexistante, décidément opposée à la vérité, puisqu’ils se complètent mutuellement, au point d’être inséparables.
En effet, une société anarchiste ne sera possible que fondée sur une organisation communiste de la production et de la consommation, de même qu’une société vraiment communiste sera irréalisable si elle n’est pas fondée sur le consentement mutuel volontaire de ses composants, libres de toute forme de coercition étatique.
Nous ne nous libérerons pas de l’État sans détruire en même temps le privilège de la propriété et du capital. Nous ne nous libérerons pas du capitalisme sans détruire en même temps l’autorité gouvernementale et étatique. La tâche de la prochaine révolution sociale consistera à traduire dans les faits ces deux obligations.
Le marxisme et l’idée de la dictature
On attribue à Karl Marx l’idée de la dictature du prolétariat, c’est-à-dire l’attitude dictatoriale de la révolution.
Que le concept de dictature prolétarienne soit le plus adapté à la mentalité qui s’est formée avec le marxisme, cela peut être vrai. Mais que Marx ait conçu effectivement une révolution guidée et dominée par un pouvoir absolu dictatorial, cela nous paraît très douteux. Karl Marx était un socialiste autoritaire, non anarchiste. Donc il prévoyait un développement étatique de la révolution, grâce auquel le prolétariat deviendrait classe dominante, et dont il se servirait, pour exproprier la bourgeoisie, en intervenant despotiquement sur le droit de propriété et dans les rapports de la production bourgeoise.
Cependant, cela n’est pas encore la dictature ; ce mot ne semble pas avoir été employé trop souvent par Marx, et, de toute façon, sans qu’il y attache une importance spéciale ou bien qu’il développe une idée précise à ce propos. Il voyait dans la montée au pouvoir du prolétariat le « triomphe de la démocratie », c’est-à-dire un gouvernement prolétarien, représentatif et non dictatorial, violent seulement aux dépens de la bourgeoisie.
Enrico Leone, lui aussi, est de cet avis, dans un article auquel on a déjà fait allusion :
« Marx a très peu approfondi le sens du mot « dictature », il s’en est servi pour résumer la tactique du processus révolutionnaire que suivra le prolétariat, une fois qu’il se sera emparé du pouvoir politique. Marx amplifiait énormément le sens que ce mot a dans l’histoire et la science politique… Il a employé le mot « dictature » (et peut-être l’aurait-il éliminé sans l’insistance de Engels, qui était un admirateur de Robespierre), à cause de son caractère pédagogique salutaire. La conscience populaire moderne, plus éclairée, n’est pas disposée à sacrifier à cette espèce de fétichisme politique qui décrète la dictature « salutaire », car une dictature, même si elle est exercée au nom d’une classe, reste une suppression des garanties fondamentales de la personnalité humaine [75]. »
L’idée de la conquête du pouvoir politique afin de s’en servir pour exproprier par des lois ou par la force, entendue soit au sens démocratique, soit au sens dictatorial et absolu, n’appartient que très relativement à Marx. Elle appartient plutôt aux socialistes français, ses aînés ou contemporains, Louis Blanc ou Blanqui, et c’est une idée héritée des sociétés secrètes d’avant 1848, des traditions jacobines de la première révolution, de Gracchus Babœuf, Buonarroti, etc.
Marx a fait sienne la tactique de la conquête du pouvoir politique, dans un sens plus démocratique que dictatorial, relativement tard, et davantage comme un développement de son action sectaire au sein de l’Internationale et de ses dissensions avec les anarchistes que comme une application de ses théories. L’idée de la dictature peut être considérée davantage comme une dérivation (Kautsky dirait « déviation ») du marxisme que comme idée marxiste véritable. Du reste, si on étudiait les courants du socialisme, on s’apercevrait qu’une bonne partie de ce qui passe pour être marxiste ne l’est point. Il est beaucoup plus facile d’y trouver Malon, Lassale, Engels et peut-être même… von Shaeffle !
Quand Marx, plutôt que de formuler des théories, observait les faits de près, comme par exemple dans son étude sur la Commune de Paris, il arrivait à des conclusions non seulement différentes, mais aussi carrément opposées à la conception jacobine, autoritaire et centralisatrice de la dictature. A propos des tendances « communalistes » de la France de 1871, il écrivait :
« L’unité de la nation n’aurait jamais dû être rompue, au contraire, elle aurait dû être organisée par la constituante de la Commune : elle aurait dû se réaliser, cette unité, avec l’anéantissement de ce pouvoir d’État qui se faisait passer pour son représentant authentique, mais qui, en réalité, voulait rester indépendant et supérieur vis-à-vis de la nation, et qui n’en était qu’une excroissance parasitaire. Ayant réussi à décapiter les organismes oppresseurs de l’ancien gouvernement, ses légitimes fonctions auraient dû être soustraites à un pouvoir qui aspirait à dominer la société, et être rendues aux serviteurs responsables de cette société… La constitution de la Commune aurait restitué au corps social toutes les forces qui jusque-là avaient été consommées par l’État parasite, capable seulement de se nourrir de la société et de faire obstacle à son libre mouvement. Par ce seul fait, elle aurait mis la France sur la voie de la renaissance. La simple existence de la Commune portait avec elle, tout naturellement, l’autonomie locale et elle n’aurait même pas servi de contrepoids à l’État, devenu désormais superflu[76]. »
On comprend très bien que l’exaltation des autonomies locales et de la constitution « communaliste » contre le pouvoir de l’État réputé superflu est tout le contraire de l’apologie de la dictature.
Nous ne sommes pas marxistes. Mais ce serait une erreur de considérer le marxisme comme un terme qui différencierait l’anarchisme du socialisme. On pourrait, à la rigueur, être théoriquement anarchiste et marxiste, et vice versa, être socialiste anti-anarchiste et non marxiste. Par « marxisme », nous entendons bien sûr l’ensemble des théories développées par Marx dans son œuvre : matérialisme historique, lutte des classes, concentration capitaliste, plus-value, etc., et non pas les attitudes politiques qu’il a adoptées dans la seconde période de son activité, occupée en grande partie à combattre le courant anarchiste de l’Internationale. Théoriquement, en effet, il n’y a pas toujours eu incompatibilité absolue, dans l’idée des différents écrivains socialistes et anarchistes, entre anarchisme et marxisme.
Beaucoup ont reproduit ce passage où Marx acceptait, en 1872, une définition socialiste de l’anarchie[77]. D’ailleurs, Bakounine s’est souvent déclaré partisan de la doctrine marxiste du déterminisme économique[78]. Et c’est ainsi qu’en Italie, les premiers vulgarisateurs du marxisme ont été les anarchistes. Ce fut l’anarchiste Carlo Cafiero qui fit, pour les Italiens, le premier résumé du Capital, que Marx loua. Ce fut ensuite l’anarchiste Pietro Gori qui fit publier pour la première fois à Milan Le Manifeste Communiste de Marx et Engels, préfacé par lui. Ce fut Bakounine qui traduisit le premier, en russe, Le Manifeste, et il dut abandonner, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la traduction du Capital, qu’il avait commencée. Ainsi que le faisait remarquer Malatesta, au cours d’une polémique en 1879, presque toute la littérature anarchiste, jusqu’aux environs de 1894, était imprégnée du marxisme. Peu à peu, notre mouvement et notre propagande (sauf quelques tendances qui se manifestent encore ici et là) ont perdu ce caractère, et selon moi, ce fut un bien pour des raisons que j’expliquerai par la suite. Mais de tout ce qui a été dit, rien ne peut laisser croire qu’on puisse considérer le marxisme comme une antithèse de l’anarchisme.
D’ailleurs, les partis politiques et sociaux, en tant que partis d’action, sont divisés sur les buts précis qu’ils poursuivent et sur les méthodes qu’ils entendent employer. Il est difficile de les caractériser, de les baptiser par des noms et des références, des théories scientifiques et sociologiques à caractère général, dues au génie intuitif ou analytique de telle ou telle personnalité. Il y a, ou bien il y eut, des marxistes parmi les anarchistes et les républicains, parmi les syndicalistes et les réformistes, parmi les révolutionnaires et les légalistes. On pourrait être marxiste – c’est-à-dire juste retenir les théories de la lutte des classes, du matérialisme historique, etc. – et être en même temps conservateur et réactionnaire. Nous sommes même convaincus qu’il y en a. Il suffirait, pour cela, de se mettre pratiquement d’un côté de la barricade au lieu de l’autre, tout en convenant que la barricade existe, qu’il y a un conflit d’intérêts, et qu’il faudra fatalement, un jour ou l’autre, en venir aux mains.
L’explication scientifique ou sociologique d’un tel conflit peut aider à voir les choses dans leur réalité (quand l’explication est honnête et exacte, ce qui, selon nous, n’est jamais le cas, en ce qui concerne le marxisme) et peut être employée comme un argument de discussion, mais cela n’est pas la chose la plus importante et n’est pas indispensable. Et puis, voir toutes les choses par le biais d’une explication unilatérale, ainsi que le fait le marxisme, réduire au dénominateur minimal marxiste tout un courant d’idées et un mouvement complexe comme le socialisme, toute l’action d’un parti, du prolétariat tout entier, voire toute la révolution sociale elle-même (qui par sa nature ne pourra être que multiforme et éclectique, suivant les lieux et les circonstances), cela signifie rapetisser, regarder toute chose par le gros bout de la lorgnette : socialisme, mouvement prolétarien et révolution.
Je le répète, nous ne sommes pas marxistes, bien que, à ses débuts, l’anarchisme l’ait été presque entièrement, non pas par sa pratique, mais par ses motivations théoriques ; bien que nous reconnaissions, avec Bakounine, que Marx a puissamment aidé le socialisme à accomplir l’énorme progrès auquel nous assistons. Nous ne sommes pas marxistes, bien que plusieurs idées de Marx soient justes, soit parce que certaines de ses idées se sont révélées être, avec le temps, de simples hypothèses non confirmées par la réalité (concentration capitaliste et misère croissante) ; soit des explications insuffisantes des phénomènes économiques (plus-value) ; soit parce que même les idées justes, comme celles du matérialisme historique et de la lutte des classes, le sont dans un sens tout relatif et contingent, et non d’une manière absolue, en tout lieu et en tous temps.
Nous ne sommes pas marxistes et en pratique, en ce qui concerne la direction à donner au mouvement ouvrier, socialiste et révolutionnaire, dans la lutte contre les classes dominantes, nous ne l’avons jamais été, même quand toutes les autres théories, citées plus haut, étaient acceptées par beaucoup d’entre nous.
De ce côté, il est inutile que les néo-marxistes cherchent, dans le livre du maître, quelques phrases prouvant le contraire. C’est à Marx, à Engels, et aux autres marxistes de la première heure que revient la responsabilité de la direction erronée, par l’adoption de la conquête du pouvoir, d’où est issue, après 1880, la deuxième Internationale, si honteusement écroulée en 1914.
Il est inutile de refaire ici la critique du marxisme et de répéter ce qui a déjà été dit du côté anarchiste, par Tcherkessoff, Merlino, Malatesta, Cornelissen et Nieuwenhuis, et, du point de vue réformiste, par Graziadei, Croce, Sorel, Bernstein et David. Nous ne voulons pas faire de développements doctrinaires, mais seulement mettre en garde les socialistes et les révolutionnaires contre certaines attitudes pratiques qui ont leurs origines dans le marxisme, et qui pourraient être une source de terribles désastres et d’irréparables faillites pour la future révolution sociale.
S’il est vrai qu’il y a un doute pour attribuer à Marx la conception dictatoriale de la révolution (que nous croyons erronée et nuisible), comme s’il l’avait expressément formulée en tant que théorie, il n’en est pas moins vrai, comme nous l’avons déjà dit, que le marxisme crée la tournure d’esprit la plus adéquate pour accueillir un tel concept. En ce sens, les a priori marxistes peuvent réellement devenir un danger pour la révolution.
Le défaut principal du marxisme, même en ce qu’il a de bon et de vital, c’est d’être unilatéral, c’est-à-dire de voir seulement certains côtés de chaque problème, de considérer une seule catégorie de faits, et d’en tirer des conclusions qu’il applique par sa dialectique à n’importe quelle autre question et enfin à l’orientation pratique elle-même du mouvement socialiste.
Nous pensons que le principal mérite de Marx a été son intense travail de propagande et d’organisation socialiste au sein de la première Internationale, d’avoir fortement contribué à inspirer à la classe ouvrière la conscience et la dignité d’elle-même et d’avoir, parmi les premiers, et mieux que n’importe quel autre, compris et soutenu la nécessité de la solidarité internationale des travailleurs. Le cri « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » et l’affirmation que l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes valent, pour la cause socialiste, davantage que son livre Le Capital.
Je parle, bien sûr, des idées contenues dans ces deux expressions, et non seulement des simples mots. Il se peut que ces idées, sous une autre forme, aient été déjà exprimées avant Marx. Mais personne, de son temps et avant lui, n’y avait attaché autant d’importance, les avait étayées avec une argumentation aussi passionnée et une telle documentation historique ; personne ne les avait, par une propagande assidue, aussi efficacement martelées dans la tête des travailleurs et de tous ceux qui s’intéressaient au problème social dans l’intérêt de la classe ouvrière. On peut dire la même chose des deux concepts marxistes, qui se complètent mutuellement, de la lutte de classe et du matérialisme historique. Chez les écrivains socialistes (dits utopistes), avant Marx, et chez d’autres économistes, même non socialistes, on retrouve souvent de tels concepts. Mais Marx et Engels ont eu le mérite de les coordonner en un système, de les présenter sous une couverture scientifique, de leur trouver un lien logique, et, pour finir, d’en faire un argument de propagande, une arme de lutte pour la classe ouvrière.
Mais ce bien a été aussi source de mal, un peu à cause de Marx, spécialement d’Engels, et beaucoup plus à cause des marxistes qui ont suivi. Un mal au début inaperçu par tous, mais qui, petit à petit, a généré plusieurs erreurs au sein du mouvement socialiste. Ce mal a consisté dans le caractère unilatéral avec lequel ces deux concepts étaient soutenus : soit comme explication unique de toute l’histoire passée, soit (et ici l’erreur théorique devenait tactique) comme guide et motivation uniques du mouvement de propagande et d’action socialiste.
Nous constatons cela avec d’autant plus de sérénité que cette erreur, jusqu’à une vingtaine d’années en arrière, était commune aux socialistes et aux anarchistes et que pas mal d’anarchistes, d’ailleurs, ne l’ont pas complètement abandonnée ; en premier lieu, ceux qui se spécialisent dans le mouvement ouvrier ou suivent une direction d’esprit essentiellement syndicaliste.
Lorsque les anarchistes admettent qu’ils se placent, tout autant que les socialistes et les syndicalistes, sur le terrain de la lutte des classes, ils ne souscrivent pas pour cela inconditionnellement à la théorie marxiste connue sous cette expression, mais simplement adhèrent à un mouvement pratique qui répond à leurs intentions : la lutte des ouvriers contre les patrons pour s’émanciper de l’esclavage du salariat. Avant que le socialisme organise cette lutte des classes, en essayant de rendre solidaires les ouvriers, au-dessus de toute division de groupes, de métiers, de catégories, de nations et de races, il n’y avait pas de lutte des classes, mais seulement, ainsi que le rapporte Merlino [79] des luttes entre les différents groupes qui se confondaient dans la mêlée, qui se défaisaient et se recomposaient.
L’erreur du marxisme, c’est d’avoir considéré comme un fait préexistant, continu, et ayant un caractère de fatalité historique, ce qui n’était qu’un concours concomitant de multiples faits, parmi lesquels les marxistes prenaient en considération seulement ceux qui apportaient de l’eau à leur moulin. En cela, ils étaient peut-être mus, plus ou moins inconsciemment, par le noble désir révolutionnaire de rendre tout le prolétariat solidaire contre la bourgeoisie. En voulant donner un aspect et une base scientifiques à la lutte des classes, ils ont fini par y voir, sous des aspects différents, une espèce de loi historique dont, dans un certain sens, ils avaient été, avec tous les autres socialistes, les créateurs.
Ainsi que le fait observer Benedetto Croce [80], pour que l’histoire, selon les marxistes, soit une lutte des classes, encore faut-il que les classes existent, bien distinctes et antagonistes, et aient conscience d’un tel antagonisme. Deux classes, dans le sens le plus strict du mot, bien distinctes – capitaliste et prolétaire – existent seulement là où l’industrie s’est développée, autrement dit pas dans tous les pays, et même pas dans la majorité d’entre eux. En Italie par exemple, la grande industrie domine seulement dans quelques régions bien délimitées. En plus, ainsi que le font observer Groce et Merlino : « Parfois les classes n’ont pas des intérêts antagonistes et assez souvent, elles n’en ont pas conscience, les socialistes qui s’emploient à former cette conscience chez le prolétariat moderne le savent très bien. »
En effet, il incombe aux socialistes de susciter chez les prolétaires la conscience de leur antagonisme face à la bourgeoisie ; et, là où cet antagonisme, pour certaines catégories, n’existe pas, ou est peu ressenti, il faut le développer en suscitant chez les ouvriers le sentiment d’insatisfaction et le sentiment de solidarité avec les catégories les moins privilégiées, pour faire en sorte de briser certaines communautés d’intérêts qui empêchent le développement de la lutte des classes. Autrement dit, il faut aussi s’appuyer sur le facteur « idéal », et non pas se contenter des seules différences d’intérêts, afin de lever les classes exploitées et opprimées contre les classes dominantes et préparer la révolution sociale.
La conception trop étroite des marxistes, en ce qui concerne la lutte des classes entre ouvriers et industriels, peut représenter un danger dans un pays comme le nôtre, où la grande industrie est limitée. Cette conception laisserait à l’écart du mouvement révolutionnaire une énorme quantité de gens, opprimés et exploités d’une autre façon, c’est-à-dire, ces masses désorganisées et inorganisables, que les Allemands appellent « lumpenproletariat », tous les artisans, tous les paysans, qui sont classés comme journaliers, la cohorte des employés des catégories inférieures, etc.
Ces catégories, et spécialement celles des ouvriers des centres et des champs, seraient tout au plus employées comme un instrument aveugle et finiraient par être sacrifiées. Se formerait alors : « ni plus ni moins qu’une aristocratie nouvelle, celle des ouvriers des fabriques et des villes, à l’exclusion des millions qui constituent le prolétariat des campagnes et qui, dans les prévisions de messieurs les démocrates socialistes de l’Allemagne, deviendront proprement les sujets dans leur grand État soi-disant populaire » [81].
Bakounine lui-même fait remarquer que le « nouveau despotisme » serait illusoire pour les ouvriers de la ville ; en effet ceux-ci « devront nécessairement l’exercer par procuration, c’est-à-dire le confier à un groupe d’hommes élus par eux-mêmes pour les représenter et pour les gouverner, ce qui les fera retomber sans faute dans tous les mensonges et dans toutes les servitudes du régime représentatif ou bourgeois » [82].
Mais le prolétariat industriel est plus enclin à tomber dans cette illusion de la délégation du pouvoir, et à se réadapter à un régime autoritaire, de par sa composition même, par l’esprit d’obéissance acquis dans les grandes usines à la discipline coercitive et hiérarchique, où l’ouvrier est dressé presque comme dans une caserne, et où le travail lui-même, mécanique et automatique, dispense de penser soi-même et laisse entrevoir la commodité de se remettre aux bons soins des chefs et des représentants.
En outre, et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, peut-on vraiment soutenir que le prolétariat représente partout la majorité de la population ? Et même là où il est majoritaire, il a en face de lui Une minorité nombreuse et forte, dont il ne peut pas ne pas tenir compte, et dont au contraire il a tout intérêt à gagner la sympathie, l’adhésion et l’aide. En se basant sur le seul intérêt de classe, il est douteux que l’on puisse compter sur la majorité effective du peuple, en cas de révolution.
Si la révolution devait compter seulement sur le prolétariat industriel et sur les entreprises rurales, ou bien si ce prolétariat se servait de l’élan révolutionnaire de l’ensemble des masses, prétendant par la suite être l’unique collectivité maîtresse des richesses et devenir en quelque sorte la classe dominante de demain, la révolution serait alors exposée à un double danger : d’une part, elle construirait les bases d’une nouvelle domination de classe, et d’autre part, elle susciterait un tel nombre d’ennemis contre elle-même et parmi ceux qui avaient intérêt à la faire triompher qu’elle en serait étouffée et vaincue.
On peut observer la même uniformité dans la théorie du « matérialisme historique ».
La conception matérialiste de l’histoire serait, selon Karl Marx, celle-ci : le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle et aussi, ajoute Engels, celui des idées religieuses, philosophiques, morales, etc., de toutes les périodes historiques. Dans tout cela, il y a une vérité indéniable que d’autres avaient affirmé avant Marx, mais Marx a eu le mérite de donner à cette vérité un grand relief en soulignant l’importance des facteurs économiques et leur énorme influence sur les événements historiques.
Cette vérité sert, dans l’intérêt de la classe ouvrière, à démontrer que pour éliminer la plus grande part des maux causés par la misère sociale, il est indispensable de transformer le système de production et de distribution de la richesse, autrement dit toute l’organisation économique de la société. Sans quoi, tous les efforts sur le terrain politique, religieux, moral, etc., tous les sermons évangéliques, les expérimentations utopistes, les appels à l’intervention de l’État, les différentes formes de législation ouvrière, et ainsi de suite, sont condamnées à se tarir inutilement ou bien à obtenir des résultats dérisoires.
Ces idées de Marx sont mises en exergue dans les célèbres Considérant, constituant la première Internationale de 1864. Elles furent développées ensuite dans son Adresse Inaugurale, telles qu’elles avaient été exposées, sous une autre forme, seize ans auparavant, dans le Manifeste communiste.
Bakounine partageait en cela la pensée de son adversaire en notant fréquemment que : « La découverte et la démonstration d’une telle vérité est un des grands mérites de K. Marx[83]. » Mais il ne cachait pas, tout en donnant raison au matérialisme historique, que : « Ce principe est profondément vrai lorsqu’on le considère dans une juste lumière, c’est-à-dire d’un point de vue relatif ; mais vu et considéré d’une manière absolue comme étant l’unique fondement et source première de tous les autres principes, il devient complètement faux[84]. » En effet, la vérité contenue dans la conception matérialiste de l’histoire est « une vérité », mais non pas « toute la vérité ». Les marxistes, en revanche, tombent dans l’erreur de subordonner au facteur économique tous les autres. Non seulement ils lui accordent une importance primordiale à certaines périodes historiques (par exemple pendant la période de la civilisation industrielle), mais ils en font carrément le moteur unique et voient, dans tous les autres facteurs sociaux, des dérivés, des conséquences, des faits, déterminés à leur tour par le facteur économique. C’est une erreur historique, car, si le facteur économique a son importance, tous les événements historiques ne sont cependant pas déterminés par le facteur économique ou par lui seulement, au contraire quelques-uns sont subordonnés à des facteurs autres.
Mis à part les événements sur lesquels il serait trop long de discuter maintenant, l’erreur marxiste consiste à ne pas considérer à leur juste valeur les autres facteurs du mouvement social, eux aussi très importants, même si souvent ils le sont en moindre mesure. En les laissant de côté, il devient impossible de voir les faits sous leur vrai jour, mais sous un éclairage unique et donc faux, qui peut dans la pratique conduire à des pas tout aussi faux. Ce sont ces faux pas, auxquels peut conduire le dogmatisme marxiste, qui constituent, selon nous, un danger pour la révolution.
Il convient de rappeler comment, une fois passée de la théorie à la pratique, cette excessive subordination de toutes les questions à la question économique est devenue le guide de la conduite de la deuxième Internationale et a été une des raisons de sa fin désastreuse au même titre que sa politique parlementariste.
Si l’économisme excessif a été la cause principale de la faillite des partis socialistes, le fait de s’inspirer des seules raisons d’utilité économique immédiate, pour les classes travailleuses organisées, a été une des causes majeures de la soumission de toutes les organisations syndicales d’Europe et des États-Unis à la collaboration avec les différents gouvernements, pour perpétuer le crime de guerre [85]. Mais laissons de côté le passé récent et considérons l’avenir. A quelles erreurs peut conduire une conception du mouvement basée exclusivement sur la théorie du déterminisme économique ?
Avant tout, et c’est naturel, à répéter les erreurs du passé. En outre, en habituant les masses socialistes et les révolutionnaires à l’idée que, une fois le salariat aboli et la propriété socialisée, toute lutte serait terminée et que donc seraient éliminées aussi l’injustice et l’oppression, qui dérivent de causes autres qu’économiques, il arrivera que ces autres causes resteront toujours opérantes. La révolution inachevée est inapte à résoudre tous les autres problèmes de la complexe question sociale. Quoi qu’en dise Engels, il n’est pas vrai que la religion, la famille et l’État, par exemple, disparaîtront d’eux-mêmes en conséquence des mutations économiques. Il faut que la révolution, avec ses moyens différents et en fonction de la nature de ces institutions, s’en charge afin qu’elles ne deviennent pas un obstacle, ou des foyers de réaction, voire même un point de départ pour la reconstitution de privilèges économiques démolis par l’action de la révolution, et cela, surtout en ce qui concerne l’institution étatique. En effet, l’État constitue de par lui-même, indépendamment du capitalisme proprement dit, une caste privilégiée et une cause permanente de réaction, d’injustice, de monopole et d’asservissement politique et économique. Mais nous en avons déjà débattu, et il serait superflu de nous répéter.
On sait que le marxisme est une théorie qui base son argumentation sur une documentation scientifique, statistique, etc., qui reflète presque exclusivement la naissance et le développement de la grande industrie. Marx et Engels, qui ont presque constamment vécu en Angleterre, avaient sous les yeux un matériau d’étude quasi inépuisable, très riche et très important. L’Angleterre était, à ce moment-là, le centre du commerce mondial, et l’industrie y était à son apogée. De plus, Engels était lui-même un industriel. Et, quand ils ont vécu ailleurs qu’en Angleterre, les pays qu’ils ont connus étaient ceux, après l’Empire britannique, qui suivaient l’Angleterre le plus près dans son développement industriel : la Rhénanie, la Belgique et la France.
Il ne faut donc pas s’étonner s’ils étaient portés à voir, de par leur situation, leur milieu, les études qu’ils avaient la possibilité de mener, dans la civilisation industrielle le sommet de la puissance bourgeoise.
Après quoi, aurait dû se produire l’effondrement de cette bourgeoisie et le passage, d’une certaine manière, à la société des travailleurs. En étudiant le processus de la production capitaliste, là où elle était le plus solidement implanté, il apparaissait, en un moment de croissance, que l’accumulation des capitaux en quelques mains n’avait plus d’obstacle devant elle. On comprend alors qu’ils aient pu arriver à la conclusion erronée qu’un tel mouvement devait atteindre un point tel d’exagération qu’il provoquerait la révolution prolétarienne et l’effondrement de la domination capitaliste. La Révolution russe nous a démontré que l’on peut espérer l’écroulement du capitalisme, même si le processus d’accumulation des richesses n’a pas eu lieu, s’il s’arrête, ou même s’il n’est pas entièrement réalisé. Or, malgré cela, bien que les faits ultérieurs aient prouvé que la propriété ne suit pas des lois constantes et que si elle s’accumule d’un côté, elle se fractionne de l’autre, les études de Marx et Engels ont apporté tout de même sur bien d’autres problèmes une précieuse contribution à l’élaboration des idées socialistes. Mais, pour s’en servir, le révolutionnaire qui veut passer de l’abstraction de la théorie au terrain pratique de l’action doit tenir compte du fait que Marx et Engels ont basé leurs études sur une période historique déterminée, donc assez limitée dans le temps et l’espace. Cela devait forcément les amener, sur bien des points, à des conclusions uniformes, et donc peu viables en d’autres temps et dans des contextes différents. D’ailleurs, ils ont eux-mêmes reconnu ces faits plusieurs fois par la suite, quand ils ont eu l’occasion de confronter les idées exprimées dans le passé avec des faits récents.
Mais il est également vrai que, plus qu’à Marx lui-même, beaucoup d’erreurs sont dues aux marxistes. Pendant des années et des années, ils nous ont bourré le crâne, au nom de leur maître, en nous expliquant l’impossibilité de la révolution et de la réalisation du socialisme, parce que, dans tel ou tel autre pays, le capitalisme ne s’était pas encore développé, parce qu’il n’existait pas un prolétariat dans le sens strict du mot, parce que la production était trop rudimentaire, l’industrie non développée, le cycle capitaliste non achevé, etc. Cela est répété aujourd’hui même par les marxistes de droite, les mencheviks russes, lesquels auraient voulu arrêter la révolution, justement parce que la Russie n’était pas encore devenue un pays capitaliste. C’est ce que disent aussi les réformistes italiens, tout en ne rejetant pas le marxisme dont ils furent les serviteurs, qui voient un danger dans la révolution à cause du manque de fer et de charbon nécessaires à l’industrie italienne.
En réalité, l’industrie et le capitalisme typique (contre lequel est tournée toute la critique marxiste) se sont formés et développés seulement dans un nombre limité de pays privilégiés, riches de gisements de charbon et de fer, avec une population importante et concentrée. L’industrie est née et s’affirme aussi dans d’autre pays mais avec des conditions moins avantageuses, subordonnées, et pas suffisamment puissante pour absorber toutes les autres forces et étouffer la vie d’autres processus de production hérités du passé. Il ne faut pas croire non plus que, du point de vue de l’économie internationale, cela soit un mal. De toute façon, si l’on devait attendre l’industrialisation de chaque pays pour y faire la révolution, elle aurait dû avoir lieu depuis belle lurette en Angleterre, Belgique, Allemagne, France, où il semble plutôt qu’on en soit encore bien loin. En revanche, la révolution n’aurait dû pouvoir être réalisée en Russie où elle a triomphé ; tandis qu’en Italie et en Espagne, on ne devrait même pas en parler alors qu’au contraire on en voit de plus en plus les signes avant-coureurs.
Mais les marxistes révolutionnaires, que l’on appellera de gauche, les maximalistes italiens et les bolcheviks russes, ne désarment pas pour autant, pas plus qu’ils n’atténuent leur fanatisme doctrinaire selon lequel la grande industrie devrait être le type de civilisation le plus avancé et le plus en harmonie avec la civilisation socialiste. Ils n’affirment pas, bien sûr, ainsi que le font leurs compagnons de droite, que la révolution doit attendre le développement complet du capitalisme, mais ils veulent plutôt se servir de la révolution pour le développer intensivement et le transformer en capitalisme d’État. Autrement dit, confier à l’État la gestion de la richesse et de tous les pouvoirs gouvernementaux, afin qu’il puisse faire, de gré ou de force, d’un pays en révolution un pays industriel. Voilà l’une des raisons pour lesquelles les bolcheviks de chez nous comme d’ailleurs font appel à la « dictature du prolétariat » afin qu’elle puisse, avec une poigne de fer, plier toute la population à une discipline stricte, nécessaire pour implanter artificiellement la grande industrie, non plus capitaliste mais pas davantage prolétaire : étatique, simplement.
Ce but est clairement défini dans le Programme des Communistes de Boukarine, que les maximalistes de toutes nuances à Milan, Turin et Naples traduisent et commentent comme si ce programme leur était propre. D’après Boukarine, « la meilleure manière et la plus parfaite pour organiser la production » nous est enseignée par la « grande industrie capitaliste ». Donc, « il faut accoler l’égalité économique à la grande industrie. Il ne suffit pas que les capitalistes disparaissent, il faut aussi que la production soit montée sur un pied très large. Toutes les petites industries non compétitives doivent disparaître. Tout le travail doit être concentré dans les grandes fabriques, dans de grandes usines, de grandes exploitations agricoles. L’un ne doit pas ignorer ce que fait l’autre, et vice versa. Il devient nécessaire d’établir un plan unique de travail, qui sera encore meilleur s’il peut être étendu dans le plus grand nombre de lieux possible. Le monde entier doit, finalement, devenir une grande entreprise de travail, dans laquelle toute l’humanité travaillera pour elle-même, avec les meilleures machines dans les plus grands établissements, sans patrons ni capitalistes comme il y en a aujourd’hui, mais selon un plan rigoureusement préparé, calculé et mesuré[86] ».
Quelle monstrueuse aberration !
Contrairement à ce que croit Boukharine, les anarchistes ne sont pas du tout opposés, en principe, aux grandes associations de production et de distribution. Sa boutade sur nos préférences pour la « confédération des deux exploités » (dont nous avons déjà parlé) n’est pas justifiée du tout. Si le type de travail, ou le travail, ou le service à fournir l’exige, quand la chose est possible sans inconvénient suivant les lieux et les circonstances, nous admettons nous aussi les grands établissements, les grandes usines, les grandes exploitations agricoles. Nous aussi, nous pensons que la production doit bénéficier du support le plus large possible. Nous n’avons pas la phobie de la grande industrie en elle-même, et si ses expériences et ses méthodes de production pouvaient être utilisées pour le bien de tous, ce serait une sottise de ne pas s’en servir.
L’aberration consiste à croire que seules les méthodes de la grande industrie sont efficaces et qu’il faut condamner les petites industries à périr, sous le prétexte d’une hypothétique incapacité à produire. Certes, il y a des types de travail et de production qui sont mieux réalisés dans les grandes usines, il y en a aussi qui s’accommodent mieux d’une économie à petite échelle, et d’autres encore qui s’accommodent fort bien de l’une ou de l’autre façon. « Même pour le progrès technique », dit Kropotkine, « la concentration des industries en grandes usines n’est pas toujours utile, et elle peut même représenter parfois un obstacle. Si les grandes usines ont aujourd’hui l’avantage sur les petites, il arrive aussi que, souvent, cela ne soit pas à cause d’une économie d’énergie motrice ou à cause des progrès techniques plus facilement réalisables, mais seulement à cause de la plus grande facilité offerte pour la commercialisation[87] » Mais cet avantage, dans une société socialiste, serait facilement obtenu par la simple centralisation des produits dans les magasins socialisés, sans besoin de centraliser d’abord travail et travailleurs dans une usine-caserne.
On peut dire la même chose pour les exploitations agricoles. Certaines petites propriétés des Marches, de l’Ombrie ou des Abruzes n’ont rien à envier, question intensité de cultures et de richesse des produits, aux grandes exploitations agricoles de nos amis coopérateurs de Romagne ou du Latium. Ceci n’est qu’un exemple, et non pas une plaidoirie en faveur de la culture à petite échelle de préférence à la grande, afin de montrer comme sont hasardeux certains apriorismes qui ne tiennent pas compte des circonstances et se basent seulement sur une seule série de faits, ainsi qu’il en est pour les marxistes.
Selon nous, ce seront les producteurs associés qui devront, librement, établir leur propre type et mode de production, selon leurs capacités et les nécessités, et non pas suivant un gouvernement qui l’imposerait à tous d’en haut.
L’aberration dépasse les limites lorsque, dès aujourd’hui, on établit le type de la grande industrie obligatoire pour tous – y compris, donc, tous les pays qui sont le moins adaptés à la grande industrie –, sans juger de l’opportunité ni de la nécessité de le faire, sans pouvoir distinguer jusqu’à quel point et où cela est possible. Et l’on parle sans crainte d’un projet de travail unique pour tous, « selon un plan rigoureusement préparé, calculé et mesuré ». Le milieu, les tendances, l’esprit des populations ne comptent en rien ! Et, sous prétexte que l’un ne doit pas ignorer ce que l’autre fait et vice versa (comme si pour se renseigner, s’aider, échanger mutuellement des idées, des matières premières et des produits, il n’existait pas d’autres moyens que celui de nous obliger tous à faire la même chose de la même manière), Boukharine rêve de soumettre pas moins que l’humanité entière à ce « plan unique, rigoureusement préparé, calculé et mesuré ».
Nous pourrions nous réjouir, car, après quarante ans, les socialistes sont retournés au communisme, après avoir laissé si longtemps aux anarchistes seuls le soin de le propager.
Cependant, si les socialistes suivent Boukharine, ils ne feront que changer d’étiquette. Derrière il y aura toujours la vieille utopie collectiviste de caserne allemande, le socialisme autoritaire d’avant 1870, critiqué par Proudhon et Bakounine, impossible à réaliser. Lorsque Boukharine nous parle d’un « pouvoir d’État », d’un « pouvoir de fer », d’un « gouvernement énergique », il nous vient à l’esprit non seulement Lénine, mais aussi Noske, voire même le tsar ! Cela signifie que nous avons toutes les raisons de craindre que la violence gouvernementale du nouvel État ne sera pas seulement dirigée contre les forces réactionnaires et bourgeoises rescapées – ce que nous ne regretterons certes pas –, mais aussi contre les ouvriers récalcitrants au « plan unique de travail », contre les tendances libertaires qui se sont développées dans le prolétariat, contre l’esprit d’autonomie, d’indépendance et de révolte des opprimés d’aujourd’hui, qui ne voudront pas, ne toléreront pas, fût-ce pour leur bien, être les opprimés de demain.
Les écrivains marxistes se plaisent de temps à autre à présenter l’anarchie comme une exagération de l’individualisme bourgeois, ils feignent d’ignorer le fondement socialiste – autant théorique qu’historique – des idées anarchistes. En revanche, nous pouvons dire, à bien plus juste titre, que leur conception monstrueuse du capitalisme d’État (appelé à tort socialisme) est la plus exaspérante exagération de l’étatisme bourgeois. L’individualisme bourgeois, sans le socialisme, a fini par étouffer l’esprit égalitaire qui a donné son souffle à la révolution de 1789. De même, le socialisme d’État, sans la liberté, rendra stériles les fruits de la révolution commencée en Russie en 1917.
De plus, il y a dans tout cela un danger grave : celui que la révolution se termine dans de terribles luttes intestines, à cause d’un vain effort du gouvernement révolutionnaire pour soumettre tous et tout à ses décrets. Effort contré par le mécontentement et la rébellion croissante des sujets, surtout ceux qui avaient déjà contribué à renverser la bourgeoisie. Cela n’est pas du tout impossible, et pourrait même être inévitable dans des pays comme les nôtres, car un régime avec un gouvernement industriel se heurterait à l’intolérance envers toute discipline forcée qui est propre au caractère des populations. Il se heurterait aussi à l’attitude contractée sous le régime actuel de voir dans le gouvernement un ennemi, et à l’inadaptation au régime industriel, pour lequel manquent, chez nous, les principales conditions naturelles indispensables. Cette dernière difficulté pourrait être contournée, petit à petit avec le temps, mais vouloir la heurter par la violence, d’un seul coup, cela signifierait, dès les premiers moments, susciter inutilement de nouveaux ennemis à la révolution, même parmi ceux qui auraient intérêt à la défendre. Tout cela empêcherait inévitablement d’obtenir l’ordre nécessaire au développement de la production et favoriserait le jeu de la contre-révolution, en empêchant le nouveau régime de construire en temps opportun des bases définitives et stables. La réaction, en prenant position pour l’une ou l’autre des parties en conflit, finirait un jour par avoir le dessus, et elle se montrerait au grand jour lorsque toutes les forces révolutionnaires se seraient fatiguées et annihilées mutuellement en des luttes stériles et sûrement sanglantes entre la liberté et l’autorité. La révolution, autrement dit, finirait, comme déjà celle de 1789–1793, par se dévorer elle-même.
Les socialistes ont encore le temps d’éviter à la révolution un pareil sort. On ne prétend pas, malgré tout notre désir, qu’ils se convertissent à l’anarchisme et acceptent la conception anarchiste du socialisme et de la révolution. Cependant, il serait bon qu’ils s’inspirent pour leurs tactiques et leurs méthodes révolutionnaires d’un sentiment plus grand de liberté, et surtout qu’ils renoncent à cette prétention de réduire par la force la révolution à un schéma dogmatique et aprioriste, qui n’a de scientifique que le nom donné arbitrairement. Cette conception peut certes être définie comme marxiste, mais Karl Marx lui-même la répudierait s’il était encore en vie.
Qu’ils écoutent plutôt la parole vivante de leurs maîtres, et non les paroles mortes. Ils devraient se rappeler que Karl Marx – lequel a tenu à déclarer qu’il n’était pas du tout « marxiste » –, seize ans après avoir écrit le Manifeste Communiste, sentait déjà le besoin de conseiller aux socialistes de ne pas le prendre trop à la lettre et de l’appliquer « en tout lieu et en tous temps selon les conditions historiques du moment ». Nous ne sommes pas utopistes au point d’oublier que de 1848 à aujourd’hui, plus de soixante-dix ans ont passé !
Ce qu’est la dictature
Rien n’est plus ambigu que le langage politique. Il peut en effet, par un seul et même mot, exprimer des idées à la signification la plus contradictoire. Mais pour certains mots, qui ont une signification précise depuis des siècles et qui sont encore d’un usage courant, aucune équivoque ou dissension ne devrait être possible.
Tel est le cas du mot « dictature ». En langue italienne, comme dans toutes les langues modernes ou anciennes, il a toujours indiqué une forme de gouvernement absolu, qui centralise dans les mains d’une ou plusieurs personnes tous les pouvoirs de l’État : militaire, politique et social. Le dictionnaire de Fanfani définit la dictature comme « l’autorité suprême et absolue, mais temporaire, du gouvernement d’un État, d’une province, etc., conférée pour une cause extraordinaire ».
Le « dictateur », dans l’antiquité, ainsi que Fanfani le rappelle, était le magistrat suprême dans la république romaine. Il était désigné exceptionnellement, pour six mois seulement, dans le cas de périls extrêmes, et avait pouvoir de vie et de mort sans appel. Aujourd’hui le dictateur est celui auquel, dans des contingences très graves et extraordinaires, est conféré temporairement le gouvernement de la chose publique avec autorité absolue, tant civile que militaire.
La dictature, en somme, est établie par l’État, à titre exceptionnel et provisoire, lorsqu’il se sent en danger, soit en temps de guerre, soit à la suite de désordres intérieurs. Elle a une durée préétablie de six mois, d’un an, de deux ans et même plus. Ou alors on établit la dictature pour toute la durée de la guerre ou tout autre événement exceptionnel qui « justifie » le recours à cette méthode.
L’idée de la dictature est née dans l’esprit des hommes d’État, persuadés que la division du pouvoir et la liberté sont dangereuses, et qu’un commandement unique, avec pleins pouvoirs, qui puisse agir sans égards envers quiconque, résolument, sans limitations légales et avec tous les moyens disponibles, même les plus violents, peut contribuer avec une plus grande efficacité à faire front à la situation.
Ceux qui se rappellent le peu d’histoire qu’on étudie dans les écoles se rappelleront aussi les circonstances dans lesquelles les anciens Romains avaient recours à cette forme exceptionnelle de gouvernement, tout spécialement en temps de guerre ou de discordes internes. La tradition raconte que le pouvoir dictatorial y fut aussi établi avec des attributions qualifiables aujourd’hui de constitutionnelles, c’est-à-dire jetant les bases de la constitution de la république avec des lois fixes. Les premiers à être investis des dictatures furent les décemvirs, qui constituèrent la dictature non pas d’un seul homme mais de plusieurs personnes, bien qu’en nombre assez limité. Toujours selon la tradition, c’est aux décemvirs que l’on doit les lois des douze tables ainsi que le premier souvenir des inconvénients et crimes conséquents à la dictature. L’épisode de Virginie, tuée par son propre père afin de la soustraire à la prépotence d’un décemvir qui, profitant de son pouvoir, essayait de réduire à l’esclavage la fille dont il était tombé amoureux, en est un exemple.
Vers la fin de la république romaine, on eut même recours à la dictature pour tenir tête à la rébellion interne, pour les guerres civiles, etc. Résultat : un beau jour, un de ces dictateurs de provisoire devint stable. Ainsi mourut la république et naquit l’Empire romain.
Mais il n’est pas nécessaire de remonter aussi loin dans le temps pour trouver des exemples de régimes dictatoriaux. Pour nous en tenir aux temps modernes, c’est-à-dire à ceux de la domination de la classe bourgeoise, il suffit de se rappeler la dictature de Robespierre, à laquelle succéda celle de Bonaparte. D’aucuns, en Sicile, se rappellent encore la brève dictature de Garibaldi en 1860. Certains avaient espéré qu’elle déboucherait sur une république, mais elle se termina par le « don » du royaume napolitain à Victor Emmanuel. Des dictatures plus ou moins provisoires, mais toutes aussi brèves et éphémères, se sont succédées en Italie et ailleurs pendant les révolutions de 1848. Et on pourrait en citer beaucoup d’autres.
Moins loin dans le temps et dans l’espace, nous pouvons aussi trouver des exemples historiques de dictature. Sans s’arrêter aux sièges de 1894 et 1898 (qui ne furent autre chose que des dictatures locales confiées à des militaires), nous avons vécu en plein régime dictatorial, exercé par les quelques hommes qui étaient à la tête du gouvernement et des armées, au cours des cinq dernières années de guerre. A tel point qu’à un moment donné, l’Europe paraissait se trouver sous la domination de deux dictatures, celle dont les chefs étaient à Berlin et celle dont les chefs étaient à Londres. Cela se serait produit d’une manière plus manifeste si une grande partie de ce front unique qu’on voulait établir n’avait pas été empêchée par la rivalité des différents États entre eux. Mais dans chaque État il y avait, à n’en pas douter, une dictature dont une forme larvée et intermittente de parlementarisme verbeux, non seulement ne diminuait pas le pouvoir, mais lui en confiait chaque jour davantage.
Une dictature collective, de toute une classe, populaire, des majorités plus ou moins électives, etc., de même qu’une dictature prolétaire, serait une contradiction dans les termes. En effet, la caractéristique principale d’une dictature est le pouvoir accumulé par une ou plusieurs personnes, et non pas fragmenté en une collectivité[88]. La supériorité économique et politique d’une classe sur l’autre peut générer la dictature, la faciliter, la durcir, etc., mais ce n’est pas la même chose, elle n’a pas le pouvoir suprême de la véritable dictature. La dictature est la domination absolue par les dictateurs, non seulement sur les classes économiquement et politiquement assujetties, mais aussi sur tous les composants de la même classe dominante qui ne font pas personnellement partie du gouvernement.
Pendant la guerre nous avons eu des exemples de pouvoir dictatorial, spécialement dans les zones dites « de guerre ». Le pouvoir militaire suprême y imposait son autorité à tous les citoyens, civils ou militaires, fussent-ils bourgeois ou prolétaires et même aux hommes du gouvernement. Si un jour il y a une dictature de prolétaires ou de représentants des prolétaires, qu’ils se nomment socialistes ou révolutionnaires, l’autorité des dictateurs s’exercera alors aussi sur tous, c’est-à-dire non seulement sur les bourgeois et les membres de l’ancien régime en général, mais sur tout le prolétariat restant, sur tous les autres socialistes et révolutionnaires restés à l’écart du pouvoir. Les raisons et les prétextes sous lesquels l’autorité dictatoriale sera imposée aux uns et aux autres seront différents, mais les effets resteront les mêmes.
En d’autres mots, la dictature consiste à accroître et à centraliser au maximum les pouvoirs de l’État, lequel exige de tels pouvoirs exceptionnels à cause de sa méfiance envers ses sujets. La peur d’être frappé par-derrière pendant qu’il lutte contre un ennemi extérieur le pousse à enlever toute liberté au peuple qu’il opprime. Ainsi par sa nature même, la dictature, comme développement de l’oppression, est toujours dirigée contre le peuple. C’est l’arme d’un gouvernement qui n’a pas confiance dans le peuple.
On nous objectera : mais ne pourrait-elle pas être ou bien devenir une arme brandie par le peuple contre le gouvernement et contre la bourgeoisie ? C’est ce que pensent certains, et nous allons examiner la question. Mais avant de continuer, il est nécessaire de ne pas oublier que la caractéristique de la dictature est « le pouvoir en peu de mains ». Or, le gouvernement qui est toujours exercé par une minorité sur une majorité, peut réduire le nombre de ses composantes, et même rassembler tous les pouvoirs en une seule personne. Tandis qu’un gouvernement de la majorité sur la minorité, ou gouvernement de tous, est une expression sans aucun sens puisqu’elle indique un état de fait où le gouvernement tel qu’on l’entend aujourd’hui, soit n’existe plus soit devient absolument inutile. Il est donc évident qu’une dictature sans dictateurs n’est plus une dictature.
Les démocrates, et avec eux les socialistes, pensent que le pouvoir pourrait être confié à un petit nombre de représentants de la nation, du peuple, du prolétariat, etc., à travers les organismes électoraux et parlementaires. Le pouvoir effectif, particulièrement le pouvoir exécutif qui est le réel puisqu’il dispose de la force armée, resterait même en ce cas (comme dans les régimes représentatifs actuels) aux mains d’une minorité plus ou moins importante, soit d’une classe, soit d’une caste, soit d’un parti. C’est déjà une forme de gouvernement différente de celle de la dictature, moins autoritaire, moins centralisée, davantage sous contrôle, mais toujours gouvernement. Autrement dit, l’opposé de l’anarchie.
Mais si nous concevons l’anarchie comme une antithèse de l’État constitutionnel et parlementaire d’aujourd’hui, pour les mêmes raisons et de la manière la plus radicale, l’anarchie sera contre un État régi même exceptionnellement et provisoirement sur des bases encore plus autoritaires et despotiques, c’est-à-dire contre la dictature.
Ceux qui sont aujourd’hui pour la nécessité d’une dictature prolétarienne et révolutionnaire ne lui donnent pas tous, nous dira-t-on, cette signification absolue et rigide qu’elle assume si l’on regarde la signification historique et littérale.
Peut-être ont-ils raison : mais nous objecterons que l’on ne change pas tout à coup la signification d’un mot sans risquer de tomber dans des contradictions et des équivoques sans fin, car ce mot a signifié jusqu’à hier tout le contraire du sens qu’on veut lui attribuer aujourd’hui.
Il est possible, répétons-le, que quelques socialistes ne poussent pas leurs conclusions dictatoriales jusqu’aux extrêmes, mais il est vrai aussi que tous les socialistes, c’est-à-dire ceux qui aujourd’hui se nomment extrémistes ou bolcheviques, entendent par « dictature du prolétariat » (et comment pourrait-il en être autrement ?) une « forme de gouvernement » de gestion étatique et centralisée de la révolution. Certains conçoivent ce gouvernement dictatorial prolétaire dans un sens plus absolu que d’autres. Les critères varient aussi sur son caractère plus ou moins provisoire, mais tous s’accordent sur la nécessité d’une direction étatique, autoritaire et centralisée de la révolution.
Et c’est naturel, bien que selon nous cela aille à l’encontre des véritables buts du socialisme et de l’intérêt réel de la révolution. Naturel, car les socialistes arrivent à concevoir la dictature par la voie de la méthode d’action qu’ils ont acceptée depuis Marx : la conquête des pouvoirs publics. Jusqu’à hier, ils voulaient acquérir le pouvoir au moyen des élections, légalement (un mot d’Andréa Costa à ce propos : « Se servir de la loi pour progresser, devenir majorité pour vaincre. »). Aujourd’hui qu’ils ont vu que c’était impossible, ils reconnaissent que les anarchistes avaient raison lorsqu’ils affirmaient que pour vaincre, il faut la révolution. Mais l’objectif premier de leur victoire est toujours la conquête du pouvoir, au moyen duquel ils pensent instaurer, par la suite, le socialisme. Ils veulent donc faire la révolution pour accéder au gouvernement, et rien de plus normal qu’une fois arrivés ils veuillent s’y maintenir, de gré ou de force. Voilà, pour eux, la nécessité de la dictature.
Dictature signifie négation de la liberté pour tous, sauf pour ceux qui commandent. Pour couper court à la discussion sur ce qu’est la dictature, il suffit d’observer ce qu’elle est en Russie. Il n’y a qu’à se rappeler tout ce qu’en ont dit certains de ses ressortissants, et que nous avons plusieurs fois cités. L’anarchiste Emma Goldman, expulsée des États-Unis vers la Russie suite à des accusations de menées bolcheviques, après un court séjour en république soviétique, écrivait, découragée, au journal Der Freie Arbeiter de Berlin : « Après quatre mois de résidence en Russie, je me suis aperçue que le socialisme d’État, ou capitalisme d’État, a fait de la Russie ce qu’il aurait fait de n’importe quel autre pays : il a enlevé aux citoyens jusqu’à la moindre liberté, et les a abandonnés aux caprices d’une bureaucratie qui excuse sa tyrannie en expliquant qu’elle est exercée dans l’intérêt des ouvriers[89]. »
En dehors de la Russie, on affirme ne pas vouloir en arriver à de telles extrémités, au contraire on ne le veut pas, on ne le croit pas. Mais compte tenu des prémices, des causes, il est inutile de vouloir se soustraire aux effets, aux conséquences inévitables.
En octobre 1919, au congrès des socialistes italiens à Bologne, tout le monde était d’accord : réformistes, extrémistes, électoraux et abstentionnistes. Tous les orateurs, de l’extrême droite à l’extrême gauche du congrès (et celui qui écrit les a entendus), ont interprété la dictature comme la conquête du pouvoir gouvernemental de la part du prolétariat, et personne n’a contesté. Les dissensions portaient seulement sur les moyens et les voies pour conquérir le pouvoir, et non pas pour ou contre le pouvoir.
Il est incontestable que le socialisme italien a fait un grand pas en avant en reconnaissant qu’en aucun cas (ni dans un sens étatique ni dans un sens anarchiste) on ne peut renverser l’actuel état des choses sans la révolution. Sur le terrain de la lutte immédiate tout au moins, les socialistes s’approchent beaucoup des anarchistes. Mais cette question du moyen révolutionnaire et de l’usage de la violence insurrectionnelle n’a rien à voir avec la question de la dictature, c’est-à-dire d’un régime nouveau à établir après avoir abattu l’ancien. La dictature consiste aussi dans la violence, mais dans ce sens qu’elle est réservée exclusivement au gouvernement qui se sera installé au pouvoir par la révolution. Sur ce point, c’est-à-dire sur la manière de continuer la révolution, de l’amplifier, de l’étendre et la consolider dans le temps et dans l’espace, nous sommes absolument en désaccord.
Ce n’est pas non plus la vague formule de « dictature du prolétariat » qui peut nous impressionner. Peu de personnes peuvent être des dictateurs, aussi bien que peu de personnes peuvent être rois ou ministres dans un gouvernement, et non pas tous les habitants du royaume en même temps. Donc « dictature du prolétariat » ne peut pas vouloir dire que tous les prolétaires commandent (auquel cas personne ne commanderait), mais plutôt que le pouvoir est confié à certains qui plus ou moins abusivement se disent représentants du prolétariat. Alors, comme disait Malatesta, le prolétariat participerait au gouvernement tout comme y participe le peuple en régime démocratique et parlementaire[90].
Pour rendre la dictature légitime du point de vue des droits du prolétariat, de la liberté et de la révolution, la manière dont elle s’est formée ou son mode d’accession au pouvoir ne suffit pas. Le fait d’y être arrivé par la révolution, par un coup de main qui a profité du renversement du pouvoir antérieur, ne lui donne pas de vertu représentative, tout au plus elle représenterait une minorité. Et en plus, justement parce qu’elle est devenue une forme de gouvernement, cela ne lui donnerait aucune vertu révolutionnaire, car ses composants commenceraient à sentir l’intérêt qu’ils auraient à conserver le pouvoir, à arrêter la révolution plutôt qu’à la poursuivre.
Beaucoup de socialistes acceptent la dictature dans sa véritable signification. Lénine lui-même, dans son fameux discours de Moscou de l’été 1918, revendique pour les minorités, non seulement le droit de se révolter contre les gouvernements bourgeois, mais aussi celui de s’imposer par la violence aux majorités prolétariennes et aux autres oppositions révolutionnaires, et il en arrivait à admettre sans autre forme de procès la nécessité et l’utilité de la dictature personnelle. Son langage ne laissait aucune équivoque, il soutenait lui-même que sa conception de la dictature était inconciliable avec l’anarchisme.
Il est vrai aussi que d’autres socialistes interprètent le concept de dictature d’une autre façon, c’est-à-dire tout simplement comme un gouvernement représentatif, une république prolétarienne ultra-démocratique et antibourgeoise, dans laquelle les ministres sont remplacés par les « commissaires du peuple », et le parlement par les « soviets », autrement dit par le « conseil des ouvriers et des paysans ». Et ils soutiennent qu’une république de ce genre serait moins dangereuse pour la liberté qu’une véritable dictature. Mais ce ne serait plus la dictature. Cependant, les anarchistes savent bien ce qu’il y aurait d’illusoire même dans cette forme de gouvernement représentatif, dans cette espèce de domination de la démocratie prolétaire. Les anarchistes pensent que ce gouvernement aussi arrêterait la révolution, favoriserait la formation d’une nouvelle classe dominante, à moins qu’il ne cherche à s’allier avec une partie de l’ancienne, et qu’au fur et à mesure qu’il se renforcerait, il assumerait un caractère conservateur contraire aux intérêts du peuple, et donc des masses prolétaires.
Et alors ? nous demandera-t-on. Pas de gouvernement ! répondrons-nous, et contre tous les gouvernements ! Il ne peut y avoir d’autre mot d’ordre pour la révolution !
Bien entendu, nous ne nous faisons pas d’illusions.
S’il y avait aujourd’hui une révolution et si l’État bourgeois était renversé et vaincu, il est peu probable qu’on puisse établir du jour au lendemain une société sans gouvernement. Mais la continuité et le renforcement de la révolution seront garantis, non pas par un quelconque nouveau gouvernement bâti sur les ruines de l’ancien, mais par l’opposition révolutionnaire exercée contre lui. Moins fort, moins autoritaire et moins centralisateur sera le nouveau gouvernement, c’est-à-dire plus soumis à l’influence et à la pression externe de la révolution, et plus forte sera la révolution, plus celle-ci sera radicale et libératrice.
La politique de la révolution, s’il est permis de l’appeler ainsi, consiste en la diminution toujours plus accentuée des pouvoirs de l’État, jusqu’à ce que celui-ci ait complètement disparu. Au contraire, l’idée de la dictature représente une politique absolument opposée, donc, selon nous, essentiellement antirévolutionnaire.
« Nous n’admettons pas, serait-ce même en tant que transition révolutionnaire, les conventions nationales ni les dictatures prétendues révolutionnaires, car nous pensons que la révolution ne peut être sincère, honnête et réelle que parmi les masses et que, quand elle est concentrée dans les mains de quelques gouvernants seulement, elle devient immédiatement et inévitablement la réaction[91]. »
Après ces paroles, nous pensons qu’aucune équivoque sur les différentes significations du mot « dictature » ne soit plus possible.
Il ne faudrait pas croire qu’il est question ici de pureté de langage pour l’amour… de la langue ! Si l’on veut sérieusement se servir du mot « dictature » (ainsi que le font beaucoup de révolutionnaires et de socialistes) tout simplement comme synonyme d’action directe révolutionnaire, de violence insurrectionnelle, de force de classe, de révolte des minorités audacieuses, de luttes implacables pour l’expropriation de la bourgeoisie et que tout le monde soit d’accord, que personne ne l’entende d’une autre manière et que la signification étymologique, historique et traditionnelle de ce mot soit entièrement effacée des dictionnaires et des cerveaux, ce ne serait pas grave ! Nous n’aurions aucune difficulté à l’accepter aussi dans ce sens, car ce qui nous intéresse, ce sont les faits et non les paroles. Mais dans l’opinion de tous, aujourd’hui comme hier, dictature, pouvoir, État, gouvernement, sont une chose, et force, violence, révolte, action directe, etc., en sont une autre. Les premiers sont des institutions, les seconds sont des moyens mis à la disposition des premiers. Force et violence sont des capacités et des formes d’action qui peuvent être aussi révolutionnaires, prolétaires, populaires. Le pouvoir ou le gouvernement, l’État et la dictature, sont des organismes autoritaires constitués qui sont, d’après nous et d’après leur nature, contre-révolutionnaires, même s’ils se disent ou se croient révolutionnaires, tout comme le seraient des organismes qui, au sein de la révolution, conserveraient le privilège et le monopole de la propriété.
Quand on parle de dictature prolétaire ou révolutionnaire, l’équivoque est impossible, et ceux qui écoutent entendent justement ce que nous voulons le moins, c’est-à-dire un gouvernement centralisé et militaire, dirigeant la révolution du haut de son pouvoir. Ceux qui ont récemment le plus divulgué cette notion de « dictature du prolétariat », c’est-à-dire les socialistes maximalistes, de Liebknecht à Lénine, et en Italie de Serrati à Bordiga, l’entendent comme l’ancienne « conquête des pouvoirs publics » (ou la constitution d’un gouvernement ou pouvoir étatique centralisé et impitoyablement consolidé, qui commande au nom de la collectivité et du prolétariat). Avec la seule différence qu’au lieu de l’obtenir au moyen des élections, ils le feraient au moyen de la révolution.
Lénine lui-même est très clair à ce propos : « Les socialistes veulent utiliser, dit-il, les institutions gouvernementales dans la lutte pour la libération de la classe ouvrière. » Il trouve qu’il n’y a pas de contradiction entre la démocratie socialiste des soviets et l’usage du pouvoir dictatorial des individus ; parce qu’il voit en ceux-ci les représentants de ceux-là ; et donc de tout le prolétariat. Mais quel État, quel gouvernement n’a pas prétendu, et plus spécialement de 1789 à nos jours, être l’expression de la synthèse de la volonté de tout un pays, de tout un peuple. Substituez dans son expression littéraire le prolétariat au peuple, il restera devant nous le même problème de l’État à résoudre : ou l’accepter ou le nier.
Les anarchistes ont déjà résolu ce problème. En restant fidèles à leurs idées de la révolution anti-étatique, ils repoussent tout concept de dictature et toute formule qui la sous-entend.
L’enseignement des précédentes révolutions
L’illusion que, dans des moments exceptionnels de guerre ou de bouleversements, le salut du peuple puisse être l’œuvre de la volonté d’une minorité, voire d’un seul homme mis à la tête d’un gouvernement et proclamé dictateur, est aussi vieille que le monde, et elle a provoqué la ruine de toutes les révolutions. Il ne s’agit, au fond, que de l’esprit d’autorité cherchant par tous les moyens à prendre le dessus sur l’esprit de liberté, et profitant même, pour vaincre son adversaire, des moments les plus tragiques.
Les socialistes, dits maximalistes, sont victimes, aujourd’hui, de cette illusion, en partie parce que, au fond, ils sont toujours les militants de l’ancien parti autoritaire marxiste, en partie pour la survivance parmi eux des traditions démocratiques jacobines, aussi et surtout à cause de la fascination exercée sur tous, y compris nous-mêmes, par la résistance héroïque et tragique, depuis trois ans, de la révolution russe contre la coalition réactionnaire de tout le monde capitaliste. Sous l’influence de l’illusion autoritaire toujours renaissante, on voudrait confier à une dictature qui représenterait les prolétaires, la direction suprême de la révolution contre le capitalisme et contre l’État bourgeois.
Y font exception, il est vrai, certains socialistes qui, tout en acceptant cette terminologie (selon nous erronée et source d’équivoque et de confusion), entendent simplement par « dictature » l’action violente et révolutionnaire contre la bourgeoisie, l’acte en soi de l’expropriation, ou encore certaines formes d’administration en période révolutionnaire, comme les conseils ouvriers ou les communes libertaires, etc. Avec ceux-ci, il est inutile de discuter puisque nous sommes d’accord, mais il s’agit là d’exceptions, car la grande majorité des socialistes qui parlent de « dictature prolétarienne » entendent (et leurs dirigeants plus spécialement encore) une véritable direction étatique de la révolution, une véritable forme de gouvernement despotique. C’est justement cette conception autoritaire de la révolution que nous critiquons.
Cette critique n’est pas une nouveauté. Nous ne faisons que la répéter.
Ce que nous disons aujourd’hui a déjà été répété, particulièrement après les révolutions de 1848 et celle communaliste de 1871 en France. Les hommes qui y ont participé ont dit ce qu’ils en pensaient, après avoir, pour ainsi dire, étudié expérimentalement les événements auxquels ils avaient pris part. C’est même de l’expérience révolutionnaire de cette période historique qu’est né l’anarchisme, en tant que tendance libertaire de la révolution et du socialisme.
Ceux de nos adversaires qui traitent de doctrinaire notre opposition à la forme dictatoriale de la révolution, comme s’il s’agissait d’une opposition guidée par des critères seulement logiques et abstraits, se trompent. Bien au contraire, nous avons tiré notre enseignement des faits historiques du passé et de l’expérience de nos pères, nous avons appris quelles sont les armes utiles, et quelles sont, en revanche, les erreurs à éviter dans la révolution. La logique et la faculté de raisonnement nous ont permis de tirer de ces expériences et enseignements la conviction anarchiste qu’en période révolutionnaire toute forme de gouvernement est un piège tendu en permanence au prolétariat, un danger continu, un dommage pour la liberté et la révolution.
L’expérience du passé nous apprend que, lorsqu’un quelconque gouvernement se constitue en temps de révolution, soit à cause de l’ignorance du peuple, soit pour des causes de force majeure, le salut n’est plus dans le gouvernement mais dans les forces révolutionnaires qui restent en dehors de lui et ont le courage de se placer dans l’opposition contre lui, afin de pousser toujours plus avant la révolution.
Toute l’histoire humaine, qui n’est pas seulement, ainsi que l’affirment les marxistes, une lutte de classes entre les riches et les pauvres, mais aussi une lutte entre gouvernants et gouvernés, entre autorité et liberté, démontre que chaque fois que les peuples ont confié leur salut à une autorité centrale, quelle qu’en soit la raison, (pour vaincre une guerre, pour remettre de l’ordre, pour assurer la tranquillité publique), cette autorité a fini par les rendre esclaves.
Depuis les villes de la Grèce antique tombées ainsi sous la domination des tyrans (qui tuèrent tout esprit viril et permirent la conquête romaine) jusqu’à la Rome républicaine elle-même (que les guerres civiles avaient réveillée et secouée de l’ancien joug patricien), nous voyons se répéter le même phénomène. La fin de l’ancienne République romaine a suivi le même processus ; le peuple, affaibli et désireux de tranquillité, avait cru bien faire en confiant son destin aux chefs des différentes factions, et comme ces chefs suscitaient, par leurs rivalités, de nouveaux conflits, on crut que leur accord suffirait au bien-être des sujets, et il y eut la dictature des triumvirs. Ensuite les dictateurs les plus forts et les plus rusés éliminèrent les plus faibles, et le dernier changea sa charge de dictateur contre celle d’empereur.
Ainsi naquit le monstrueux Empire romain sur les ruines de la République classique qui avait eu comme devise le mot « Libertas ». La liberté avait été tuée définitivement et pour des siècles. Elle refit surface vers la fin du Moyen Âge, spécialement en Italie, et avec une splendeur inaccoutumée, avec les communes. Mais les communes libres, elles aussi, furent tuées l’une après l’autre, et transformées en républiques oligarchiques et en seigneuries par le même phénomène, c’est-à-dire que la défense des libertés communales fut confiée à ces sortes de dictateurs militaires qu’étaient les capitaines de milices, ou bien certains des plus riches bourgeois de la ville.
Les communes républicaines du Moyen Âge, ayant besoin de se défendre contre les féodaux chassés, contre les assauts de l’Église et de l’Empire, crurent bien faire en confiant leurs villes libres à l’autorité plus ou moins dictatoriale des condottieri. Et ce furent justement ces condottieri qui, par la traîtrise, la violence, ou les deux à la fois, finirent par étrangler les libertés communales, soit au bénéfice du pape ou de l’empereur, soit en devenant eux-mêmes patrons et tyrans. Cela se produisit en grande partie à cause de la malhonnêteté des hommes, mais en bonne partie aussi à cause de la succession logique et naturelle des faits. De l’usage de moyens ultra-autoritaires ne pouvait surgir qu’un système de tyrannie.
Les lecteurs comprendront que pour des événements aussi anciens et éloignés de nous, l’exemple n’a qu’une valeur approximative, car, en ce temps-là, beaucoup d’autres éléments différents, qui en partie nous échappent, ont concouru à les créer. En revanche, l’exemple est beaucoup plus valable et convaincant à mesure que nous nous approchons de notre époque et que nous entrons dans la période des révolutions populaires, avec la participation effective et consciente du peuple tout entier, c’est-à-dire de 1789 à nos jours.
Pour la période précédente, on ne peut fonder notre raisonnement que sur le témoignage d’écrivains tout à fait éloignés des idées actuelles. Mais depuis la Révolution française, c’est autre chose. Nous disposons, en effet, d’un matériel documentaire et expérimental recueilli, ordonné et étudié par des écrivains de tendances et d’idées les plus variées. Parmi eux, un bon nombre était animé par un amour ardent de la cause du peuple et de la liberté, et ce matériel a permis aux meilleurs auteurs socialistes et anarchistes des constatations positives, à partir desquelles ils ont conçu la doctrine libertaire, non seulement comme projet de vie future et d’organisation sociale, mais aussi comme une conception réaliste de la révolution sociale.
Pendant les polémiques sur la dictature, certains nous ont reproché de citer souvent l’autorité morale et intellectuelle des meilleurs auteurs et théoriciens anarchistes : Bakounine, Pisacane, Proudhon, Kropotkine, etc. On prétend voir là une espèce de parti pris, d’a priori doctrinaire, comme si nous voulions sacrifier toutes les nécessités de la révolution à une cohérence formelle avec les conceptions théoriques de nos penseurs.
On ne tient pas compte d’une chose essentielle : les meilleurs auteurs de l’anarchisme n’ont pas formulé leurs idées en bloc, comme un « présupposé » abstrait, pour en déduire ensuite des applications pratiques. Au contraire, ils ont tiré leurs conclusions théoriques de leur vécu, de l’expérience pratique, du déroulement de faits historiques, ainsi que les normes pratiques qu’il faut adopter pour le but que nous voulons atteindre, dans des circonstances ou analogues à celles dans lesquelles ils se sont trouvés ou qu’ils ont profondément étudiées. La nécessité d’un développement libertaire, anarchiste, de la révolution, pour le salut de la révolution elle-même, ils l’ont affirmée, comme Kropotkine, par l’étude minutieuse et assidue des révolutions précédentes, ou bien par leur propre expérience, par les événements auxquels ils ont participé directement ou dont ils ont été les témoins. Donc, ce qu’ils disent n’est plus une théorie abstraite, mais un enseignement pratique, une véritable application de la méthode expérimentale. Nous faisons particulièrement référence à Pisacane, qui a participé activement aux révolutions italiennes de 1848, à Bakounine, qui a pris part à des tentatives révolutionnaires en Allemagne et en France en 1848 et en 1870, à Lefrançais, acteur et spectateur tout à la fois des deux révolutions communalistes de Paris en 1848 et en 1871, et enfin à Proudhon, qui a vécu sa vie politique justement pendant les périodes les plus importantes des révolutions françaises de 1830 à 1860.
Nous citons leurs conclusions anti-dictatoriales pour ne pas refaire un travail qu’ils ont déjà fait. Ceux qu’on a déjà nommés, ainsi que d’autres encore (Reclus, Déjacques, Arnould, Michel, etc.), non seulement ont étudié les précédentes révolutions, mais y ont aussi participé personnellement, répétons-le, et ont été instruits par des faits réels. En ce sens, on peut les considérer comme nos maîtres, car ils nous transmettent ce qu’ils ont appris d’une réalité vécue par eux, mais déjà éloignée de nous, tout en pouvant, sous certains aspects, se répéter.
Et puis il ne faut pas oublier que l’anarchie, bien plus que par le génie de ses théoriciens et écrivains, a été formulée collectivement, après une élaboration de quelques dizaines d’années à travers le mouvement socialiste, du lendemain de la Révolution française à la veille de 1848, et plus spécialement encore dans ce véritable laboratoire expérimental d’idées qu’a été la glorieuse première Internationale. Presque tous les auteurs mentionnés (excepté Pisacane, Proudhon et Déjacques qui ont vécu avant et n’y ont pas participé) n’ont été que les porte-parole géniaux et synthétiques d’une pensée collective qui repoussait toute conception dictatoriale de la révolution.
La discussion que nous engageons aujourd’hui a déjà été soulevée dans la première Association internationale des travailleurs.
Le Congrès de Saint-Imier, au mois de septembre 1872, opposait aux courants blanquiste et marxiste du socialisme cette délibération, que les socialistes devraient tenir présente à l’esprit aujourd’hui, car elle est le fruit de l’expérience des révolutions précédentes dont les internationalistes tirèrent leurs déductions théoriques : « Considéré que toute organisation politique ne peut être autre chose que l’organisation de la domination d’une classe au détriment des masses ; et que le prolétariat, s’il se trouvait à être maître du pouvoir, constituerait lui-même une classe dominante et d’exploitation, le Congrès déclare :
1. que la destruction de tout pouvoir politique est le premier devoir du prolétariat ;
2. que toute organisation d’un pouvoir politique prétendument provisoire et révolutionnaire dans le but de cette destruction ne serait qu’un piège de plus, et représenterait pour le prolétariat un danger aussi grand que celui représenté par tous les gouvernements actuellement existants [92]. »
A l’appui de ce même concept, la délibération contient aussi d’autres affirmations et d’autres considérants dont, pour abréger, nous faisons grâce aux lecteurs. D’ailleurs, nous estimons en avoir reproduit suffisamment pour prouver comment la conception de la révolution, acceptée par le courant le plus avancé majoritaire au sein de la première Internationale, était anarchiste et point dictatoriale. Cette même conception était reprise dans une lettre de Malatesta, rappelant de quelle façon, en régime dictatorial révolutionnaire, les dictateurs se servent de leurs agents et de leur force armée aussi pour défendre leur révolution contre les ennemis extérieurs certes, mais pour s’en servir ensuite, le lendemain, dans le but d’imposer au peuple leur propre volonté, pour arrêter la révolution, consolider les nouveaux intérêts qui sont en train de se constituer, et défendre une nouvelle classe privilégiée contre la masse ainsi qu’il en avait été dans les dernières phases de la Révolution française. La dictature de Robespierre l’a conduit à la guillotine mais a déblayé la route à Napoléon. Lequel, il est vrai, simple général de la République, a servi à défendre la Révolution française contre la réaction européenne, mais en la défendant il l’a étranglée [93].
Si la réaction européenne, quelques années plus tard, reprit le dessus aussi aisément, ce fut justement parce que la dictature jacobine et sa conséquence, l’Empire napoléonien, lui avaient préparé la route en débarrassant le terrain de toute opposition populaire et de tous les éléments révolutionnaires.
Mais cette vérité qui, à la lumière de la critique historique, nous semble aujourd’hui très claire, est restée cachée pendant longtemps sous le voile de l’illusion autoritaire. Jusqu’à la première moitié du siècle dernier, tous les révolutionnaires, y compris ceux de tendance socialiste, étaient restés esclaves de la tradition jacobine. Pour eux, la révolution était autant la prise de la Bastille et des Tuileries que le fait des États généraux, de la Constituante, de la Convention et surtout, de la dictature de Robespierre, de Danton, Saint-Just, etc Ils ne voyaient pas que la vérité était justement à l’opposé et que le peuple seul, en l’absence des organes centraux de la révolution officielle sinon en opposition avec eux, avait fait les insurrections du 14 juillet, du 10 août, les journées d’épuration de septembre, l’assaut des châteaux, etc.
Les historiens qui ont essayé de savoir ce que faisaient les organes directifs du mouvement politique de la révolution et les directeurs jacobins, pendant les jours et les nuits d’action directe populaire, ont dû convenir que le rôle qu’ils avaient rempli dans ces moments décisifs avait été négatif ou passif, voire, pour quelques-uns, ridicule.
Et pourtant, jusqu’en 1848 environ, c’est la conception autoritaire qui avait cours chez les révolutionnaires. Ils ne voyaient, de la Révolution française, que l’aspect extérieur, politique et gouvernemental. Et cela, selon l’approche des historiens bourgeois, qui présentent les faits sociaux comme étant dus à la volonté directrice d’un petit nombre d’hommes, en oubliant la libre action des foules et des individus anonymes qui les composent. Ainsi, les deux révolutions successives à la réaction de 1815 cherchèrent à se modeler sur la précédente. La première, celle de juillet 1830, fut tout de suite détournée avec la nomination du roi Philippe d’Orléans. Mais la deuxième, après cette leçon, prit une direction bien plus radicale. En effet, la révolution de février 1848 eut tout de suite un caractère républicain socialiste, mais hélas ! toujours jacobin.
Nous avons déjà parlé ailleurs de la mort des illusions révolution-naires de cette année-là, noyées dans le sang des massacres de juin, et nous avons expliqué que la Constituante avait été l’organe de la réaction bourgeoise qui les étouffa. Ajoutons que la réaction, qui s’était manifestée à travers le suffrage universel d’avril, avait été à son tour plus ou moins inconsciemment préparée par les dictateurs révolutionnaires que le peuple parisien avait porté au pouvoir en février, ce peuple qui s’en remettait à eux en toute chose, au lieu de continuer par lui-même la révolution. Mais le peuple, ainsi que la minorité consciente qui s’était battue sur les barricades, avaient été maintenus par des sociétés plus ou moins secrètes ou de carbonari, dans l’illusion jacobine qu’il suffisait de renverser le pouvoir et d’y installer des hommes nouveaux pour qu’ils puissent, par l’autorité et la force, réaliser l’égalité et la liberté.
Nous avons vu, en revanche, comment le gouvernement provisoire de février prépara le terrain aux élections réactionnaires, à la Constituante, à la dictature militaire de Cavaignac, à l’empire de Napoléon le Petit. Cette débâcle a été précédée d’une propagande néfaste, qui attribuait à un pouvoir révolutionnaire la faculté de réformer, suivant les besoins et les aspirations populaires, la constitution sociale. C’est à cette propagande des socialistes de gouvernement, comme Louis Blanc, que l’on doit en grande partie la popularité acquise en France par l’ex-carbonaro socialisant Louis Bonaparte, devenu par la suite l’empereur bandit Napoléon III.
« Louis Blanc est un homme qui a puissamment concouru à populariser l’idée de la dictature ; (…) il ne faut donc pas s’étonner si on dit dans les faubourgs qu’il approuve le coup d’État. » Cette remarque sur l’œuvre de Louis Blanc, qui représentait le courant socialiste au sein du gouvernement provisoire français de 1848, est de son contemporain P.-J. Proudhon[94]. Proudhon constatait, justement, de quelle façon en quatre ans seulement, la dictature avait précipité la révolution dans la contre-révolution.
Cependant, la leçon avait porté et une grande partie de la littérature socialiste et révolutionnaire d’après 1849 avait pris une direction anti-autoritaire. On peut dire que l’idéal anarchiste est né de la leçon des révolutions de cette année-là, tout au moins dans ses premières expressions. On commença donc à réexaminer en ce sens l’histoire de la Grande Révolution. Le mot d’ordre, spécialement pour les révolutionnaires socialistes, était que le peuple devait œuvrer par lui-même, se méfier des autorités même révolutionnaires, et ne devait reconnaître de dictature providentielle d’aucune sorte. Naquit alors la polémique contre le vieux révolutionnarisme bourgeois et jacobin, pour lequel avait pris parti, depuis lors déjà, Giuseppe Mazzini, tandis que la nouvelle idée anarchiste, avec ses bases économiques, était défendue surtout par Proudhon. La propagande de celui qui a été appelé le père de l’anarchie prévalut en cette période et dégagea une lumière qui ne s’est jamais éteinte.
Or, l’une des caractéristiques principales de ce mouvement et de cette propagande était l’aversion pour n’importe quelle dictature révolutionnaire, que Proudhon appelait « le vestibule du despotisme ». À cet argument il dédiait tout un chapitre de son livre Idée générale de la révolution au XIXe siècle. Il y soutenait que le peuple en révolution devait arriver jusqu’à l’extrême limite de la liberté, « ne plus avoir au-dessus de lui ni présidents, ni représentants, ni commissaires, ni pays légal, ni majorité[95] ». Pendant la période révolutionnaire (avril 1848), dans un article de son journal le Représentant du peuple, il se demandait, angoissé, pour quelle raison le peuple, juste au moment où il rompait avec les institutions établies, replongeait dans la tradition du passé.
« Pour organiser l’avenir, les réformistes commencent toujours par considérer le passé : c’est de cela que vient la perpétuelle contradiction de leurs actes ; de là que vient l’immense danger qui guette les révolutions. Car le jour où le peuple renverse une monarchie, immédiatement après il la change contre une dictature. Et, en cela, il y a l’influence du souvenir, un souvenir préexistant à la tyrannie elle-même qui vient d’être renversée ; et il y a contradiction parce que l’absolutisme est mis en garde-fou contre l’absolutisme[96]. »
On peut objecter que ces critiques étaient dirigées contre les dictatures bourgeoises et non contre la dictature prolétarienne telle qu’on la veut aujourd’hui, ce qui est une chose neuve.
Non, ce n’est pas quelque chose de nouveau. Cette conception remonte aux origines de l’histoire socialiste, à Gracchus Babeuf, en 1796. Après 1848, Blanqui la prêchait encore. Il disait, il est vrai, que « l’anarchie est l’avenir de l’humanité », mais, dans son mouvement, dans ses méthodes d’action, il restait autoritaire, et ses partisans, dans l’Internationale, s’étaient rangés aux côtés de Marx contre Bakounine. Les critiques de Proudhon et des autres libertaires étaient dirigées contre n’importe quelle forme de dictature entendue comme un gouvernement central qui se constitue après une insurrection victorieuse pour guider, pour « gouverner » la révolution. Implicitement, ce furent donc des critiques dirigées contre la dictature prolétarienne, même quand elles ne lui étaient pas adressées directement.
Mais ceux qui seraient en mesure de fouiller parmi les journaux de l’époque ne manqueraient pas d’y trouver aussi des attaques explicites et directes parmi les écrits des socialistes anti-autoritaires comme Déjacques, Bellegarigue, Cœurderoy, etc. Pour les résumer tous, on citera un long article de Déjacques contre les « dictatures providentielles » (1859). Ce précurseur du terrorisme et du communisme anarchiste, ouvrier décorateur et tapissier, mais aussi écrivain et poète, fut l’un des héroïques insurgés de juin 1848, qui connut les persécutions, la prison et l’exil, et mourut misérable en 1878. Dans son écrit, qu’il serait nécessaire de reproduire en entier, il critique l’école socialiste de Blanqui, et se jette avec une extrême violence verbale contre les dictatures révolutionnaires, la prolétaire comprise. Il s’exclame : « Mettre les ouvriers au pouvoir !… Mais de même que sur les marches du trône les courtisans sont plus royalistes que le roi, ainsi sur les marches hiérarchiques de l’autorité officielle ou légale, les ouvriers sont plus bourgeois que les bourgeois. »
C’est une réponse anticipée, en avance de soixante ans, à l’objection encore reprise aujourd’hui, selon laquelle pour les révolutions du passé, il s’agissait de dictatures bourgeoises, tandis qu’aujourd’hui il s’agirait de dictatures prolétariennes. Hélas, Mutato nomine de te fabula narratur disaient les anciens, c’est-à-dire qu’en ce qui concerne les effets propres à l’exercice du pouvoir, qu’il y ait des bourgeois ou bien des ouvriers ou représentants des ouvriers, il s’agit bien et toujours de la même chose, changerait-elle de nom. Afin que le pouvoir confié aux ouvriers et à leurs représentants n’engendre pas les mêmes dommages que tout gouvernement, il faudrait que ces hommes soient dotés de vertus spéciales par rapport aux bourgeois. Au reste, ici et là, des expériences d’ouvriers au pouvoir ont aussi eu lieu après 1848 et… elles n’ont pas fourni de meilleures preuves que les autres.
« L’autorité étatique, la dictature, qu’elle s’appelle empire ou république, trône ou fauteuil, sauveur de l’ordre ou comité de salut public, qu’elle soit entendue au singulier ou au pluriel, ne pourrait que retarder l’avènement de la révolution sociale en substituant à la volonté raisonnable et à l’autonomie de chacun son initiative, sa raison toute-puissante, sa volonté coercitive. La révolution sociale ne peut s’accomplir que par l’œuvre de tous individuellement : autrement ce ne peut être la révolution sociale. Ce qu’il faut, ce vers quoi il faut tendre, c’est mettre chacun dans la possibilité d’agir, en en démontrant la nécessité, afin que le mouvement, en se communiquant de l’un à l’autre, donne et reçoive l’impulsion nécessaire pour progresser, et en décuple la force. La dictature, au contraire, n’est que le viol de la liberté perpétré par une virilité corrompue et malade : cela devient un mal inoculé dans les organes populaires… Cela devient un attentat contre les bonnes mœurs, un délit comme l’abus du tuteur contre sa pupille… c’est un humanicide ! [97] »
Cela nous a été laissé par des hommes dont la pensée avait été formée dans l’action, au feu ardent des révolutions passées.
A ces mêmes conclusions étaient arrivés aussi beaucoup de révolutionnaires politiques italiens, après les révolutions italiennes de 1848, même si leur caractère social avait été presque nul, ou seulement inconsciemment sous-entendu. Cependant, ce constat a de l’importance pour nous qui vivons en Italie et qui, donc, sommes portés à mieux connaître l’histoire de notre pays. Les dommages provoqués par les dictatures révolutionnaires ont été constatés dans presque tous les mouvements nationaux, de 1821 à 1860, bien que leur caractère exclusivement politique se prêtât davantage à concilier ces mouvements avec l’idée de la dictature. On pourrait trouver de nombreuses preuves de cela, dans les écrits de presque tous les auteurs républicains fédéralistes, et même chez quelques unitaires mazziniens. Il faudrait, entre autres, lire l’examen des Tristes Faits de Milan de 1848, dans les publications de peu postérieures aux événements, de Cattaneo, Belgioioso, Rastelli et Maestri. On verrait de quelle façon les fruits des magnifiques « cinq journées » de révoltes, dues exclusivement à la libre initiative populaire et déclenchées contre l’avis des chefs, furent gaspillés par les ineptes dictateurs du gouvernement provisoire, lesquels ont fini par conduire à la ruine cette révolution-là, et, par contrecoup, toutes les autres révolutions de la péninsule.
Les auteurs cités, il est vrai, n’étaient pas des socialistes, mais leur amour de la vérité et de la liberté, leur sincérité révolutionnaire n’est pas en doute. D’autre part, si vraiment on veut lire un auteur socialiste, il reste Pisacane. Chez cet homme plus que chez d’autres, l’action s’harmonisait avec la pensée. Il avait participé activement aux révolutions de 1848 dans toute l’Italie, aux guerres de Lombardie, à la défense de Venise en 1849. Il conspira, et mourut au cours de sa dernière tentative insurrectionnelle, l’expédition de Sapri. Il agissait et étudiait les faits auxquels il participait, et, de ses études, il tirait les conclusions que le guidaient vers de nouveaux faits, des événements nouveaux. Il examina méticuleusement les émeutes de 1848–49, dans son livre Guerra combattuta in Italia negli anni 1848–49. Par la suite, dans tous ses autres essais, et spécialement dans Saggio sulla rivoluzione, il aboutit aux mêmes conclusions. Presque tout le quatrième chapitre de ce dernier livre est une critique de la méthode dictatoriale de la révolution. En polémiquant avec Mazzini, dont il combat l’unitarisme centralisateur et autoritaire, il soutient que la dictature, en Italie comme en Europe, « avait fait ses preuves », et que le résultat avait été d’être toujours vaincue. Pourquoi donc ne pas essayer la liberté ? « La dictature est l’écueil de la révolution, elle rend l’unité des efforts irréalisable… Parler d’éduquer par la dictature et éduquer à la liberté est une énigme, une expression qui ne renferme rien d’autre qu’une contradiction manifeste… une contradiction en elle-même, pour un peuple qui aspire à la liberté. Impuissante à produire le bien, source de tous les maux, elle cache en son sein de très graves dangers [98] », etc.
Giuseppe Ferrari, en 1851, disait aussi : « Ne séparez pas la liberté de la révolution. »
Lorsque, vingt ans après, un autre géant de la révolution, Michel Bakounine, enseignait que « l’opinion des communistes autoritaires, selon laquelle une révolution sociale peut être décrétée et organisée soit par une dictature, soit par une assemblée constituante issue d’une révolution politique, est absolument erronée [99] », une autre expérience historique avait été faite : la Commune de Paris de 1871.
Bakounine écrivait cela en étudiant, justement, les événements et les tentatives révolutionnaires de cette année-là, auxquels il avait été mêlé, comme il avait participé, bien des années auparavant, à l’insurrection de Dresde. Donc, lui aussi tirait ses théories des faits, de la pratique, et de sa propre expérience.
Dans la Commune, ce furent les éléments jacobins, républicains radicaux et blanquistes, qui eurent le dessus. En revanche, les éléments appartenant à l’Internationale, qui s’était constituée depuis quelques années déjà, étaient restés dans l’opposition, tout en étant naturellement solidaires de la Commune contre Versailles, même si quelques-uns, comme Malon, Elisée Reclus et Varlin, acceptèrent du gouvernement provisoire des fonctions d’utilité publique, conciliables avec leurs propres idées. Nos compagnons d’alors – conformément à cette époque pendant laquelle l’idée anarchiste n’était pas aussi bien précisée qu’elle l’est aujourd’hui – étaient restés fidèles aux principes d’autonomie et de liberté. Ils avaient bien défendu la Commune, les armes à la main, Louise Michel et Elisée Reclus étant parmi les combattants, mais ils furent toujours de simples miliciens mêlés aux humbles, jamais des chefs. Ils ont combattu pour la Commune, mais ils ne l’ont pas gouvernée.
La ruine de la Commune fut d’avoir voulu être avant tout un gouvernement régulier. Louise Michel disait : « Si l’on n’avait pas perdu du temps à vouloir former un gouvernement, et si l’on avait marché tout de suite sur les Versaillais qui n’étaient encore pas très forts, la Commune aurait vaincu[100]. » Autrement dit, la révolution se serait étendue, victorieuse, sur toute la France. Mais voilà qu’on a préféré organiser la dictature, et celle-ci, en réprimant toutes les libertés (ainsi que le fait remarquer Malatesta[101]) avec les moyens habituels de police, perquisitions à domicile, arrestations, suppressions de journaux et autres pires violations des droits individuels, a arrêté l’élan de la révolution. C’est pour cette raison que seulement une petite minorité de la population prit part à la défense de la Commune. Et la Commune fut vaincue, à cause du principe d’autorité.
Elle avait elle-même bâti le plus grand obstacle à ce que l’on pouvait et devait faire pour vaincre.
Par la hardiesse de sa révolte, par le courage de ses défenseurs, par le martyre des 35 000 prolétaires assassinés pendant la « Semaine sanglante » qui couronna sa fin, la Commune est devenue un mot d’ordre, un drapeau pour les révolutionnaires de toute l’Europe. Pendant les premiers moments, personne n’a songé à ses erreurs, au contraire (comme le fait observer Malatesta) chacun, avant même qu’une quelconque donnée sérieuse soit parvenue sur son déroulement, interpréta le mouvement selon ses propres désirs socialistes et révolutionnaires. Quelque chose de semblable se produit aujourd’hui pour la Russie. Mais les plus clairvoyants, d’autant plus nombreux que la réalité se faisait jour, ont tiré, des faits réels et des expériences, le meilleur des enseignements afin de ne pas répéter à l’avenir les erreurs du passé.
Ce furent donc les communards eux-mêmes, y compris ceux qui avaient fait partie du gouvernement de la Commune, qui ont montré, avec la plus grande éloquence, l’erreur de confier la révolution à un pouvoir central.
« A force d’établir des comparaisons entre les choses, les événements, les hommes, écrivait Louise Michel, après avoir vu à l’œuvre nos amis de la Commune, aussi honnêtes qu’ils étaient réputés terribles, j’ai eu la conviction, en très peu de temps, que les hommes intègres arrivés au pouvoir sont aussi ineptes que sont nuisibles les hommes malhonnêtes, et qu’il est absolument impossible que la liberté puisse, ne serait-ce que l’espace d’un seul moment, être l’alliée d’un pouvoir quelconque [102]. »
Arthur Arnould, qui avait fait partie du gouvernement de la Commune dans la commission des Affaires étrangères, est encore plus précis et catégorique : il a écrit une Histoire populaire et parlementaire de la Commune qui est malheureusement introuvable actuellement dans sa première et unique édition, et qui mériterait bien mieux que tant d’autres œuvres d’être rééditée et traduite. Arnould, qui a vécu en Belgique après la Commune, et qui, plus tard, s’est retiré de la vie politique, a écrit des pages éloquentes et profondes contre la conception étatique de la révolution. En ce qui concerne la Commune, il décrit les dissidences intérieures entre la majorité jacobine et autoritaire, et la minorité socialiste et fédéraliste (à ce moment-là on ne disait pas encore libertaire ou anarchiste) :
« A peine réunis, nous constatâmes un fait important : les mots « Commune de Paris » étaient interprétés par les différents membres de l’Assemblée de deux façons : pour les uns, la Commune de Paris exprimait et personnifiait la première application du principe antigouvernemental, de la guerre aux vieilles conceptions de l’État unitaire, centralisateur et despotique. Pour ceux-là, la Commune représentait le triomphe du principe de l’autonomie des groupes librement fédérés, et du gouvernement le plus direct possible du peuple et avec le peuple. A leurs yeux, la Commune était la première étape d’une vaste révolution sociale et politique, qui aurait dû faire disparaître les anciens errements. La Commune était la négation absolue de l’idée de dictature, était la montée du pouvoir du peuple et, en conséquence, l’anéantissement de tout autre pouvoir en dehors et au-dessus du peuple.
« Les hommes qui pensaient, qui sentaient de cette manière, ont formé ce qui devait être appelé plus tard le groupe socialiste ou la « minorité ».
« Pour les autres, au contraire, la Commune de Paris continuait la « vieille » commune de Paris, l’ancienne commune de 1793. À leurs yeux, elle représentait la dictature au nom du peuple, la centralisation du pouvoir et la destruction des vieilles structures par la substitution, dès l’abord, des hommes : des hommes nouveaux, donc, à la tête des institutions anciennes, transformées pour l’heure en armes de guerre au service du peuple, contre les ennemis du peuple. Parmi les hommes de ce groupe autoritaire, l’idée de « l’unité et de la centralisation » n’était pas complètement disparue. S’ils acceptaient d’inscrire sur leur drapeau le principe de l’autonomie communale et de la libre fédération des groupes, c’était parce que ce principe leur était imposé par la volonté de Paris, mais certains le comptenaient mal ou à peine, ou bien y faisaient des restrictions importantes…
« Au reste, engoncés dans des habitudes contractées pendant de longues périodes de luttes et de revendications, à peine passés à l’action, ils retombaient dans la voie qu’ils avaient suivie pendant des années et des années : ils se laissaient aller, avec une bonne foi incontestable, à vouloir appliquer à une idée neuve des procédés surannés. Ils ne comprenaient pas que dans des cas de ce genre, la forme implique presque toujours le fond, et qu’en voulant installer la liberté avec des moyens autoritaires ou arbitraires, on détruisait justement ce que l’on voulait sauver ou sauvegarder.
« Ce groupe, composé par ailleurs d’éléments assez différents, avait formé la majorité, et s’intitulait « révolutionnaire jacobin[103]. »
Lénine, qui considérait comme étant bourgeoises ou petites-bourgeoises les préoccupations libertaires des adversaires de la dictature, lorsqu’il se réfère aux souvenirs de la Commune, devrait tenir compte de ce fait que justement, dans la Commune, la majorité révolutionnaire et jacobine qui avait voulu instaurer le pouvoir dictatorial et centralisé, était composée en grande partie d’éléments petits-bourgeois, sans idées socialistes, et de révolutionnaires républicains et démocrates. En revanche, la minorité antigouvernementale, fédéraliste, autonomiste et anti-dictatoriale était composée surtout d’éléments ouvriers et d’idées socialistes. Seul le petit groupe des socialistes blanquistes (et non dans sa totalité) était d’accord avec la majorité radicale et bourgeoise.
Un autre membre de la Commune, Gustave Lefrançais, de la Commission exécutive du gouvernement, en étudiant, pendant son exil, le mouvement communaliste de Paris de 1871 (durant lequel il avait joué un des rôles les plus importants), en tirait les mêmes conclusions, sans toutefois en arriver à l’anarchisme. Si nous voulions reproduire tous les témoignages des révolutionnaires de la Commune contre sa direction dictatoriale, nous devrions changer ce livre en une anthologie. Mais nous ne pouvons pas nous dispenser de citer les conclusions auxquelles était arrivé Lefrançais, par son expérience personnelle et par l’étude des faits :
« Nos amis les membres de la Commune, écrit-il justement dans le chapitre « Conclusions » qui termine son ouvrage [104], imprégnés de ce préjugé, trop généralement admis jusqu’ici, que ce n’est que par l’énorme concentration de pouvoir dont la première révolution nous a laissé l’exemple, que celle-ci a pu accomplir une partie de sa tâche, s’imaginèrent de substituer de nouveau leur action à celle de leurs électeurs, encore une fois dépouillés de leur souveraineté, et de transformer la Commune en un pouvoir dirigeant et absolu (…), sans tenir compte des résistances légitimes qu’ils devaient nécessairement rencontrer chez des partisans de la révolution communaliste qui saluaient précisément en elle la mise à néant de toutes prétentions dictatoriales…
« Une fois entrée dans la voie autoritaire où la poussèrent les excitations incessantes des agents de Versailles, non moins que ses tendances propres, la Commune était destinée à la parcourir jusqu’au bout, et, comme tous ceux qui l’y avaient précédée, à succomber sous l’excès même de sa prétention à tout diriger…
« La Commune (…) devait, repoussant toute prétention dictatoriale, laisser à la population elle-même sa puissance d’initiative révolutionnaire et n’en plus être que le bras exécuteur…
« Trop gouvernementale pour être réellement révolutionnaire ; trop révolutionnaire, par son origine, aux yeux des partisans de la légalité, pour être acceptée par ceux-ci comme un gouvernement réel, telle était l’impasse où la Commune se trouvait engagée et dont elle ne pouvait sortir qu’en revenant promptement à l’observation des principes anti-autoritaires sur lesquels doit s’édifier toute véritable démocratie !
« Pour ne pas l’avoir suffisamment compris, la Commune devait périr, et elle périt en effet. »
Les livres desquels sont extraites ces citations ne sont pas des traités théoriques ou doctrinaires, mais, au contraire, ils sont l’exposé de faits, ils relatent une véritable histoire vécue, ils représentent une mine de documents desquels sont tirées et synthétisées les conclusions que nous avons recueillies. Tandis qu’aujourd’hui elles peuvent paraître des opinions exagérées ou hétérodoxes (puisque l’expérience historique est désormais trop éloignée et que la tradition doctrinaire et jacobine, issue de la falsification bourgeoise de l’histoire de la révolution de 1789–1793 a repris pied), la conception libertaire (ou, comme on disait alors, fédéraliste) de la révolution, accueillie par une minorité après 1848, fut acceptée, au lendemain de la Commune de 1871, non seulement par ceux qui, par la suite, se dirent anarchistes, mais aussi par la quasi-totalité des révolutionnaires socialistes ou à tendance socialiste.
N’y ont fait exception que les communistes doctrinaires allemands et le petit groupe des blanquistes français. On a déjà nommé Arthur Arnould et Gustave Lefrançais qui n’étaient pas anarchistes. Mais sous la vive impression de la deuxième et dure leçon de la défaite communaliste, ils étaient d’accord pour considérer une direction autoritaire et dictatoriale fatale pour la révolution, ainsi que tant d’autres qui oublièrent par la suite, du moins en partie, les enseignements de B. Malon, Paul Brousse, Jules Guesde, César De Paepe, Andrea Costa, etc.
Pour ne pas ennuyer les lecteurs par des citations excessives, nous ne reproduirons ici ni les invocations anarchistes de De Paepe, ni les invectives et les critiques à l’État de Brousse ou de Guesde, qui ont été publiées au cours de la décade qui a suivi la Commune de Paris.
L’expérience révolutionnaire de toutes les révolutions précédentes nous a enseigné que la révolution doit être anti-étatique, contraire (ainsi que disait Bovio) non seulement à telle ou telle forme d’État, mais à l’État tout entier. Elle doit tendre à abattre l’État actuel, non pas pour lui en substituer un autre, mais pour l’éliminer complètement.
En 1877, sixième anniversaire de la Commune de Paris, Andrea Costa répétait que la meilleure leçon à tirer de l’insurrection communaliste de 1871 et de sa défaite était la constatation que « la révolution populaire et sociale ne peut être qu’anarchiste, et que, chaque fois qu’on veut lui superposer un État, elle est déjà perdue [105] ».
Pour des révolutionnaires, quel meilleur enseignement pourrait-il y avoir, sinon celui qui émane de la révolution elle-même ? Quelle meilleure école expérimentale que celle-ci ?
Le courant anarchiste de la première Internationale était né justement de cette école expérimentale de la réalité, et du germe jeté par le long apostolat proudhonien. Ce courant de la pensée socialiste, dont Bakounine fut le plus éloquent des interprètes, a prévalu de 1870 jusque vers 1890 dans les pays latins, en Autriche, en partie en Angleterre, et en Hollande. Ensuite, hélas !, peu à peu ce fut au tour du socialisme autoritaire et étatique allemand, plus ou moins improprement défini comme marxisme, de prendre le dessus un peu partout (sauf toutefois en Espagne). Il se transforma par la suite en collectivisme centralisateur, légaliste et parlementaire, contre lequel les anarchistes, devenus minoritaires, polémiquèrent continuellement au cours de ces quarante dernières années.
Le concept socialiste autoritaire eut le dessus, grâce surtout aux mérites ( ?) de la social-démocratie allemande qui, avec de plus en plus de succès, propagea dans la deuxième Internationale, l’idée absurde de l’« État populaire ». Ses fractions les plus avancées parlaient de « dictature prolétarienne », selon une phrase attribuée à Marx. Mais le concept dominant était toujours celui d’un gouvernement central, du pouvoir public dont il faut s’emparer, soit par évolution soit par révolution, afin de donner au prolétariat, d’en haut et par la force, la liberté politique et économique. Le prestige néfaste dont jouissait l’Allemagne impériale, victorieuse par les armes de la France, parmi les classes bourgeoises de toute l’Europe, étendit son ombre illusoire et triste même sur le socialisme allemand, et la direction doctrinaire et tactique de celui-ci finit par devenir le modèle pour la majorité des socialistes de tous les autres pays.
Cette direction conduisit à la faillite de la deuxième Internationale, avec la guerre européenne. Les faits donnèrent raison aux anarchistes, mais trop tard pour éviter le démantèlement de la solidarité internationale du prolétariat. Mais aujourd’hui, alors que l’Internationale cherche une voie pour se reconstituer, nombre de socialistes nous donnent raison, sinon ouvertement, du moins implicitement, en acceptant maintes vérités que nous avons été les seuls à souligner jusqu’en 1914. Les critiques envers le parlementarisme, qui vont jusqu’à la négation de la lutte électorale, la reconnaissance de la nécessité de l’action directe violente et insurrectionnelle contre les pouvoirs d’État, sont là des choses affirmées aujourd’hui par de nombreux socialistes convertis à la révolution, surtout grâce à l’exemple russe.
Néanmoins, la majorité de ces socialistes conservent le préjugé autoritaire et étatique de la vieille « social-démocratie », c’est-à-dire l’ancienne illusion jacobine et blanquiste selon laquelle, fût-ce provisoirement, un gouvernement dans son expression la plus centralisée et autoritaire telle que la dictature, peut utilement diriger la révolution, la guider, pourvu qu’il le fasse au nom du prolétariat, pour son émancipation complète. Avant que cette erreur tragique ne porte ses fruits maléfiques et que la désillusion s’ensuive, il est du devoir des anarchistes, apôtres de la liberté, de mettre en garde le prolétariat et les socialistes contre le leurre autoritaire qui ne saurait que trahir, étouffer, diminuer n’importe quelle révolution.
En effet, l’histoire démontre que la méthode étatique et dictatoriale ne peut que léser le développement de la révolution. Ceux qui veulent vraiment le triomphe de la révolution doivent s’inspirer de la méthode libertaire et anti-étatique. Ils doivent s’y préparer, préparer leur propagande en ce sens, et s’en inspirer dès le premier moment et les premiers actes de la révolution.
Seule une révolution qui ne se sépare pas de la liberté sera à même d’obtenir ce que la révolution sociale propose.
Le concept anarchiste de la révolution
En Europe latine tout au moins, et plus spécialement en Italie, une révolution qui ne tiendrait pas compte de l’élément anarchiste, et croirait qu’il lui est possible de se développer indépendamment de lui ou contre lui, irait au-devant des plus graves dangers, et avant tout, celui de la guerre civile au sein de la révolution elle-même, suscitant une révolution dans la révolution, avant même que toute possibilité de contre-révolution ait disparu.
Il faut songer qu’en Italie, les anarchistes disposent désormais d’une force numérique non négligeable [106], d’une influence et d’un impact reconnus par tous et qui ne pourraient que se multiplier en période révolutionnaire.
Il s’agit d’une force révolutionnaire, et non pas de cartes ou de bulletins électoraux. Ceux qui pensent sérieusement à une révolution doivent en tenir compte non pas comme d’un poids mort, qui serait exploité en temps voulu, mais d’une force consciente qui a une direction à suivre et une volonté d’action bien déterminée. Vouloir se heurter à cette force pourrait être nuisible, non seulement pour les parties en désaccord, mais aussi et surtout pour la cause de la révolution.
Il ne s’agit pas, pour les anarchistes, d’une question d’amour propre, de présomption, ou bien d’une sotte envie de se mettre en valeur. Les anarchistes ont très peu l’esprit de parti, et ils se proposent d’autres buts immédiats que le développement de leur propagande. Ils ne sont ni un parti de gouvernement ni un parti d’intérêts – à moins que l’on n’entende par « intérêt » celui du pain et de la liberté pour tous les hommes – mais ils sont seulement un parti d’idées. C’est leur faiblesse, car tout succès matériel leur est interdit et les autres, les plus rusés ou les plus forts, exploitent et utilisent les résultats partiels de leurs œuvres.
Mais, en même temps, cela représente aussi leur force car, seulement en affrontant les défaites, eux, les éternels vaincus, préparent la victoire finale, la vraie. N’ayant pas d’intérêts propres, personnels ou de groupe à faire valoir, repoussant toute prétention de domination ; aux foules parmi lesquelles ils vivent et avec lesquelles ils partagent les angoisses et les espoirs, ils ne donnent pas d’ordres auxquels elles devraient obéir, ils ne demandent rien, mais leur disent : « Votre sort sera celui que vous vous bâtirez ; le salut est en vous-mêmes, tâchez de le conquérir par vos progrès spirituels, par vos sacrifices et vos risques. Si vous le voulez, vous gagnerez. Dans la lutte, nous ne voulons être qu’une partie de vous. »
Donc, si les anarchistes font souvent appel à une entente parmi tous ceux qui travaillent pour la révolution, s’ils se soucient des éventuelles discordes en son sein, ce qui les motive, c’est uniquement le désir sincère de ne pas finir par éloigner la révolution elle-même, ou de la rendre plus difficile par une attitude intransigeante qui serait plutôt de l’intolérance, non pas envers les classes et les partis bourgeois (pour lesquels on ne sera jamais assez intransigeants), mais contre les forces et les fractions prolétaires sincèrement révolutionnaires, anticapitalistes, internationalistes et ennemies intransigeantes des institutions actuelles, comme le sont indéniablement les anarchistes.
L’intolérance de nombreux socialistes, même révolutionnaires, face à l’anarchisme, dépend en grande partie de leur ignorance absolue des idées, des buts, et des méthodes anarchistes.
Il est tout de même extraordinaire de constater que certains socialistes, parmi les plus intelligents et ouverts aux problèmes politiques et économiques, ne savent dire, lorsqu’il s’agit d’anarchisme, que des lieux communs éculés, sans aucun sens, diffusés par la pire presse bourgeoise, les affirmations les plus fantaisistes et diffamatoires, les interprétations les plus sottes. Toute la science socialiste sur l’anarchisme semble condensée dans ce vieux pamphlet, où Plekhanov, en 1893, déversait toute sa bile anti-anarchiste, sans aucun respect pour la vérité, et sans aucune honnêteté intellectuelle [107], ou encore dans le livre (célèbre de Lombroso sur les anarchistes), qui prend pour des documents véridiques les rapports de la police et des directeurs de prison, cataloguant – sait-on pourquoi ? – parmi les anarchistes, des gens qui, pour les neuf dixièmes, n’ont jamais songé à l’être.
Innombrables sont les réfutations socialistes de l’anarchisme, parues dans des journaux, des livres, des revues ; sauf quelques louables exceptions, on y réfute presque toujours des idées non anarchistes, attribuées aux anarchistes par ignorance ou par procédé polémique. Tout spécialement sur le concept de révolution, on a fait circuler de prétendues théories anarchistes si extravagantes, qu’elles portent à douter de la bonne foi de ceux qui les ont énoncées. Que d’encre a coulé pour démontrer à « ces rêveurs d’anarchistes » que la révolution ne se fait pas avec des cailloux, de vieux fusils et quelques revolvers, que les barricades ne correspondent plus aux exigences de la lutte d’aujourd’hui, que les émeutes isolées et soudaines ne suffisent pas, que les attentats individuels ne font pas seuls la révolution, que l’insurrection est une chose et la révolution en est une autre… Et ainsi de suite, avec des découvertes bizarres du même genre, en ignorant ou en faisant semblant d’ignorer que les anarchistes ont de la révolution le concept le plus exact et le plus pratique d’après la signification étymologique, historique et traditionnelle du mot.
Dans le langage politique et social, mais aussi dans le langage populaire, la révolution est un mouvement général à travers lequel un peuple ou une classe, sortant de la légalité et renversant les institutions en vigueur, casse le pacte léonin imposé par les dominateurs aux classes dominées, abat définitivement le régime politique et social auquel il était jusque-là soumis, par une série d’insurrections, de révoltes, d’émeutes, d’attentats et de luttes de toutes sortes, et enfin instaure un ordre nouveau.
La chute d’un régime se réalise d’ordinaire en un temps relativement bref, quelques jours pour la révolution de juillet qui, en 1830, avait substitué en France une dynastie à une autre, un peu plus d’un an pour la révolution italienne de 1848, six ou sept ans pour la révolution française de 1789, une douzaine d’années pour la révolution anglaise du XVIIe siècle. La révolution, c’est-à-dire la démolition de fait d’un régime politique et social préexistant, est, en substance, la conclusion d’une évolution antérieure, qui se traduit dans les faits en brisant violemment les formes sociales et le carcan politique qui ne peuvent plus la contenir. Elle s’achève par un retour à la normale dès que cesse la lutte, soit que la victoire permette à la révolution d’instaurer un nouveau régime, soit que sa défaite, partielle ou totale, restaure entièrement ou bien en partie le régime ancien, en donnant lieu à la contre-révolution.
La caractéristique principale par laquelle on peut dire que la révolution est commencée est la sortie de la légalité, la rupture de l’équilibre et de la discipline étatique, l’action impunie et victorieuse de la rue contre la loi. Avant un fait spécifique et résolutif de ce genre, il n’y a pas encore révolution. Il peut y avoir un état d’âme révolutionnaire, une préparation révolutionnaire, des conditions plus ou moins favorables à la révolution, on peut assister à des épisodes plus ou moins chanceux de révolte, à des tentatives insurrectionnelles, à des grèves violentes ou non, à des démonstrations même sanglantes, des attentats, etc., mais tant que la force reste du côté de la vieille loi et de l’ancien pouvoir, on n’est pas encore entré en révolution.
La lutte contre l’État, défenseur armé du régime, est donc la condition sine qua non de la révolution, laquelle tend à limiter au possible le pouvoir de l’État, à développer l’esprit de liberté et à pousser autant que possible le peuple, les assujettis de la veille, les exploités et les opprimés, à l’usage de toutes les libertés individuelles et collectives. Dans l’exercice de la liberté, sans la contrainte des lois et des gouvernements, réside le salut des révolutions, la garantie qu’elles ne seront ni limitées ni arrêtées dans leur progression, et leur meilleure sauvegarde contre les tentatives internes et externes de l’étranger.
Certains nous disent : « Nous comprenons qu’en tant qu’anarchistes, étant opposés à toute idée de gouvernement, vous soyez adversaires de la dictature, qui en est l’expression la plus autoritaire ; mais il ne s’agit pas de la considérer comme un but, elle n’est qu’un moyen, certes antipathique, mais nécessaire, tout comme est antipathique mais nécessaire la violence, pendant la période révolutionnaire transitoire, pour vaincre la résistance et les contre-attaques de la bourgeoisie. »
La violence est une chose, l’autorité d’un gouvernement en est une autre, dictatoriale ou pas. En effet, s’il est vrai que toutes les autorités gouvernementales font usage de la violence, il est inexact et erroné de dire que toute « violence » est un acte d’autorité, car si la première est nécessaire, la seconde le devient aussi. La violence est un moyen qui prend les caractères de la finalité pour laquelle elle est employée, de la manière dont elle est exercée et des personnes qui s’en servent. Elle est un acte d’autorité lorsqu’elle est exercée pour imposer aux autres le point de vue de ceux qui commandent, donc quand elle est une émanation gouvernementale ou patronale et sert à réduire en esclavage peuples et classes, à empêcher l’exercice des libertés individuelles des sujets, et à faire obéir par la force. En revanche, la violence libertaire est un acte de liberté et de libération, quand elle est exercée contre ceux qui commandent par ceux qui ne veulent plus obéir, lorsqu’elle est employée pour empêcher, diminuer ou détruire une quelconque forme d’esclavage, individuelle ou collective, économique ou politique, quand elle est exercée directement par les opprimés, individus, peuples ou classes contre le gouvernement ou la classe dominante. Une telle violence, c est la révolution en acte, mais elle cesse d’être libertaire, et donc révolutionnaire, dès que, l’ancien pouvoir vaincu, elle veut elle-même devenir un pouvoir et se cristallise en une quelconque forme de gouvernement.
C’est le moment le plus dangereux d’une révolution, quand la violence libertaire et révolutionnaire qui a triomphé, peut se transformer en violence autoritaire et contre-révolutionnaire, modératrice et limitative de la victoire insurrectionnelle populaire. C’est un moment pendant lequel la révolution peut se retourner contre elle-même, pour peu que les tendances jacobines et étatiques, qui, dès maintenant, se manifestent à travers le socialisme marxiste favorable à un gouvernement dictatorial, prennent le dessus.
La tâche spécifique des anarchistes, qui découle de leur conception théorique et pratique, consiste justement à réagir contre de telles tendances autoritaires et liberticides, par la propagande aujourd’hui, par l’action demain.
Ceux qui font une distinction entre anarchie théorique et anarchie pratique, pour soutenir que l’anarchie pratique ne devrait pas être anarchiste mais dictatoriale, n’ont pas bien compris l’essence de l’anarchisme. Il est impossible de séparer la théorie de la pratique, car pour les anarchistes, la théorie naît de la pratique et sert à son tour de guide dans la conduite. C’est une véritable pédagogie de l’action.
Nombreux sont ceux qui croient que l’anarchie consiste seulement en l’affirmation révolutionnaire, et en même temps idéale, d’une société sans gouvernement, à instaurer à l’avenir mais sans lien avec la réalité actuelle. D’où ils déduisent qu’aujourd’hui on puisse et on doive agir en contradiction, sans scrupule et sans limite, avec la finalité que nous proposons. Dans l’attente de l’anarchie, ils nous conseillaient, hier, de participer, provisoirement, à des élections, comme aujourd’hui ils nous proposent d’accepter, provisoirement, la dictature prétendue prolétarienne ou révolutionnaire.
Mais non ! Si nous étions anarchistes seulement par notre finalité et non dans nos moyens, notre parti serait inutile, car peuvent s’associer à la phrase de Bovio « Anarchiste est la pensée et vers l’anarchie avance l’histoire », même ceux qui militent dans d’autres partis progressistes. Ce qui nous distingue des autres partis, et non seulement en théorie mais aussi en pratique, c’est que nous n’avons pas uniquement un but anarchiste, mais aussi un mouvement anarchiste et une méthodologie anarchiste : car nous pensons que les voies à parcourir, soit pendant la période préparatoire de propagande, soit pendant la période révolutionnaire, sont les chemins de la liberté.
La fonction de l’anarchisme n’est pas tellement de prophétiser un avenir de liberté, mais plutôt de le préparer. Si tout l’anarchisme consistait dans la vision lointaine d’une société sans État, ou bien dans l’affirmation des droits individuels, ou encore dans une question purement spirituelle qui fasse abstraction de la réalité vécue et concerne seulement les consciences de chacun, il n’y aurait aucune nécessité d’un mouvement politique ou social anarchiste. Si l’anarchisme était simplement une éthique individuelle, qu’on cultiverait en soi-même, tout en s’adaptant en même temps, dans la vie matérielle, à des actes et des mouvements en contradiction avec elle, on pourrait se dire anarchistes et appartenir aux partis les plus divers. Et pourraient être considérés comme anarchistes tous ceux qui, tout en étant spirituellement et intellectuellement émancipés, sont et restent, sur le terrain pratique, nos ennemis.
Mais l’anarchisme est autre chose. Ce n’est pas une raison pour s’enfermer dans une tour d’ivoire, mais plutôt une manifestation populaire, prolétarienne et révolutionnaire, une participation active aux mouvements d’émancipation humaine, avec des critères et des finalités égalitaires et libertaires. La partie la plus importante de son programme ne consiste pas seulement dans le rêve (que nous voudrions voir réaliser) d’une société sans patrons et sans gouvernements, mais surtout dans la conception libertaire de la révolution, de la révolution contre l’État et non au moyen de l’État, dans l’application pratique de l’idée que la liberté n’est pas seulement le soleil qui réchauffera le monde nouveau de demain, mais qu’elle est aussi, et surtout, aujourd’hui même, une arme de combat contre le vieux monde. En ce sens, l’anarchie est une véritable théorie de la révolution.
La propagande d’aujourd’hui aussi bien que la révolution de demain ont et auront donc besoin, pour se développer, de la plus grande liberté possible. Mais cela n’empêche pas qu’on doive et qu’on puisse les poursuivre même si la liberté nous est un peu ou en grande partie enlevée. Mais notre intérêt est d’en avoir et d’en vouloir le plus possible. Autrement nous ne serions pas anarchistes. En d’autres termes, nous pensons que plus nous agirons de façon libertaire, plus nous pourrons contribuer, non seulement à nous approcher de l’anarchie, mais aussi à consolider la révolution. En revanche, nous nous en éloignerons et nous affaiblirons la révolution chaque fois que nous aurons recours aux méthodes autoritaires. Défendre la liberté pour nous et pour tous, combattre pour que la liberté soit toujours plus grande et complète, voilà donc notre fonction, aujourd’hui, demain, toujours, en théorie et en pratique.
« Liberté aussi pour nos ennemis ? » nous demande-t-on. La question est soit niaise, soit perfide. Nous sommes en lutte contre ces ennemis, et dans la mêlée on ne reconnaît aucune liberté à l’ennemi, même pas celle de vivre. S’il s’agissait seulement d’ennemis… théoriques, s’ils se trouvaient en face de nous sans armes et dans l’impossibilité de porter atteinte à notre liberté, dépouillés de tous privilèges, et donc à parité de condition, la chose serait inadmissible. Mais nous préoccuper de la liberté de nos ennemis, qui possèdent des centaines de quotidiens à-grand tirage, quand nous n’avons que quelques journaux et hebdomadaires, qui sont armés jusqu’aux dents contre nous qui sommes désarmés, qui sont au pouvoir tandis que nous sommes assujettis, qui sont riches alors que nous sommes pauvres, cela serait ridicule… Ce serait comme si nous reconnaissions à un assassin la liberté de nous tuer. Et une telle liberté, nous la leur refusons, nous la refuserons toujours, même en période révolutionnaire, le temps qu’ils conserveront leur condition de bourreaux, et jusqu’au moment où nous aurons conquis totalement et complètement notre liberté, non seulement en droit mais aussi de fait.
Cependant nous ne pourrons pas conquérir cette liberté si nous ne nous en servons pas aussi comme d’un moyen, là où nous pouvons le faire, en donnant, dès aujourd’hui, une orientation toujours plus libre et libertaire à notre mouvement et au mouvement prolétarien et populaire, en développant l’esprit de liberté, d’autonomie et de libre initiative au sein des masses. Il faut éduquer les masses pour qu’elles se méfient toujours plus de tout pouvoir autoritaire et politique, encourager l’esprit d’indépendance de jugement et d’action envers les chefs de toutes sortes, en habituant le peuple au mépris de toute discipline imposée d’en haut et par d’autres, qui ne soit pas celle de sa propre conscience, discipline librement choisie et acceptée et suivie le temps qu’elle sera utile aux buts libertaires et révolutionnaires que nous nous sommes fixés.
Il est évident qu’une masse éduquée à une pareille école, un mouvement qui suivrait cette direction (le mouvement anarchiste, donc), trouveront dans la révolution l’occasion et le moyen d’évoluer dans ce sens jusqu’à des limites aujourd’hui insoupçonnables. Et cela constituera l’obstacle, à la fois tout naturel et voulu, à la formation et à l’établissement d’un quelconque gouvernement plus ou moins dictatorial. Entre ce mouvement allant vers une liberté toujours plus grande et la tendance centralisatrice et dictatoriale, il ne peut y avoir que conflit, plus ou moins fort, avec des pauses plus ou moins longues suivant les circonstances ; mais un accord, jamais !
Et cela, non pas pour des causes exclusivement doctrinaires ou abstraites, mais parce que les négateurs du pouvoir (et ceci, répétons-le, est la partie la plus importante de la théorie anarchiste, qui se veut la plus pratique des théories) pensent que la révolution sans la liberté nous ramènerait à une nouvelle tyrannie ; que le gouvernement, du seul fait qu’il est tel, a tendance à arrêter et à limiter la révolution ; qu’il est dans l’intérêt de la révolution et de son développement progressif de combattre et de faire obstacle à toute centralisation de pouvoirs, d’empêcher la formation d’un gouvernement, si possible, ou tout au moins de l’empêcher de se renforcer et de prendre assise. C’est-à-dire que l’intérêt de la révolution est contraire à la tendance que porte en elle-même toute dictature, qu’elle se nomme prolétarienne ou révolutionnaire, à devenir forte, stable et solide.
D’autres répliquent qu’il s’agirait d’une dictature provisoire, jusqu’à ce que se termine l’œuvre de dépossession de la bourgeoisie, pour la combattre et pour la vaincre.
Quand on dit « dictature », on sous-entend toujours « provisoire », même dans la signification bourgeoise et historique du mot. Toutes les dictatures, dans les temps passés, ont été provisoires dans les intentions et les déclarations de leurs promoteurs. Les intentions comptent peu, dans de tels cas, car il s’agit de former un organisme complexe qui suit sa pente naturelle et ses lois, en annihilant tout a priori contraire et réducteur. Il est d’abord nécessaire d’observer si les conséquences du régime dictatorial avantagent ou non la révolution ; ensuite, il faudrait essayer d’établir si les objectifs de destruction et de reconstruction que la dictature s’est fixés ne peuvent pas aussi être atteints, et mieux sans elle, par les voies plus larges de la liberté.
Nous croyons que cela est possible et que la révolution est plus forte, plus difficile à réprimer et à vaincre lorsqu’elle n’a pas de centre où la frapper, c’est-à-dire quand elle est partout à la fois, sur tous les points du territoire, et partout où le peuple s’emploie librement à réaliser les deux principaux buts de la révolution : la destitution de l’autorité et l’expropriation des patrons.
Lorsque nous reprochons au concept dictatorial de la révolution de vouloir imposer la volonté d’une petite minorité à la grande majorité de la population, on nous répond que « les révolutions sont faites par les minorités ».
Il faut dire que cette expression n’est pas absente non plus de la littérature anarchiste ; en effet, elle traduit une grande vérité historique. Mais il faut la comprendre dans sa véritable signification révolutionnaire et non pas lui donner, ainsi que le font les bolcheviks, un sens que, jusqu’ici, elle n’avait jamais eu. Il est vrai que les révolutions sont faites par les minorités, mais jusqu’à un certain point. En réalité, les minorités mettent en route les révolutions, prennent l’initiative de l’action, enfoncent la première porte, abattent les premiers obstacles ; en un mot, elles savent oser ce que les majorités, inertes et peureuses, craignent, compte tenu de leur amour pour une existence tranquille, et à cause de leur peur des risques.
Mais les premiers obstacles abattus, si la majorité du peuple ne suit pas la minorité audacieuse, l’action menée sera soit suivie de la réaction de l’ancien régime qui prendra sa revanche, soit elle aboutira à la substitution d’une domination par une autre, d’un privilège par un autre. Il est nécessaire, en d’autres termes, que la minorité rebelle soit soutenue, plus ou moins, par le consentement de la majorité et sache en interpréter les besoins et les sentiments latents. La première bataille gagnée, il faut que cette minorité réalise les aspirations populaires, qu’elle laisse aux masses la liberté de s organiser à leur manière, et devienne, en quelque sorte, la majorité.
Mais si cela n’a pas lieu, nous pensons que la minorité a quand même le droit à la révolte. Selon le concept anarchiste de la liberté, tous les opprimés ont le droit de se révolter contre l’oppression, l’individu tout comme la collectivité, les majorités ainsi que les minorités. Mais la révolte contre l’oppression est une chose, devenir oppresseur à son tour en est une autre, comme nous l’avons dit plusieurs fois. Même lorsque les majorités tolèrent l’oppression et s’en font les complices, la minorité qui se sent opprimée a le droit de se rebeller, de vouloir pour elle la liberté. Et les majorités en auraient d autant plus le droit, si une quelconque minorité, sous un quelconque prétexte, prétendait les subjuguer.
Au reste, dans les faits, les oppresseurs sont toujours une minorité, qu’ils exercent leur oppression en leur nom propre, ouvertement, ou qu’ils l’exercent au nom d’hypothétiques collectivités ou majorités. A ses débuts, donc, la révolte est suscitée par une minorité consciente qui s’insurge au milieu d’une majorité opprimée, et dirigée contre une autre minorité tyrannique. Mais la révolte devenue révolution peut être efficace, rénovatrice et libératrice à condition que, par son exemple, elle puisse secouer la majorité, l’entraîner, la mettre en route, en conquérir la faveur et l’adhésion.
Si elle est abandonnée par la majorité populaire, la révolte sera matée et passera à l’histoire comme un mouvement héroïque et malheureux, précurseur, étape sanglante mais nécessaire sur la voie d’une future et inéluctable victoire. Mais si, victorieuse, la minorité rebelle devient maîtresse du pouvoir en dépit de la majorité, nouveau joug sur le cou du peuple, elle finira par détruire cette révolution suscitée par elle-même.
Dans un certain sens, on pourrait dire que si une minorité rebelle n’arrivait pas, par son élan, à entraîner avec elle la majorité des opprimés, elle serait plus utile à la révolution battue et sacrifiée. Car si, à la suite d’une victoire, elle parvenait à devenir elle-même un facteur d’oppression, elle finirait par étouffer dans les masses la foi en la révolution. Il se pourrait même qu’à la suite d’une telle attitude, les masses parviennent à haïr la révolution dans laquelle elles ne verraient qu’une nouvelle tyrannie, dont elles sentiraient le poids et le danger, quel que soit le prétexte ou le titre sous lequel la révolution serait présentée.
Après la révolution russe tout spécialement, on a avancé l’idée du pouvoir dictatorial de la révolution, comme un nécessaire moyen de lutte contre les ennemis intérieurs et contre les tentatives des ‘ex-dominateurs voulant reconquérir le pouvoir économique et politique. Autrement dit, le gouvernement servirait à organiser, aux premiers moments d’un plus grand danger, le terrorisme antibourgeois pour défendre la révolution[108].
Nous ne nions point la nécessité de faire usage de la terreur, spécialement lorsque, aux ennemis internes viennent en aide, avec des forces armées, des ennemis externes. Le terrorisme révolutionnaire est une conséquence inévitable lorsque le territoire, où la révolution ne s’est pas encore suffisamment renforcée, est envahi par des années réactionnaires. Toute menace de contre-révolution de l’intérieur est trop funeste, dans de pareilles circonstances, pour ne pas mériter d’être exterminée par le fer et par le feu.
La légende de Brutus qui envoie à la mort ses propres fils, complices des Tarquins chassés de Rome et qui menacent la liberté romaine à la tête d’une armée étrangère, est le symbole de cette tragique nécessité de la terreur. Ainsi en France, on a senti le besoin, en 1792, d’exterminer les nobles, le clergé et les réactionnaires détenus dans les prisons, quand Brunswick, guidé par les émigrés, s’approchait dangereusement de Paris.
La terreur devient inévitable lorsque la révolution est encerclée de tous côtés. Sans la menace extérieure, les menaces contre-révolutionnaires de l’intérieur ne font pas peur ; il suffit, pour les rendre inactifs, de la vision de leur impuissance matérielle. Ne pas s’en inquiéter peut aussi être une erreur et peut-être un danger pour 1 avenir, mais ne constitue pas un danger immédiat. On pourrait donc même éprouver pour les ennemis un sentiment de générosité et de pitié, mais lorsque ces ennemis peuvent disposer au-delà des frontières de forces armées prêtes à intervenir à leur secours, quand ils trouvent des alliés parmi les ennemis de l’extérieur, alors ils deviennent un danger d’autant plus grand que les ennemis de l’extérieur s’approchent. Leur suppression devient alors une question de vie ou de’ mort.
Plus la révolution est inexorable en ces occasions, plus elle évite des deuils pour l’avenir. La tolérance excessive d’aujourd’hui pourrait rendre obligatoire demain une rigueur doublement grave[109]. Et si la tolérance avait comme conséquence la défaite de la révolution, la terreur blanche et la contre-révolution sanctionnerait cette défaite par des punitions terribles.
Et puis il ne faut pas accorder trop de valeur à la rhétorique pompeuse de la bourgeoisie, quand elle s’en sert pour vitupérer et calomnier le terrorisme révolutionnaire.
Depuis quatre ans, tout le monde parle des horreurs, des carnages, des infamies, des désordres révolutionnaires de Pétrograd et de Moscou. Mais si on avait la patiente de rechercher dans les archives de la presse de Rome, Turin, Vienne, Coblence, Londres et Madrid depuis 1789 jusqu’à 1815, on y lirait des phrases identiques sur l’horreur des carnages, des infamies et des désordres de la révolution française, que pourtant tout le monde aujourd’hui appelle « la grande révolution ». Ceux, qui se rappellent les temps de la Commune de Paris de 1871, se souviennent aussi avec quel langage on dépeignait les « carnages » des « incendiaires » communards. Il n’y avait pas assez de mots blessants pour les vitupérer et les traiter d’assassins. Malgré cela, combien d’apologistes de la Commune de Paris sont aujourd’hui parmi les détracteurs de la Commune de Moscou !
Les patriotes italiens, s’ils sont sincères, peuvent se rappeler les infamies que l’on écrivit dans les journaux modérés et bonapartistes parisiens (en accord avec les journaux cléricaux de Vienne) contre la république romaine de 1849. En ce temps-là aussi, les âmes pieuses étaient scandalisées et remplies d’horreur devant les massacres attribués aux carbonari et aux mazziniens. Un jour, on apprendra également la vérité sur la révolution russe et il se pourrait que beaucoup de ses détracteurs d’aujourd’hui se rétractent. Alors, probablement, les seuls qui persisteront dans la critique seront… les anarchistes.
La bourgeoisie n’a pas le droit de se scandaliser du terrorisme de la révolution russe. Au cours de ses révolutions, elle en a fait autant, et, par la suite, a usé de la terreur à son avantage contre le peuple, chaque fois que celui-ci a essayé de secouer sérieusement son joug, et avec une férocité jamais atteinte en aucune autre révolution.
En tant qu’anarchistes, cependant, nous faisons toutes nos réserves, non pas contre l’emploi de la terreur en général, mais contre le terrorisme codifié, légalisé, devenu un instrument de gouvernement, que ce dernier se dise ou se croie révolutionnaire. En effet, le terrorisme autoritaire, par le seul fait d’être tel, cesse d’être révolutionnaire, devient une menace constante pour la révolution, et même une source de faiblesses. La violence trouve seulement dans la lutte et dans la nécessité d’abattre une oppression sa justification véritable, mais sa légalisation en violence gouvernementale est déjà un nouvel abus, une nouvelle oppression.
C’est donc une source de faiblesses pour le terrorisme révolutionnaire que d’être exercé non pas librement par le peuple (et contre ses ennemis seulement) ou par l’initiative indépendante des groupes révolutionnaires, mais par un gouvernement. En conséquence, le gouvernement persécute, en plus des véritables ennemis de la révolution, des révolutionnaires sincères, plus avancés que lui-même, mais en désaccord avec lui. En outre, le terrorisme en tant qu’acte d’autorité gouvernementale est plus susceptible de s’attirer l’antipathie et l’aversion populaires, qui se déterminent toujours en opposition au gouvernement quel qu’il soit, et pour la seule raison qu’il est gouvernement. Un gouvernement, même quand il a recours à des mesures radicales, à cause de ses responsabilités et des pressions qu’il subit de l’intérieur ou de l’extérieur, est inévitablement porté à faire preuve de plus ou moins de violence ou de clémence, plutôt par la nécessité de défendre son pouvoir et sa sécurité présente ou futures (ou même la simple renommée de ses composantes), que par l’intérêt du peuple et de la révolution.
Pour se débarrasser partout de la bourgeoisie, pour prendre des mesures sommaires qui peuvent être nécessaires à une révolution, il n’est pas besoin d’ordres d’en haut. Au contraire, ceux qui sont au pouvoir pourraient, par un sens assez naturel des responsabilités, avoir des hésitations et des scrupules dangereux, que les masses n’ont pas. L’action directe populaire (que l’on pourrait appeler terrorisme libertaire) est donc toujours plus radicale, sans compter que, localement, on sait mieux qui et où frapper qu’un pouvoir central éloigné, contraint à s’en remettre à des tribunaux, toujours plus injustes et en même temps plus féroces que la justice sommaire populaire. Ces tribunaux, même quand ils accomplissent des actes de véritable justice, ne frappent pas par sentiment, mais par mandat. Par leur froideur, ils deviennent antipathiques au peuple et sont portés à présenter leurs actes de cruauté (même nécessaires) avec une théâtralité inutile et une hypocrite ostentation d’une égalité législative inexistante et impossible.
Dans toutes les révolutions, dès que la justice populaire devient légale et organisée d’en haut, elle se transforme peu à peu en injustice. Elle devient peut-être plus cruelle, mais elle est portée aussi à frapper des révolutionnaires eux-mêmes, à souvent épargner les ennemis, et à devenir l’instrument du pouvoir central en un sens toujours plus répressif et contre-révolutionnaire. Donc, non seulement on peut se passer du pouvoir dans la révolution en tant qu’instrument de violence destructive, mais la violence elle-même est d’autant plus efficace et radicale qu’elle est moins concentrée en une autorité déterminée.
A ceux qui, contre nos arguments, opposent tout ce qui arrive en Russie, nous répondrons que là-bas l’expérience est toujours en cours, et qu’il est encore trop tôt pour se fonder sur celle-ci comme si elle était une preuve véridique. On fait état des décrets émanant du gouvernement des soviets ; mais pour comprendre s’ils sont bons, il faudrait savoir si, comment et jusqu’à quel point ils ont été appliqués, connaître leurs résultats, etc. Pour conclure que là-bas tout à été bien fait, il faudrait que l’expérience soit terminée, par la victoire ou par la défaite, de façon à savoir et comprendre si la dictature a aidé ou bien a fait obstacle davantage à l’une ou à l’autre. Pouvons-nous aujourd’hui, nous et les partisans de la dictature révolutionnaire, exclure que l’une des causes des terribles conditions dans lesquelles se débat la révolution russe provient justement de son attitude excessivement autoritaire et dictatoriale ? Certes, non !
Dans un chapitre précédent, nous avons examiné, avec la plus grande objectivité qu’il soit donné d’avoir à des hommes passionnés parce que partisans, les conditions créées en Russie par la dictature, par rapport aux intérêts de la liberté. Et de ce côté, les conclusions que l’on peut en tirer ne sont certes pas encourageantes. Mais notre but n’est pas de juger, ni de faire de la critique historique comme fin en soi ; mais plutôt d’examiner les idées et les faits en tenant compte de ce que pourrait être la révolution dans nos pays. Nous voulons bien admettre qu’en Russie les choses ne pouvaient pas se passer autrement et que l’on ne pouvait pas faire autrement que comme on a fait, mais il est certain que, dans les pays occidentaux, les choses ne pourraient se dérouler de la même façon qu’en Russie.
Nos considérations ont surtout une valeur, ici où nous vivons, en tant que normes et guides d’une éventuelle révolution, plus ou moins proche. Par conséquent, nous avons le devoir de ne pas imiter aveuglément ce que l’on dit, ce que l’on imagine de ce qui se passe en Russie, ou ailleurs ; mais de préparer positivement le terrain de « notre » révolution, en tenant compte de ce qu’il convient ou ne convient pas pour son triomphe, étant donné « nos » conditions, les moyens dont nous disposons et les buts que nous nous proposons pour « notre » révolution ici, dans « notre » milieu, avec « nos » sentiments et « nos » idées.
Ceux qui citent si souvent Lénine devraient à ce propos se rappeler le conseil honnête qu’il donna aux révolutionnaires hongrois, au moment de leur malheureuse révolution : essayer de ne pas singer ce qui avait été fait en Russie, car là-bas on avait commis des erreurs qu’il fallait éviter, et ce qui pouvait être utile, nécessaire ou inévitable en Russie, pouvait être au contraire chose à éviter ou nocive, ailleurs. Le conseil de Lénine est valable pour les révolutionnaires de tous les pays, les révolutionnaires italiens y compris.
Révolution et expropriation
La révolution provoquera un état de choses qui sera le résultat du libre exercice des forces populaires au sein de la révolution elle-même et de la volonté du prolétariat qui, libéré du joug patronal et gouvernemental, pourra se réorganiser comme il l’entend. Les organismes nouveaux qui se seront formés pour pourvoir aux nécessités de la vie sociale, les divers groupements petits ou grands, locaux ou régionaux, nationaux ou internationaux, créés selon les besoins et les nécessités, seront ensuite ce que leurs composants voudront bien qu’ils soient.
L’important est, afin que la révolution n’ait pas été faite inutilement, que plus personne ne profite du travail d’autrui, que personne ne soit plus contraint à travailler pour les autres, que les uns ne soient pas obligés, par la force, à subir une forme d’organisation imposée par d’autres, que les différents groupements soient libres de déployer leurs activités dans l’optique du bien collectif (c’est-à-dire de façon à ce que personne ne soit lésé) et de coopérer avec ceux qui ont les mêmes buts ou une quelconque nécessité commune à satisfaire.
Une fois le prolétariat débarrassé de ses dominateurs politiques et économiques, ce serait la plus grande des erreurs de vouloir lui imposer contre sa volonté un type d’organisation sociale qui, aussi parfaite soit-elle idéalement, perdra toutes ses vertus de par le fait même qu’elle sera imposée par la force. Une contrainte violente, par un gouvernement central et dictatorial, pourra avoir la réussite momentanée et apparente de toutes les choses faites par la force.
Mais quand la violence des dictateurs se sera naturellement épuisée, la révolte longtemps comprimée éclatera et les gouvernants s’apercevront, pour leur malheur, qu’ils ont contribué à faire haïr par les masses l’idéal au nom duquel ils avaient exercé l’autorité et la violence.
L’une des raisons invoquées par les socialistes en faveur de la dictature est que, pendant et après la révolution, on aura besoin d’une période de « gouvernement fort » prolétarien pour mener à bien l’expropriation des capitalistes :
« Conquérons le pouvoir par la révolution et par le truchement des pouvoirs publics, formés par élection ou par insurrection par des prolétaires seuls, pendant une période plus ou moins longue de l’ordre de quelques années, nous procéderons graduellement à l’expropriation légale de la bourgeoisie. Il y aura toujours des bourgeois non expropriés, et il y aura encore deux classes : la classe du prolétariat, dominante, et la classe bourgeoise, dominée et en voie d’élimination graduelle [110]. »
Ceux qui voient les choses de cette façon conçoivent encore la révolution selon l’ancien sens politique, c’est-à-dire qu’ils veulent une révolution politique. Et comme ils pensent que par la suite ce seront les socialistes qui monteront au pouvoir, ils imaginent que ceux-ci réaliseront la révolution sociale par le truchement du gouvernement. C’est une des formes du socialisme utopique que F. Engels critiquait déjà en 1878 au cours de sa polémique avec Dühring. Il démontrait que « la force économique étant la cause première du pouvoir politique », celui-ci ne pouvait rester aux mains du prolétariat si le prolétariat ne transformait pas « avant tout » les instruments de la production en propriété de l’État, autrement dit s’il ne procédait pas d’abord à l’expropriation.
Les anarchistes, on le sait, entendent réaliser l’expropriation d’une autre façon et nous avons déjà dit quelle conception différente nous avons des rapports entre État et capitalisme. Les instruments de la production devraient passer directement aux mains des travailleurs et à leurs organismes de production. En outre, nous pensons que le pouvoir politique n’est pas seulement l’effet de la force économique, mais l’un et l’autre sont à tour de rôle cause et effet. De cela, nous nous sommes déjà occupés précédemment.
Mais, même sans prendre en considération la conception anarchiste, et en suivant les idées généralement admises par les socialistes, spécialement par les marxistes, il nous semble que l’opinion de ceux qui veulent soustraire à l’action insurrectionnelle des masses la tâche d’expropriation pour la confier à un gouvernement révolutionnaire ou post-révolutionnaire, est radicalement fausse.
Nous ne croyons pas aux vertus reconstructives et organisatrices de l’État et c’est pourquoi nous sommes anarchistes, mais ceux qui ne le sont pas aussi, même s’ils estiment qu’une force étatique est nécessaire pour maintenir la cohésion du corps social, s’ils sont socialistes et marxistes de surcroît, ne peuvent admettre la possibilité d’un État prolétarien et socialiste alors que le patronat demeure, c’est-à-dire pendant que le prolétariat reste toujours exploité et économiquement dominé par la bourgeoisie.
Comment se pourrait-il que le prolétariat devienne une classe politiquement dominante tout en restant dans le même temps économiquement assujetti ? Ce serait une erreur très grave de se laisser influencer par l’exemple russe car il faut se rendre compte que les socialistes, en Russie, non seulement peuvent se tromper, mais ils peuvent aussi, sous la contrainte de certaines circonstances, accomplir ce qu’ils déconseilleraient formellement en d’autres circonstances. La Russie, de plus, est un monde essentiellement différent de l’Europe occidentale.
Si le prolétariat, ou bien une minorité consciente en son nom, réussit à abattre le gouvernement central bourgeois par la révolution, et ne profite pas immédiatement de l’absence des chiens de garde pour exproprier la bourgeoisie sur tous les points du territoire, si l’action des grandes masses ne converge pas immédiatement dans la lutte à côté des minorités qui ont ouvert le chemin, de façon à ce que les propriétaires puissent prendre en main la gestion de la propriété, il est assez facile de prévoir ce qu’il adviendra de la révolution, même sans être des prophètes. Il en serait de même si on laissait les bourgeois toujours propriétaires de la richesse, en se contentant de devenir des dirigeants, ou plutôt de les nommer en se réservant des privilèges dans le droit de vote.
Passé le premier moment des tumultes, le gouvernement sera à nouveau politiquement déterminé par le facteur économique. Cette prévision est tout à fait marxiste mais elle n’en est pas moins juste. Que le gouvernement se dise, ou bien qu’il l’ait été réellement, socialiste ou prolétarien, cela n’aura guère d’importance. Pour pouvoir se maintenir au pouvoir, il sera obligé de se faire l’expression plus ou moins dissimulée de la classe restée économiquement privilégiée. Et si la majorité des travailleurs reste encore sous la dépendance économique de la bourgeoisie, lorsqu’il faudra élire les représentants une grande partie le seront d’après les vœux de la bourgeoisie… tout comme aujourd’hui. Aujourd’hui, les bourgeois votent eux aussi, mais leurs suffrages à eux seuls ne pourraient pas constituer une majorité parlementaire, et si la majorité parlementaire est bourgeoise c’est parce que la majorité des prolétaires vote pour ses exploiteurs. Si, après la révolution, les patrons restent patrons, le suffrage universel prolétarien servira, au plus, à créer une nouvelle forme de politicaillerie et de bureaucratie, sorte d’intermédiaire entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise qui, comme tous les intermédiaires, finira, sous des aspects rénovés, par servir l’intérêt de la classe économiquement la plus forte.
L’existence d’un gouvernement au lendemain d’une révolution jusqu’à son abolition, représente un danger pour la révolution elle-même. Cependant le danger sera doublé si, à ses côtés, serait-ce formellement d’une manière hostile continue à exister le privilège économique. Les deux privilèges du pouvoir et de la richesse finiront tôt ou tard par se mettre d’accord aux dépens des masses populaires, et les fruits de la révolution seront à coup sûr décimés. Le gouvernement, en se disant socialiste, n’échappera pas aux lois de sa nature. Les privilégiés changeront les formes de privilèges, les divisions de classes ; il y aura des déplacements de richesses, mais l’État toujours présent en tant que source de privilèges politiques aura toujours tendance à faire les intérêts de la classe qui bénéficie des privilèges économiques, et donc à conserver ces derniers en abolissant les rameaux desséchés mais en en favorisant la perpétuelle reproduction.
Pour empêcher cela, même selon la conception marxiste qui confie à l’État une activité de reconstruction et d’organisation, en laissant la tâche destructive à la révolution, il faut absolument dès le premier moment de la révolution réaliser une expropriation radicale.
Cela est d’autant plus nécessaire que nous autres anarchistes avons toutes les raisons de craindre que le nouvel État issu éventuellement de la révolution, si l’énorme force constituée par la richesse est laissée aux mains de la bourgeoisie, ne finisse par s’appuyer sur celle-ci afin de la contenir et de se conserver.
Malatesta disait que ceux qui ont le pouvoir sur les choses ont aussi le pouvoir sur les personnes. La bourgeoisie restée maîtresse de la propriété pour une période plus ou moins longue aura tout le temps nécessaire pour se ressaisir et obtenir à nouveau la maîtrise de l’autorité politique.
Nier la fonction expropriatrice de la révolution, entendue comme un acte déterminant qui brise les résistances politiques et armées de la bourgeoisie, est inconcevable et inconciliable avec le triomphe de la révolution elle-même, et peut-être par chance elle est impossible à éviter.
Le peuple, le prolétariat, ne conçoit la révolution que comme un acte d’expropriation. Si on lui dit : « laissez la richesse aux seigneurs, envoyez-nous au gouvernement et nous nous chargerons de vous la rendre petit à petit », on va nous rire au nez et on nous dira que le peuple n’aime point se faire trouer la peau dans les tranchées de la révolution pour nos beaux yeux ! Pour que les grandes masses soient dès les premiers moments intéressées à la cause de la révolution, il est nécessaire qu’elle ait, tout de suite, un contenu, une finalité, un but économique pratique et immédiat.
Si l’on confiait au seul pouvoir central révolutionnaire le soin de l’expropriation, il y aurait aussi le risque que les grandes masses éloignées des centres urbains perdent tout intérêt à la révolution et peu à peu leur enthousiasme, se laissant gagner à la réaction par d’autres motifs ou prétextes suggérés par les traditions et les superstitions du passé.
Il faut que dans chaque ville, chaque village ou pays, ainsi qu’à la campagne, la résistance du pouvoir politique vaincue, le prolétariat soit immédiatement appelé à prendre possession localement de la propriété foncière, industrielle, bancaire, terrienne, etc., et fasse un grand feu de joie de tous les titres de propriété, des archives de cadastre, celles des notaires, etc.
De nombreux bourgeois – c’est naturel – « disparaîtront » de différentes manières au premier moment du conflit. Il ne faut pas exclure, en plus de l’expropriation, l’utilisation par les prolétaires de la « séquestration de personnes » temporaire envers les rescapés, soit comme otages, soit parce qu’on peut avoir besoin d’eux dans le but de poursuivre techniquement la production. La manière de procéder peut-être discutée mais ce qui importe c’est d’être d’accord sur le principe général que l’expropriation doit être effectuée dès le premier moment de la révolution, et sur tout le reste il sera facile de s’entendre. Il ne manque pas, à cet effet, d’organismes prolétariens nécessaires – groupes locaux, organisations, syndicats prolétariens et corporatifs, comités ou conseils d’ouvriers, dans chaque commune, province ou région – à travers et au moyen desquels e prolétariat exercera par son action directe, sa force d’expropria-ion, sans en confier le soin à un gouvernement central, prolétarien le nom, mais composé en fait de quelques personnes d’un seul parti.
Nous ne comprenons pas comment il est possible de nier cela jusqu’au point de lui préférer l’action problématique d’un État. Pourtant nous ne sommes pas les seuls à voir une telle possibilité, des socialistes aussi la voient, y compris (comme cela nous a été rapporté) une partie des bolcheviks russes, qui justement pour cela se nomment, ou sont appelés « immédiatistes ».
Plus que possible, l’expropriation dès le premier moment de la révolution est peut-être inévitable. L’expropriation, c’est-à-dire la prise de possession des usines, des établissements, des instruments de travail de toutes sortes et de tous les produits accumulés, est même une des formes par lesquelles la révolution commencera. Cela pourrait même, en quelque sorte, précéder en partie l’insurrection. Après l’occupation ouvrière des usines métallurgiques italiennes, en septembre 1920, il est facile de prévoir que tout mouvement prolétarien un peu sérieux, tout mouvement du peuple, sera désormais accompagné, précédé ou provoqué par des tentatives semblables de prise de possession de la propriété des capitalistes.
Il serait bon de rappeler, d’ailleurs, que même avant l’idée des occupations d’usines, une formule commune aux socialistes, aux syndicalistes, aux anarchistes, et en règle générale à la classe ouvrière aux tendances les plus avancées, était celle de « la grève générale expropriatrice ».
Tout cela démontre combien est erronée l’espèce de fatalisme de certains socialistes « maximalistes » lorsqu’ils croient qu’il est « impossible d’exproprier la bourgeoisie dès les premiers actes révolutionnaires ». Nous avons relevé ces phrases un peu partout dans la presse de tendance bolchevique, mais nous avons cherché en vain des arguments concrets qui démontrent cette prétendue impossibilité, en dehors des affirmations indémontrables et des a priori habituels.
Est-il vraiment si difficile que cela, pour les ouvriers, de continuer le travail pour leur propre compte, après avoir chassé les patrons ? Pourtant, il y a déjà des ouvriers dans les usines, des locataires dans les maisons, des paysans sur les terres ! Et même s’il fallait procéder directement à l’occupation, une fois vaincue la résistance armée gouvernementale, cela ne demanderait qu’un effort minime. Alors, pourquoi donc confier le soin de l’expropriation à un gouvernement dictatorial central, qui compliquerait les choses et en aurait pour un temps infini ?
En laissant de côté le problème de l’utilité ou de l’inutilité de l’État dans une société socialiste (car la question, tout en étant liée, est différente et peut même se résoudre d’elle-même), et de l’intérêt qu’il y aurait à s’en rendre maître plutôt que de le combattre, considérons plutôt la question de la possibilité historique, sociale et technique de la part du prolétariat, à commencer dès le premier moment de la révolution, par l’expropriation.
Même ceux qui appuient leur opinion sur le Manifeste des communistes de 1847, ont tort. Quitte à nous faire taxer de marxistes (comme il nous a été dit de même que Plekanoff le disait de Bakounine), nous soutenons le concept essentiellement marxiste selon lequel le gouvernement est toujours l’expression de la classe économique la plus forte, son complice et son allié. En admettant que l’État puisse subsister après la révolution, si les bourgeois n’ont pas été expropriés c’est-à-dire économiquement affaiblis pendant la période insurrectionnelle, en très peu de temps ils se retrouveront aussi fort qu’avant politiquement. Le gouvernement donc, peut-être sous un nom et avec des apparences socialistes, ou bien en faisant un peu de place à quelques nouveaux arrivants, redeviendra de fait un gouvernement bourgeois.
Rien dans le Manifeste des communistes ne démontre une opinion contraire à la nôtre. Vers la fin du second chapitre, il est fait mention de « l’intervention despotique du prolétariat au moyen de la domination politique dans laquelle il centralisera tous les instruments de la production, dans le droit de propriété et dans les rapports de la production bourgeoise ». Ce concept est assez discutable du point de vue anarchiste, mais il n’est pas du tout inconciliable avec l’expropriation dès les premiers moments de la période insurrectionnelle, c’est-à-dire au moment même de la chute du gouvernement bourgeois ou Bien immédiatement après. Nous ne croyons pas, il va de soi, à la possibilité d’une « socialisation instantanée », car l’insurrection elle-même ne pourrait, ni ne saurait, être instantanée. Et en plus, nous parlons ici de l’expropriation en tant qu’acte matériel qui consiste à enlever la richesse aux patrons, et non du processus de l’organisation socialiste qui nécessitera beaucoup plus de temps. Encore que l’espace d’une génération imaginée par le bolchevique russe Radek nous semble excessif.
Pour en revenir à Marx, nous ajouterons que cette fin du second chapitre, qui apparemment seulement semble exprimer un concept dictatorial, remonte à 1847. Engels et Marx eux-mêmes donnaient dans une préface de 1872 cet avertissement : « Les applications pratiques du principe général dépendent, en chaque lieu et à chaque époque, des conditions historiques du moment. » Il ne faut donc pas accorder une importance excessive aux propositions révolutionnaires de la fin du chapitre II, qui pourrait être différent à plus d’un titre.
Un peu plus loin, ils avertissent qu’« il ne suffit pas, ainsi que la Commune l’a démontré, que la classe des travailleurs prenne possession de la machine de l’État tel qu’elle est, pour la faire tourner selon ses propres but[111] ».
Nous ne pensons pas les contredire mais les compléter en ajoutant qu’il faut aussi prendre possession de la richesse sociale, des engrenages de la production et de la consommation, et cela dès les premiers moments, mis à part le fait, bien sûr, que pour nous la machine étatique doit être détruite et non pas à conquérir.
Karl Radek avait écrit que « la dictature est la forme de domination par laquelle une classe impose ses volontés à une autre classe, durement et sans égards ». Or, nous pensons qu’il n’y a aucun besoin de dictature pour agir sans égards contre la bourgeoisie, et il nous semblerait que, dictature ou pas, soit par action gouvernementale soit par action directe du prolétariat, la meilleure façon d’agir « sans égards » aux dépens du capitalisme est celle de commencer l’expropriation dès les premiers moments de la révolution. Mais Radek continue : « la révolution socialiste est un long processus qui commence par le détrônement de la classe capitaliste, mais qui se termine seulement par la transformation de l’économie capitaliste en économie socialiste, en république coopérative ouvrière. Ce processus demandera, au minimum, une génération de dictature prolétarienne [112] ». Laissons de côté la question de la dictature car, même en admettant cette forme de gouvernement, reste toujours à régler la question de l’expropriation insurrectionnelle de la bourgeoisie, et on comprendra que le « long processus » auquel fait allusion Radek n’est autre que toute la complexité de la révolution socialiste, et non pas le seul fait matériel de l’expropriation. Et si ce processus doit commencer par le « détrônement de la classe capitaliste » nous nous trouvons parfaitement d’accord. Mais nous soutenons qu’il est impossible de « détrôner » une classe en la privant du seul pouvoir politique, c’est-à-dire sans lui enlever auparavant l’arme formidable de la richesse.
Une insurrection victorieuse peut chasser les bourgeois du gouvernement et y installer des ouvriers (ou bien leurs avocats, ce qui est plus probable). Mais si pendant cette insurrection réussie les bourgeois ne sont pas expropriés, et si l’on attend pour cela que la chose soit réalisée plus tard par le gouvernement avec ses lois, ses décrets,
etc., on se montrerait vraiment peu avisé. Pour un temps, l’insurrection peut casser les lois du déterminisme économique et vaincre les résistances armées d’une classe économiquement plus forte, mais pour conserver la victoire, il faut aussi que l’insurrection, par sa violence même et pendant la brève période de son action, change les conditions économiques de telle sorte que celles-ci à leur tour puissent déterminer un plus grand développement de la révolution et la défaite définitive des éléments bourgeois qui auraient tendance à relever la tête.
C’est pour cela qu’il est nécessaire d’enlever la propriété aux bourgeois, de façon à ce qu’ils cessent d’être des privilégiés dès le premier moment. Après, qui ne travaillera pas, ne mangera pas ! Si cela n’est pas fait, si l’on confie à un gouvernement dictatorial socialiste le soin de l’expropriation, l’État laissera à la bourgeoisie le temps, en l’espace d’une génération, de reprendre son souffle dans ses palais, dans ses terres, dans ses usines, et peu après « son » gouvernement même si socialiste ou prolétarien de nom. Le changement se résumera à ceci : certains bourgeois auront disparu dans la tempête ou bien seront devenus prolétaires, mais la bourgeoisie fera peau neuve en incorporant certaines élites ouvrières privilégiées, certains hommes de partis, certains dirigeants, etc. Mais la révolution n’aura pas atteint son but : le communisme.
On pourrait se demander quelles difficultés réelles pourraient empêcher l’activité expropriatrice parallèlement à l’insurrection. Un raisonnement abstrait et purement dialectique, fut-il marxiste, ne suffit pas à nous faire comprendre pourquoi les paysans devraient continuer à reconnaître les propriétaires et à leur porter une partie ou bien tous les fruits de la terre qu’ils travaillent. Pourquoi les ouvriers des usines ne pourraient-ils chasser les patrons et continuer à travailler pour la communauté populaire ? Pourquoi le peuple ne pourrait-il pas s’emparer des choses utiles pour se sustenter, s’habiller et se réchauffer, distribuer immédiatement à tous le nécessaire, et verser le reste dans les magasins mis à la disposition de la communauté ? On ne comprend pas ce qui peut empêcher les travailleurs de prendre ce dont ils ont besoin et de faire ce qu’ils veulent dans ce domaine, vu qu’il n’y a plus de gouvernement pour défendre les propriétaires et les capitalistes. Car il y a bien des probabilités que ceux-ci disparaissent… à moins qu’un gouvernement ne leur donne à nouveau la possibilité de reparaître, tranquillement et en sécurité.
Pourquoi donc tout cela serait-il impossible ? Qui ou quoi pourrait l’empêcher ? Sa réalisation technique ainsi que nous l’entendons, nous, anarchistes, ne peut être aisément expliquée par le langage pseudo-scientifique cher aux marxistes, car les choses simples se disent seulement dans un langage simple et compris par tous. Et quand on dit ces choses simples aux prolétaires, les prolétaires les comprennent, et ils savent très bien que ce qui reste à faire n’est pas une chose trop difficile et qu’ils pourraient très facilement la réaliser seuls.
Certes, il ne suffit pas d’enlever la richesse aux patrons, et de s’emparer des moyens de production : il faut aussi continuer à produire. Il sera donc nécessaire d’organiser la production, d’une manière socialiste. Cela aussi doit être fait immédiatement, car sans manger, on ne peut pas vivre, serait-ce même en période révolutionnaire. Mais ici nous entrons dans un autre domaine qui n’est plus celui de l’expropriation, de la dépossession de la classe bourgeoise, mais celui de l’utilisation de la richesse totale déjà enlevée aux capitalistes.
Le problème de la production et de la consommation au lendemain de la révolution n’est pas un problème d’aujourd’hui, et si nous en parlions encore, nous nous répéterions inutilement. Ecrivains socialistes et anarchistes (et même des non-socialistes qui se sont penchés objectivement sur la question) y ont consacré opuscules et volumes. Même certains romans, dits utopistes, comme ceux de Bellamy et de Morris pourraient être utilement consultés.
Du point de vue anarchiste le problème des approvisionnements, des denrées, des logements, de l’habillement et en ligne générale de la production et de la consommation, a fait l’objet d’études de la part de Kropotkine dans son livre célèbre La Conquête du Pain. Sur certains points, ce livre est aujourd’hui dépassé, car beaucoup de questions ne se présentent plus sous le même aspect qu’il y a trente ou quarante ans. Quelques erreurs ont été mises en lumière et corrigées par Kropotkine lui-même dans quelques-uns de ses ouvrages postérieurs : tout spécialement son trop grand optimisme et une vision par trop simpliste de l’activité de la production, du point de vue de la grande industrie.
Une mise à jour de ce livre comme on dit dans le langage bureaucratique de la statistique serait très utile. Et puisque l’auteur n’est plus en condition de le faire [113], ses lecteurs peuvent le faire d’eux-mêmes, à l’aide de leur bon sens. Et pour cela, ils devraient tenir compte d’une œuvre plus récente de Kropotkine, dans laquelle le problème de la production y est plus particulièrement étudié. Il y démontre la possibilité de combiner la production industrielle et la production agricole, le travail manuel et le travail intellectuel, de façon à obtenir le rendement maximum avec un minimum d’efforts, et aussi un moindre sacrifice de la liberté et de l’individualité humaine [114].
Pour ce qui est de notre problème, bien des pages de La Conquête du Pain restent d’actualité et peuvent être utilement consultées. Il y démontre, en effet, que la production et la répartition égalitaires sont non seulement possibles, mais beaucoup plus profitables, si elles sont effectuées au moment même de la révolution, dès que la défaite des forces armées bourgeoises permettra de disposer librement des moyens de production et des denrées de première nécessité déjà produites. Seulement, le tort de Kropotkine déjà relevé par Savério Merlino à la sortie du livre consiste en cela : tandis qu’il affirme très bien comment on pourrait faire[115], il ne spécifie pas qui devrait le faire, il n’étudie pas les organismes spéciaux qui devraient être créés pour les nécessaires fonctions de production et de répartition. Kropotkine parle trop généralement du peuple et fait trop confiance à la spontanéité des masses, nous dirions presque à leur improvisation.
Certes, à ce moment-là entre 1880 et 1890, on était en période d’élaboration d’idées et de propagande, il serait peut-être apparu arbitraire et utopiste d’imaginer les organismes prolétariens, qui sont nés plus tard. La lacune est peut-être due à cela. En outre, des conditions générales plus florissantes pouvaient justifier un certain optimisme, tandis qu’aujourd’hui la crise nous oblige à envisager avec plus de rigueur le problème de la production. En revanche, aujourd’hui, nous sommes en mesure de prendre en compte beaucoup mieux qu’il y a trente ans, compte tenu de tout le réseau d’organismes nouveaux que le prolétariat a su se créer, une vue d’ensemble plus réaliste des problèmes surgis jadis.
On peut objecter que la réalisation de l’expropriation pourra dépendre aussi de la possibilité de vivre sans aucun patron et de se substituer utilement à eux pour l’organisation de la production. Nous admettons sans difficultés que pour arriver à la socialisation complète il faudra une période de temps beaucoup plus importante que celle nécessaire à l’insurrection et à l’expropriation. Mais cela ne veut pas dire que, dès le premier moment de la révolution, fût-ce dans un régime non encore parfaitement organisé de manière communiste, fût-ce même au milieu de grandes difficultés, il soit impossible de vivre de telle sorte que personne ne soit obligé de se faire exploiter et opprimer par les autres pour vivre.
D’ailleurs, ce qui est important pour le socialisme consiste en ceci : tous et chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins, sans qu’il lui soit nécessaire pour cela de se laisser exploiter et opprimer par d’autres. Et les travailleurs veulent justement cela et les moyens de réaliser cette possibilité et de la maintenir, c’est-à-dire que le type d’organisation sociale à adopter vient seulement en deuxième ligne, en tant qu’élément nécessaire pour atteindre le but exposé. Nous sommes communistes, en effet, parce que nous sommes convaincus qu’un tel résultat durable et définitif ne peut-être obtenu que par la socialisation de la propriété au sens communiste. Mais ce qui importe, c’est d’obtenir ce résultat, et la première condition pour l’atteindre, le tout premier pas, consiste à enlever aux riches les moyens d’exploiter les pauvres, donc les dépouiller de leurs richesses privées.
Voilà pourquoi l’expropriation est la condition première du développement et du triomphe de la révolution. Les demi-mesures, le fait de laisser subsister certaines formes d’exploitation, c’est-à-dire le fait de laisser aux patrons la force économique qui est leur moyen de nuire, équivaut à laisser les crochets à la vipère. Si l’insurrection commence par l’expropriation, la vipère deviendra inoffensive, les patrons n’auront plus de dents pour mordre, et la liberté ne leur donnera aucune arme dans les mains.
L’expropriation une fois réalisée, la liberté (à ne pas confondre avec la libre concurrence, avec la liberté économique de production et d’exploitation du régime capitaliste) ne sera pas du tout en contradiction avec les nécessités de la production pour tous et l’égalité sociale. La contradiction qui existe aujourd’hui à cause de la division des classes et du monopole bourgeois tombera d’elle-même et sera rendue impossible par l’expropriation.
Marx et Engels, dans leur Manifeste, allaient jusqu’à soutenir que « le communisme n’enlève à personne la faculté de s’approprier les produits sociaux, mais empêche seulement de s’en prévaloir pour asservir le travail d’autrui ». Que le travail ne soit pas asservi, voilà le principe authentiquement socialiste, ce qui signifie que le socialisme est une affirmation, et non une négation, de la liberté.
Certes, l’État bourgeois une fois abattu et les capitalistes expropriés, l’œuvre de socialisation définitive ne pourra être portée à terme instantanément, mais une période de consolidation expérimentale sera nécessaire tant avec des directives autoritaires que libertaires. L’organisation socialiste de la production et de la consommation, ainsi que tous les autres rapports sociaux, commenceront aux tous premiers moments de la révolution : mais ne pourront être ni complets ni définitifs, tant que le peuple ne pourra s’y dédier sans autres préoccupations, tant que, dans la paix retrouvée, il ne sera pas possible d’en tester les formes les mieux adaptées, les perfectionner et les achever.
Pendant le temps de réorganisation, il conviendra surtout de veiller à ce que l’exploitation et l’oppression aux dépens des travailleurs ne soient rendues à nouveau possibles car cela pourrait permettre au capitalisme de renaître de ses cendres. Mais il est vrai, aussi, que le meilleur remède à ce danger consiste dans l’expropriation immédiate dès l’insurrection. Lorsque les travailleurs auront mis la main sur la propriété, et que d’autre part il n’y aura plus la violence de l’État pour les tenir assujettis ou pour défendre quelques riches, il n’existera pas non plus des riches et des salariés. C’est-à-dire qu’il sera impossible d’assister à nouveau à l’« asservissement du travail d’autrui » dont parle Marx, et cela même si la réorganisation sociale n’est pas encore tout à fait terminée.
A moins… à moins que le danger ne vienne justement de l’éventuelle dictature socialiste qui, une fois vaincue la résistance de l’ancien régime, deviendrait à son tour l’oppresseur dans la nouvelle société et transformerait les travailleurs d’esclaves du capital privé en esclaves de l’État. C’est là une de nos préoccupations constantes, une de celle qui fait de nous des anarchistes.
L’expropriation est une chose et l’organisation communiste de la société en est une autre. La première est l’acte matériel par lequel est détruit le droit et le privilège de la propriété privée, l’autre est un acte de reconstruction, mais qui sera nécessairement plus long que l’acte de destruction.
Dès le premier moment, il faudra non seulement continuer à produire pour vivre, mais commencer aussi à organiser méthodiquement la production, la maintenir à un niveau satisfaisant, et en même temps organiser la distribution et la consommation. Mais, justement, s’il y a quelqu’un d’incapable en ce domaine, c’est un gouvernement composé de quelques personnes seulement qui dirigeraient tout depuis le centre, et cela, que ces personnes aient obtenu le pouvoir par un coup de main ou bien à la suite d’élections prolétariennes.
L’action directe prolétarienne et populaire, qui procède de sa propre initiative au moyen d’organismes libres surgis et formés en son sein, a de meilleures et de plus grandes vertus organisationnelles sans les défauts et les dangers de la bureaucratie étatique. Les organismes par lesquels on pourra assurer la continuité des fonctions de production et de distribution, tout en assurant un minimum d’ordre et de coordination indispensables, seront, outre les noyaux qui surgiront spontanément de la révolution, les groupements déjà existants, prolétaires, socialistes, syndicalistes, anarchistes, les syndicats et les unions professionnelles organisées par spécialité d’industrie et par lieu géographique selon les cas, les coopératives de classe, les ligues paysannes, les conseils d’usine, et enfin ces comités, ou « soviets » communaux, régionaux ou inter-régionaux, dont l’exemple nous vient de Russie, et auxquels on est en train de réfléchir en Italie. Tous ces groupements pourront, par la suite, devenir les organes de l’économie socialiste.
Rappelons, bien que nous en ayons déjà parlé, que nous considérons les « soviets » comme des associations de producteurs, pour la production et la consommation communistes. Ils n’ont donc aucun besoin du contrôle d’un gouvernement dictatorial, qui au contraire ferait obstacle et gênerait leur utile fonction économique.
On peut aussi ajouter à tous ces types d’associations d’autres organisations : associations ouvrières et professionnelles, sociétés de secours, corporations d’employés, cheminots, postiers, personnel technique, ingénieurs, chimistes, etc., ainsi que certaines institutions d’origine ou de nature bourgeoise (après, bien entendu, en avoir chassé les patrons et toute direction qui ne soit pas exclusivement technique) mais assimilables et facilement transformables en organismes de vie révolutionnaire. Par exemple certains groupements autonomes et coopératives de consommation, certains grands magasins de ravitaillement, bureaux de distribution privés et publics, quelques-uns des plus importants services d’utilité générale, gérés aujourd’hui dans un but de spéculation ou bien comme un instrument de gouvernement. Le personnel employé, même s’il n’est pas à proprement parler prolétaire, a avec le prolétariat de grandes affinités et n’a besoin ni de gouvernement, ni de ministres, ni de patrons pour assurer la continuité de son travail. Certains travaux et services nécessiteront une organisation de type centralisé, et beaucoup d’autres non. Mais cette sorte de centralisation, de fonction et non de pouvoir, spéciale à un service particulier, est tout autre chose que la centralisation des fonctions et du pouvoir en même temps, de tous les services comme de toutes les autorités, dans les mains d’un gouvernement dictatorial unique. Pour ces travaux aussi, le gouvernement serait absolument superflu.
Mais pour que la révolution puisse prendre une direction aussi libertaire, décentralisée, anti-étatique, il faut aussi que sa préparation morale et matérielle, et donc que la propagande elle-même, soient axées sur ces mêmes principes. Au lieu d’habituer les masses à l’idée de la dictature, et à attendre du pouvoir l’unique moyen de défaire tous les nœuds, au lieu de confier toutes les tâches techniques révolutionnaires à des comités centraux, à la direction d’un parti ou d’une confédération, etc., il faudrait préparer les groupes et les organismes déjà existants à assumer le rôle dont ils ont les capacités, ou les rendre capables s’ils ne le sont pas encore. Dans le même temps, il faudrait former de nouveaux organismes, plus ou moins embryonnaires, de distribution, de reconstruction, d’élaboration, qui pourraient se rendre nécessaires, de façon à ce que l’on ne se trouve pas au lendemain d’une insurrection sans avoir rien préparé, autrement dit sans un programme pratique précis à exécuter et donc contraints à subir un nouveau pouvoir qui s’est substitué à l’ancien, et qui se serait surtout substitué à notre incapacité de coordination et de production.
Dès à présent, d’ailleurs, la formation de conseils ouvriers et paysans pourrait être utile. Leur système d’organisation serait même plus libertaire que celui des anciennes organisations prolétariennes existantes, car il est essentiellement axé sur l’usine, plutôt que par profession ou par pays. Ces conseils peuvent aussi avoir une plus grande homogénéité et capacité révolutionnaire, à condition qu’ils ne dégénèrent pas en embryon réformiste, en double inutile des commissions internes d’établissement, etc. Mais notre objectif n’est pas à ce propos d’entrer dans les détails. Il nous suffit d’avoir abordé quelques aspects de la question pour montrer qu’une direction anarchiste de la révolution non seulement correspond davantage à nos idées mais qu’elle est bien meilleure qu’une direction autoritaire, plus efficace et aussi plus réalisable.
La peur de la liberté
L’aberration de ceux qui voient le salut de la révolution dans la dictature (après avoir fait longtemps de la cause du socialisme une cause de liberté) est semblable à celle de ces révolutionnaires qui, au déclenchement de la dernière guerre, voyaient le socialisme et la liberté compromis, non pas tant par la guerre elle-même, mais par la menace de la victoire d’une partie des belligérants.
En un mot, ils étaient à nouveau aveuglés, après presque un siècle d’expériences, par l’illusion démocratique, et à nouveau ils confièrent à la démocratie bourgeoise les chances du salut. Les partisans de la dictature prolétarienne font la même erreur, en voulant substituer à la plus ou moins larvée dictature bourgeoise celle des représentants des travailleurs. Et, lorsque nous affirmons que la révolution doit se déchaîner avec un maximum de liberté, laissant la voie ouverte à toutes les initiatives populaires, ils nous répondent, avec quantité d’objections, qui peuvent se résumer à un sentiment qu’ils n’osent pas s’avouer eux-mêmes : la peur de la liberté ! Après avoir exalté le prolétariat pendant cinquante ans, maintenant qu’il est à la veille de briser ses chaînes ils doutent de lui et ils l’estiment, dans leur for intérieur, incapable de gérer lui-même ses propres intérêts, songeant à le brider d’une quelconque façon, afin de le guider « par la force » vers la libération.
Ils se comportent comme un malade qui, ayant à subir une opération, après l’avoir souhaitée et avoir hâté ses préparatifs dans l’espoir de guérir, la refuse à la dernière minute et lui préfère une piqûre de morphine qui calme la douleur, donne l’illusion passagère d’une amélioration, mais laisse intacte le mal et le danger de mort. Il trouve quantité de scrupules, de peurs, et toutes ses objections tendent à retarder le moment de l’opération qui serait pourtant l’acte de sa véritable guérison.
Toutes les objections mises en avant par les partisans d’une dictature sont axées sur le principal argument de l’incapacité du prolétariat à se gouverner de lui-même, à remplacer la bourgeoisie dans la gestion de la production et à maintenir l’ordre sans le gouvernement, c’est-à-dire qu’ils lui reconnaissent seulement la capacité de se choisir des représentants et des gouvernants. Bien entendu, ils n’expriment pas leur concept de la même manière que nous, au contraire ils le masquent, à eux-mêmes encore plus soigneusement qu’aux autres, par divers raisonnements théoriques. Mais leur préoccupation dominante est toujours la même : la liberté serait dangereuse, l’autorité est nécessaire pour le peuple ; de la même façon, les athées bourgeois soutiennent la nécessité de la religion afin que le peuple soit maintenu dans le droit chemin.
Il peut arriver, c’est un fait, que l’autorité soit nécessaire, mais non pas parce qu’elle est « naturelle » et que l’on ne peut s’en passer, mais tout simplement parce qu’on a habitué les peuples à la considérer comme indispensable. Au lieu de leur apprendre à agir par eux-mêmes et à procéder pour résoudre seuls les difficultés, on les maintient dans l’ignorance sur ces questions, et même on les leur cache. Et pour avoir un consensus encore plus large, on leur dit que tout est facile. Puis on leur apprend que, leurs chaînes aussitôt rompues, il leur faudra créer immédiatement un nouveau gouvernement qui pensera à tout.
Ceux qui parlent de la dictature comme d’un mal nécessaire pendant la première période de la révolution (durant laquelle au contraire on aurait besoin d’un maximum de liberté) ne s’aperçoivent pas qu’ils contribuent eux-mêmes à la rendre nécessaire par leur propre propagande. Beaucoup de choses deviennent inévitables à force de les croire telles, de les vouloir telles. En réalité nous les créons nous-mêmes. Il en est de même pour la dictature, que les socialistes sont en train de préparer par leur propagande, au lieu d’étudier la possibilité d’éviter ce mal, cette usurpation préventive de la révolution. Ils ne se posent même pas le problème, peut-être justement parce qu’ils n’ont pas assez confiance dans la liberté, parce que, au contraire, ils font reposer toute leur confiance sur l’autorité. Donc, ils ne peuvent pas le résoudre.
Les anarchistes, eux, le résolvent, car ils voient dans la liberté le meilleur moyen de faire la révolution, de la vivre et de la continuer.
La peur du désordre, du déchaînement des passions, de la résurgence des égoïsmes, de la brutalité, de l’indiscipline et de la fainéantise… Voilà le prétexte qui a toujours été invoqué pour justifier les tyrannies et combattre toute idée de révolution.
Il est bizarre que certains socialistes trouvent justement dans ces choses la justification de leurs propres idées dictatoriales ! Il y a quelque temps, dans l’Avanti ![116], on a dit que la bourgeoisie a fait elle aussi la révolution et a imposé la dictature, qu’en somme nous vivons sous la dictature bourgeoise. Que la bourgeoisie, pour faire la guerre, a encore accentué sa centralisation dictatoriale, etc., et que donc les prolétaires ont le droit d’en faire autant. Qu’ils en aient le droit face à la bourgeoisie (qui est la moins autorisée à se scandaliser de l’idée de dictature prolétarienne), cela est juste. Nous ajouterons même que la bourgeoisie aurait tort de s’en alarmer, même de son point de vue, car une révolution vraiment libre de tout empêchement gouvernemental lui assènerait des coups bien plus redoutables. Mais que les prolétaires trouvent leur intérêt dans la dictature, cela est une autre affaire.
Le fait que la bourgeoisie se soit servie de la dictature ne prouve absolument rien, ou alors le contraire. La révolution sociale ne peut pas avoir les mêmes objectifs que celle de la bourgeoisie. Et de plus, la guerre est une chose, la révolution en est une autre. Les moyens qui sont bons pour la guerre et pour la révolution bourgeoise ne sont pas tous bons pour la révolution sociale. La centralisation autoritaire de la dictature est un moyen particulièrement nuisible car il pourrait facilement changer une révolution sociale en une révolution exclusivement politique, ainsi on enlèverait au peuple l’initiative de l’expropriation immédiate, on engendrerait du point de vue prolétaire et humain le même échec qu’au cours des révolutions précédentes.
Ces révolutions qui avaient pourtant été faites par le peuple (lequel avait été poussé alors aussi par un désir de libération complète et d’égalité non seulement politique) ont fini par le triomphe d’une classe sur les autres, justement parce que la dictature révolutionnaire avait préparé et rendu possible un tel triomphe. Si la bourgeoisie s’en est servie, elle l’a fait justement pour étouffer la révolution. C’était son intérêt. L’intérêt des prolétaires se trouve justement à l’opposé, à savoir dans la continuation de la révolution et dans son accomplissement. Pour cela, la dictature est contraire à ces intérêts.
Il est bien possible qu’une dictature prolétarienne et révolutionnaire puisse anéantir les actuels privilèges de la bourgeoisie, mais compte tenu du fait qu’elle sera forcément limitée dans ces composantes, elle restera toujours la dictature d’un parti ou d’une classe, et tendra à abolir non pas tout gouvernement de partis et divisions de classes, mais à substituer le gouvernement en place par un autre, la domination d’une classe par une autre. Il va de soi que si l’existence d’un gouvernement implique l’existence de ses sujets, la présence d’une classe dominante signifie l’existence d’une autre classe dominée et exploitée. Comme dirait Constantino Lazzari, les musiciens ont changé, mais la musique est toujours la même.
Nous ne sommes pas prophètes et nous ne pouvons pas dire comment tout cela pourra se produire. Mais nous pouvons attirer l’attention des lecteurs, et des socialistes tout spécialement, sur le fait que le prolétariat n’est pas une classe unique et homogène, mais l’ensemble de différentes catégories, de plusieurs espèces de sous-classes, etc. Parmi elles, il y en a qui sont plus ou moins privilégiées, plus ou moins évoluées, et il y en a même quelques-unes qui d’une certaine manière parasitent les autres. Il y a parmi elles des minorités et des majorités, il y a des divisions partisanes, des intérêts contradictoires, etc. Aujourd’hui tout cela n’est pas vraiment perceptible car la domination bourgeoise oblige un peu tout le monde à être solidaire contre elle. Mais la chose est évidente pour ceux qui étudient de près le mouvement ouvrier et corporatif. Or, la dictature prolétarienne, qui finirait à coup sûr entre les mains des catégories ouvrières les mieux développées, organisées et armées, pourrait ainsi donner lieu à la constitution de la classe dominante de demain, celle qui, dès maintenant, aime se définir comme « l’élite ouvrière », et cela non pas seulement aux dépens de la bourgeoisie simplement détrônée, mais aussi aux dépens des grandes masses moins favorisées par la position dans laquelle elles se trouveront au moment de la révolution.
Une autre classe dominante serait sans doute constituée par tous les fonctionnaires des partis, des organisations, des syndicats, etc. Celle-ci pourrait plutôt s’appeler une caste à peu près semblable à l’actuelle caste bureaucratique gouvernementale à laquelle, peut-être, elle viendrait à se substituer. En outre, la dictature aura elle aussi, en plus du gouvernement central, ses organes, ses employés, ses hommes armés, ses magistrats, ses policiers ; ceux-ci, avec les actuels fonctionnaires du prolétariat, pourraient justement constituer la machine étatique de la domination de demain, pour le compte d’une partie privilégiée du prolétariat, son allié. Et celle-ci cesserait, de fait, d’être « prolétariat » et deviendrait quelque chose qui ressemblerait étrangement à la bourgeoisie d’aujourd’hui. Les choses pourront peut-être procéder autrement, dans les détails, mais cette autre direction sera semblable et aura les mêmes inconvénients. En ligne générale, la voie de la dictature ne peut mener la révolution que vers une issue de ce genre, c’est-à-dire justement vers le contraire de ce qui est le but essentiel de l’anarchisme, du socialisme et de la révolution sociale.
Il est tout aussi erroné de dire qu’il faut tout autant la dictature pour la révolution que pour la guerre. Qu’elle soit nécessaire pour la guerre que l’État et la bourgeoisie font sur le dos des prolétaires, c’est un fait. Il s’agit de l’imposer par la force, de faire combattre la majorité du peuple contre son intérêt, contre ses idées, contre ses libertés, et il est normal que pour l’y obliger on ait recours à la violence, à une autorité coercitive, et que le gouvernement soit armé contre le peuple de tous les pouvoirs possibles. Mais la révolution est autre chose. La révolution est la lutte que le peuple entreprend de sa propre volonté dans le sens de ses intérêts, de ses idées, de sa liberté. Donc il ne faut pas le freiner. Il faut au contraire le laisser libre de ses mouvements, laisser se déchaîner en toute liberté ses amours et ses haines, afin qu’il en jaillisse l’énergie nécessaire à vaincre l’opposition violente des oppresseurs.
Tout pouvoir qui limite sa liberté, son esprit d’initiative et sa violence serait un obstacle au triomphe de la révolution qui ne se perd pas, ne se perd jamais pour avoir trop osé, mais seulement pour avoir été trop timide !
La peur du désordre et de ses conséquences est une superstition enfantine, tout comme la peur de tomber qui est propre à l’enfant qui vient d’apprendre à marcher.
Aucune révolution n’est exempte de désordres, tout au moins à ses débuts. Même dans les révolutions les moins violentes, les plus bourgeoises, cela n’a pu être évité, et ne le sera pas pendant une révolution sociale qui secoue les bases mêmes de la société. Il est vrai, cependant, que pour que la vie soit possible, il est nécessaire qu’un ordre soit au plus tôt établi. Mais le problème qui se pose n’est pas celui de l’instauration d’un nouveau gouvernement, mais plutôt de savoir ce qu’il convient de remettre en ordre, qui pourrait réaliser un ordre meilleur, s’il faut pour cela un gouvernement plus ou moins dictatorial, ou bien la libre initiative populaire.
Les socialistes optent pour un gouvernement révolutionnaire. Nous croyons, au contraire, qu’un gouvernement, surtout s’il est dictatorial, constitue un élément supplémentaire de désordre, car il créera un ordre artificiel selon des schémas a priori et de parti, et non selon les tendances et les besoins des masses. Ces masses, en revanche, à travers leurs propres institutions (comme nous l’avons déjà signalé) pourraient beaucoup mieux et d’une manière plus ordonnée, s’organiser afin d’assurer l’ordre. L’ordre « libre et volontaire », et non cet ordre artificiel et officiel que les gouvernements imposent.
Cet « ordre dans le désordre » a été vu et admiré pendant presque toutes les révolutions et les mouvements populaires. Souvent, au cours de ces périodes, on a pu remarquer une diminution très importante des phénomènes de criminalité. Quand les sbires ont disparu et que le gouvernement est inexistant, le peuple assume par lui-même la responsabilité de l’ordre, non pas par délégation à des tiers, mais directement en tous lieux, avec les moyens et les personnes dont il dispose localement. Parfois même il dépasse les limites comme en 1848, où on fusillait même des petits voleurs inconscients pris sur le fait.
Cet esprit d’ordre du peuple a été remarqué par tous les historiens, dans les périodes succédant immédiatement aux insurrections, c’est-à-dire au moment même de la chute de l’ancien régime, et alors que le nouveau était encore, soit inexistant, soit encore trop faible. Et cela s’est produit pendant les périodes les plus désordonnées, que les historiens bourgeois appellent « d’anarchie », pendant la révolution française de 1789 à 1793, dans les villes comme dans les campagnes, ainsi que pendant les différentes révolutions européennes de 1848, et pendant la Commune de 1871. Le désordre est apparu après, avec le retour d’un gouvernement régulier, qu’il fut ancien ou nouveau. Bien que des inconvénients se soient toujours vérifiés – quoi de plus naturel d’ailleurs ? –, jamais il n’y en a eu au cours des « périodes anarchiques » d’aussi importants qu’à l’occasion de l’ordre imposé par un gouvernement quelconque.
D’autre part, il ne faudrait pas baptiser d’excès révolutionnaires ou de désordres certains épisodes de violence contre la propriété ou les personnes. Ce sont là de véritables épisodes de la révolution, inséparables de celle-ci, et par lesquels une révolution affirme son existence.
La révolution de 89, par exemple, serait inconcevable sans la pendaison des accapareurs et des affameurs du peuple, sans l’incendie des châteaux, sans les journées de septembre, sans les prétendus excès de Marat, des herbertistes, etc. Cette espèce de désordre est justement ce qu’il faut pour fonder le nouvel ordre que nous avons tant à cœur, il faut donc lui assurer toute la liberté de se manifester et de se dérouler. Il serait encore plus dangereux de vouloir l’arrêter. Cela reviendrait à vouloir opposer une digue à un torrent dont les eaux, empêchées de s’écouler naturellement, se répandraient en endommageant les campagnes voisines. Tandis qu’en laissant les eaux suivre leurs cours, elles arriveraient beaucoup plus tôt à la plaine et pourraient poursuivre leur chemin vers la mer avec une tranquillité toujours accrue.
Le peuple a démontré les mêmes capacités d’ordre dans toutes les révolutions, et dans un sens positif : esprit d’organisation et capacité à satisfaire tous les besoins impératifs même en temps de révolution.
« Il faut n’avoir jamais vu à l’œuvre le peuple laborieux, il faut avoir passé sa vie entière dans la paperasse et ne rien connaître du peuple pour en arriver à douter de lui. En revanche, parlez de l’esprit d’organisation de ce grand inconnu qu’est le peuple à ceux qui l’ont vu à Paris pendant les journées des barricades, ou bien à Londres pendant la grève des docks en 1887, lorsqu’il devait aider un million d’affamés, et ils vous diront combien le peuple est supérieur à toute la bureaucratie de nos administrations[117]. »
• Mais il ne faut pas non plus tomber dans l’optimisme excessif de Kropotkine, qui nous conduirait à nous laisser transporter par le courant, comme s’il n’était pas nécessaire de se soucier à l’avance de ce qu’il faut faire.
Au contraire, il faut se poser d’abord les problèmes de l’action et de la production, préparer les esprits et les volontés, adapter et affiner les instruments de la future initiative populaire, afin que, dans n’importe quel point du territoire en révolution, il y ait des hommes et des groupes qui l’évitent d’être surprise et l’empêchent de tomber aux mains d’un quelconque pouvoir central. C’est-à-dire qu’il faudrait une préparation pratique, non seulement négative mais aussi positive, des minorités révolutionnaires et libertaires dès avant la révolution, afin qu’elles puissent agir et répondre aux nécessités qui se détermineront au fur et à mesure sans besoin de se confier à un gouvernement.
Bakounine, qui avait senti cette nécessité, croyant la révolution toute proche, avait essayé de créer en 1869 une « Alliance secrète ». Sa conception est toujours valable aujourd’hui. À part le formalisme qui résultait encore des conspirations d’avant 1870, sa conception du réveil de la spontanéité et de toutes les forces locales, dans tous les endroits possibles, des minorités révolutionnaires est encore valable aujourd’hui. Il faut des pilotes invisibles qui produisent l’anarchie au milieu de la tempête populaire et qui sachent guider les masses, non pas grâce à un pouvoir manifeste, officiel, mais par l’exemple de leur propre activité. Mais pour que cette force puisse agir, disait Bakounine en guise d’avertissement, « il est nécessaire qu’elle existe, car elle ne se formera pas toute seule ».
Ajoutons que Bakounine voyait la possibilité d’un mouvement révolutionnaire grâce à l’action grandissante et à l’influence de l’organisation ouvrière dans l’Internationale. Mais dans le but d’éviter qu’ils ne deviennent une autorité officielle, les membres de l’Alliance secrète prenaient la décision de ne pas occuper, sauf cas de force majeure, des charges directives dans l’Internationale.
Si dans chaque quartier, chaque village, chaque usine, chaque centre, etc., il y a des groupes résolus qui prennent, dès le premier moment, l’initiative révolutionnaire ; s’ils sont préparés et ont à leur disposition les moyens qui conviennent, tant en ce qui concerne la destruction du régime en place que pour la continuité de la production, toute initiative de créer à nouveau une autorité gouvernementale ou dictatoriale sera tuée dans l’œuf. L’autorité sera tellement partagée qu’elle ne pourra plus exister en tant que pouvoir coercitif, le fait d’être partout et en tous lieux empêchera toute centralisation.
Si on peut préparer de telle sorte la révolution et la possibilité du développement des initiatives locales par groupement et par fonction, toute possibilité de dictature sera détruite.
On nous a dit que l’on a besoin de la dictature pour organiser la lutte contre les résistances bourgeoises. Mais pourquoi ? On peut partager la révolution en deux grandes périodes : celle avant la destruction du pouvoir politique de la bourgeoisie, et celle qui vient tout de suite après. Tant que le pouvoir gouvernemental bourgeois n’est pas complètement abattu, la dictature du prolétariat n’est pas réalisable. Seule la dictature bourgeoise existe encore. Une fois abattu le gouvernement bourgeois, qui constitue la résistance armée de la classe capitaliste, cette classe elle-même se trouve implicitement désarmée et battue. Si certains de ses éléments réussissent, ici ou là, par groupes, à continuer la résistance, ils vont se trouver dans une situation d’infériorité absolue face au prolétariat désormais plus nombreux et armé comme eux, sinon mieux. Pour éliminer ces foyers de résistance, il est parfaitement inutile de constituer un gouvernement central, mieux vaut en laisser le soin à l’insurrection locale, quitte à s’entendre avec les autres localités pour venir en aide aux révolutionnaires qui en auront besoin.
Les différents centres révolutionnaires vont se fédérer et garder contact, dans un but d’aide réciproque et selon un type d’organisation fédéraliste tout à fait opposée à l’organisation dictatoriale. Cela évitera peut-être le grave inconvénient, qui s’est vérifié pendant la révolution française et, à ce qu’il paraît, tout récemment en Russie aussi. Celui-ci est créé par le gouvernement central qui, avec les meilleures intentions du monde, envoie des ordres contraires à l’esprit qui domine dans telle ou telle région, en contradiction avec les légitimes intérêts collectifs de certaines populations éloignées ou bien de certaines catégories ouvrières moins favorisées. Cela est grave, et peut aboutir à un refroidissement de l’élan révolutionnaire, ou voire même favoriser des menées contre-révolutionnaires. Cela pourrait se vérifier tout spécialement lorsque, pour l’expropriation, on se servirait d’un unique critère de forme et de procédure, alors que cela devrait varier selon les circonstances et la tendance des masses, de localité en localité.
Comme nous l’avons déjà dit précédemment, il n’y a pas besoin d’un organe central autoritaire pour l’œuvre d’expropriation. L’activité des organisations ouvrières déjà existantes et de celles qui se formeront par branches d’activité suffira amplement pour assurer cette tâche dès les premiers moments de la révolution. De même nous avons aussi dit que la réalisation pratique de l’expropriation ne présente même pas de difficultés excessives dans des nations à populations concentrées où tout ce qui est à exproprier est à la portée de la main des intéressés. Elle a peut-être pu en présenter en Russie, dans les campagnes, à cause de leur immense étendue presqu’inhabitée et des communications difficiles, mais pas dans des nations à forte densité d’habitants comme les nôtres.
De toutes manières, les difficultés qui pourraient se présenter peuvent toujours être résolues en mieux par les organisations ouvrières plutôt que par un gouvernement central. Ou alors, si l’on se contente de l’intention antirévolutionnaire et utopiste de conquérir le pouvoir et de renvoyer l’expropriation à plus tard, par l’œuvre officielle d’un État socialiste dictatorial, ce serait un désastre pour la révolution.
La peur de la liberté ou, ce qui revient pratiquement au même, le culte de l’autorité fait concevoir aux partisans de la « dictature » des arguments qui sont déjà une condamnation explicite de la dictature elle-même. Ils disent souvent : « la bourgeoisie ne fait-elle pas la même chose ? La dictature du prolétariat serait la dictature d’une élite, mais l’actuelle dictature bourgeoise n’est-elle pas peut-être aussi la dictature d’une élite ? » [118]
Très juste ! Mais la révolution ne doit pas substituer une élite à une autre, elle doit les abolir toutes. Si son résultat consiste dans la substitution d’une dictature à une autre, alors mieux vaut prévoir, dès aujourd’hui, la faillite de la révolution. Si tel est le but des partisans de la dictature prolétarienne, alors on comprend aussi pourquoi ils veulent assigner à la révolution, comme fonction première, la suppression de la liberté, c’est-à-dire une fonction tout à fait opposée à celle qui est dans la nature même de toute révolution, à savoir la conquête d’une liberté toujours plus grande.
Et cela explique aussi le langage tenu par les socialistes autoritaires et dictatoriaux lorsqu’ils accusent de démagogie démocratique et petite-bourgeoise la préoccupation de liberté des anarchistes. Pourtant, nous sommes entièrement d’accord avec eux en ce qui concerne leur aversion pour la démocratie bourgeoise et petite-bourgeoise. Nous sommes même plus cohérents qu’eux dans notre position, car nous ne voulons pas nous servir, pour notre lutte révolutionnaire, des institutions parlementaires et administratives des bourgeois. Mais tandis que notre inimitié à l’égard de la démocratie et du libéralisme bourgeois reflète l’espoir et, en même temps, la certitude de l’avenir, l’esprit antidémocratique des partisans de la dictature est comme un retour au passé. Le peu de liberté que les régimes démocratiques concèdent au peuple ne suffit pas aux anarchistes. Les partisans de la dictature, au contraire, voudraient enlever au peuple même ce peu de liberté. Donc, si les préoccupations libertaires des anarchistes peuvent être taxées de « démocratiques », nous pouvons rétorquer que les aspirations dictatoriales des socialistes favorisent le retour à l’absolutisme, à l’autocratie, aux méthodes de gouvernement du « jeux, pain, gibet » qui plaisaient à la plèbe napolitaine de 1799 et de 1849.
Les socialistes, bien entendu, ne se rendent pas compte des tendances dangereuses que comporte leur système et ils pensent vouloir tout le contraire de ce à quoi leurs tendances vont les conduire. Il se pourrait que les faits de Russie, s’ils étaient mieux connus, leur servent de leçon.
La révolution, en Russie, a été beaucoup plus l’œuvre de la libre action du peuple que celle du gouvernement bolchevique. Les forces ouvrières et paysannes, en profitant, spécialement au cours de la première année, de la faiblesse des différents gouvernements qui s’y étaient succédés, ont démantelé, morceau par morceau, l’ancien régime, renversé pour ainsi dire les valeurs sociales, commencé expropriation sur une large échelle, jeté les bases des nouvelles institutions de production et d’organisation ; tout ce que, en somme, le gouvernement bolchevique devait, par la suite, soumettre à sa discipline militariste et dictatoriale. C’est la liberté, et non pas la dictature, qui a libéré la Russie du tsarisme, de la bourgeoisie « libérale » et de la social-démocratie patriotique et jusqu’auboutiste. C’est la liberté qui a fait et entretenu la révolution, la dictature n’a fait qu’en cueillir les fruits, peut-être même les a-t-elle pourris.
En ce qui concerne la Russie, tant que la lumière ne sera pas faite et que son isolement et son silence ne seront pas rompus, mes affirmations et déductions seront toujours pleines d’incertitude et de doute. Mais en ce qui concerne l’Europe occidentale (hormis l’Allemagne, éduquée depuis trop longtemps aux régimes autoritaires), une conception dictatoriale, gouvernementale et autoritaire de la révolution n’est pas concevable. Il faut avoir oublié ce que sont les qualités psychologiques des races latines ou croisées avec elles, leur esprit d’indépendance, leur peu de goût pour les lois et les autorités, pour se faire des illusions à ce propos.
Et le savent les gouvernements qui doivent s’adapter à l’observation relative et sommaire des lois par leurs sujets. Ils sont obligés, pour maintenir l’équilibre, d’en faire souvent abstraction, de les modifier continuellement, de faire des exceptions par des lois spéciales ou par des amnisties. Pourtant, les gouvernements actuels, pour garder leur autorité, disposent, en plus de traditions et institutions séculaires, des forces armées basées sur l’ignorance des uns et sur les privilèges des autres. La plupart des sujets, en outre, sont habitués à se plier par inertie. Mais quand l’habitude et l’inertie seront secouées, la force armée balayée, les privilèges et les institutions renversées, les traditions détruites, et que tout un peuple mû par la passion (et non pas dans sa majorité apathique comme celui de Russie) sera mis en marche, qui donc pourra l’arrêter ? Qui le fera obéir ? Quelles forces pourront déployer les socialistes, capables de discipliner sous leur dictature un peuple affamé non seulement de pain, mais aussi et surtout de liberté ?
Aucune force, pas un homme. Les socialistes devraient le comprendre, s’ils examinaient les foules qu’ils guident eux-mêmes, s’ils faisaient leur examen de conscience. Car ils parlent, toujours, de nécessaire discipline… pour les autres, mais chaque fraction, chaque groupe, chaque individu, s’arroge le droit de faire exception à la règle et de revendiquer (pour le bien, cela va de soi, du parti et de la révolution) sa liberté personnelle, son droit propre à la désobéissance. Leurs propres partisans, les mêmes qui aujourd’hui magnifient le système dictatorial, finiront, demain, après la révolution et quelques brèves expériences, par le trouver insupportable !
La révolution libérera l’esprit de liberté de son carcan trop étroit. Et une fois délivré, cet esprit deviendra gigantesque, comme le génie de la fable que quelqu’un a laissé imprudemment s’échapper de la bouteille dans laquelle il se trouvait prisonnier. Mais ressaisir l’esprit de liberté, le réduire, le renfermer et l’enchaîner à nouveau sera chose impossible, même pour ceux qui se sont employés à le débrider. Tout spécialement dans les pays latins où les tendances anarchistes de révolte sont si fortes (et où les anarchistes proprement dit en tant que force politico-sociale ont une influence que la révolution va accroître énormément). Vouloir y constituer un gouvernement fort, une dictature selon le programme bolchevique nécessiterait un effort tel qu’il userait les meilleures énergies socialistes et révolutionnaires.
Cela serait une perte sans compensation et représenterait des efforts, des sacrifices, du temps et peut-être même beaucoup de sang, soustraits au travail libre bien plus vital à la véritable reconstruction de la société humaine.
Travail et liberté
Nombreux sont ceux qui parlent, Lénine y compris dans un de ses écrits, de la nécessité d’une discipline dictatoriale du travail aux fins d’une rapide reconstruction de la richesse, après les désastres de la guerre et les inévitables destructions dues aux faits de la révolution.
Les journaux ont souvent fait allusion aux mesures coercitives adoptées par le gouvernement russe dans le but de contraindre les ouvriers au travail. Il est impossible de croire aveuglément à de telles choses qui proviennent d’ennemis déclarés des bolcheviks, mais il est vrai que les journaux socialistes les plus importants n’ont pas démenti ces faits, ou bien ils parlent de telle sorte qu’ils sembleraient indirectement confirmer ce que disent les envoyés spéciaux des journaux conservateurs ou bourgeois. Si cela était vrai, il s’agirait ici de l’assujettissement du prolétariat au régime des travaux forcés, ce qui serait la plus grave des condamnations du régime dictatorial.
Certes, le problème de la continuité et de l’intensification de la production est très important. Nous l’avons déjà dit et nous le répétons ce problème doit être résolu au plus vite, d’abord pour en tirer certaines normes pour ce qui reste à faire, ensuite pour éviter des illusions et pour que tout le monde prenne conscience des difficultés qui restent à résoudre en cas de révolution. Et ici, peut-être que les anarchistes ont le tort de faire comme tous les socialistes, ils voient les choses avec trop d’optimisme. Le seul, peut-être, qui parmi nous
a essayé de réagir contre cet optimisme a été Malatesta. Il soutenait que la révolution, dès qu’elle aurait été victorieuse, serait devenue un problème de production car il n’est pas vrai, comme certains l’ont cru pendant longtemps, qu’il suffit de chasser le gouvernement des seigneurs pour que tout s’arrange spontanément. Il faut donc se remettre au travail afin qu’il y ait de quoi vivre pour tous, jusqu’au moment où l’on pourra revenir à une situation normale.
En effet, dès le premier moment de la révolution on va se trouver dans le besoin. Malatesta nous disait justement que si une révolution ou une grève générale stoppait complètement tous les échanges à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Angleterre, alors après une ou deux semaines, à Londres, on pourrait mourir de faim. Il faut donc s’en persuader et l’expliquer clairement à la classe ouvrière, afin que dès maintenant cette idée soit, dans la conscience de tous, intimement liée à l’idée de la révolution, qui ne peut et ne doit être une « grève générale » à proprement parler qu’aux tout premiers moments. Presqu’aussitôt les chemins de fer et les navires doivent recommencer à circuler et les travailleurs à produire des denrées de première nécessité.
Et il en doit être ainsi même pendant les combats. Tandis qu’une partie de la population ouvrière, la plus jeune et ardente, s’oppose à la résistance armée des bourgeois, la partie la plus faible et inapte aux combats, les femmes y comprises, doit travailler à l’arrière de la révolution, afin qu’il ne manque ni aux combattants ni au reste de la population des travailleurs, et aux familles ouvrières, le pain nécessaire, l’habillement et le feu. Les provisions mises en séquestre dans les magasins de la bourgeoisie ne pourront suffire que pendant les premiers jours ; à brève échéance, il n’y aura plus rien à manger. Cela doit conseiller aux révolutionnaires, dès les premiers jours, de ne pas trop gaspiller ni causer des destructions inutiles. La classe ouvrière en général devra se rendre au travail le plus tôt possible, non plus pour les autres, mais pour elle-même. Autrement la famine ouvrira les portes au premier condottiere armé qui viendra d’un quelconque pays réactionnaire pour rétablir la tyrannie par la seule et unique promesse d’un peu de pain.
Mais ce n’est qu’une utopie, qu’une folie, que de penser que la classe ouvrière qui vient de secouer son joug, puisse être contrainte à travailler par la force, par un gouvernement nouveau, même constitué en son nom. Et c’est pour cela qu’à ce propos aussi nous sommes assez sceptiques sur les événements de Russie. Il est probable que la république russe soit moins dictatoriale qu’elle n’apparaît à travers les discours de ses dirigeants et que le peuple russe puise davantage en lui-même et dans sa libre initiative que dans un gouvernement central la force de produire, de s’organiser et de vivre. N’insistons pas. Au reste, Lénine lui-même dit que le Russe est un mauvais ouvrier par rapport aux citoyens des nations avancées, qu’il constitue une masse encore incapable puisqu’écrasé jusqu’à hier par le tsarisme et par l’héritage du servage, depuis peu aboli, et abruti par le besoin et l’ignorance.
Il se pourrait (on n’est sûr de rien) que cet état des masses russes ait justifié d’un côté, compte tenu des nécessités impératives du moment, l’application de moyens dictatoriaux, et de l’autre les ait rendus possibles. On pourrait en discuter, s’il n’existait pas d’autres moyens, ou si ces moyens étaient les seuls capables d’enlever les masses de l’abjection qui a été la leur. Mais il est certain que de pareilles méthodes ne seraient absolument pas applicables en Europe occidentale et, heureusement, elles ne seraient point nécessaires. Un gouvernement qui prétendrait diriger, par la force, le travail de la classe ouvrière de toute une nation, la contraindre à l’obéissance, devrait transformer les usines en casernes où une moitié armée surveillerait l’autre moitié qui travaillerait. Et même ainsi il n’y arriverait pas. Au bout d’un certain temps la classe ouvrière se rebellerait.
Arrêtons là cette critique a priori, car il est impossible que les socialistes pensent ainsi. Cependant on pourrait arriver à cette conclusion si on acceptait, même dans le secteur de la production, sur le terrain économique, le concept de l’organisation et de la discipline dictatoriale du travail. C’est pourquoi il nous semble impossible que Lénine et ses partisans interprètent la discipline dans le sens strict de soumission de la classe travailleuse à l’autorité centrale du gouvernement, à la considérer, en somme, comme une armée contrainte à obéir aux commandements de ses chefs sans les discuter.
En ce qui concerne le travail, il est probable qu’ils veulent dire que dans chaque lieu de production les ouvriers doivent être organisés afin d’obtenir le maximum de production avec un minimum d’effort et de gaspillage de matériaux[119]. Et en cela ils auraient raison. Mais il faut noter aussi la tendance des socialistes à s’en remettre à la discipline extérieure, coercitive, à l’autorité des dirigeants non exclusivement techniques qui pourraient occuper demain dans les usines la place des actuels contremaîtres, directeurs, etc. Toutes ces innombrables petites « dictatures » au niveau des postes de production seraient toutefois infiniment moins pesantes (car plus faciles à être contrées par l’action directe des travailleurs) que la dictature étatique proprement dite. Mais même en cela nous pensons que les socialistes, s’ils insistaient, auraient tort. Nous-mêmes, dans le domaine restreint de l’usine, de l’entreprise industrielle ou agricole, des services publics, nous pensons qu’il est nécessaire, plus utile et moins nocif, de faire appel à la discipline morale de chaque individu, à l’accord entre les ouvriers sur la façon d’exécuter le travail, et finalement à leur reconnaissance spontanée de la plus grande compétence à diriger le travail. L’ingénieur, en ce sens, représente une autorité légitime sur les travailleurs, tout comme un médecin sur les infirmiers, mais à condition qu’une telle autorité ne s’exerce pas en dehors de sa compétence exclusivement technique.
Mais cet esprit de discipline morale, de self-governement comme disent les Anglais, se formerait spontanément avec une trop grande lenteur. Il est nécessaire, dès maintenant, de le créer, de le cultiver par la propagande, la discussion, la préparation d’abord mentale et ensuite matérielle, réalisées par les différentes formes de l’organisation libre de la classe ouvrière et des groupes révolutionnaires.
Certains, particulièrement impressionnés par les nouvelles en provenance de Russie sur les difficultés surgis avec la socialisation des terres, pensent que pour forcer les paysans au régime socialiste, pour vaincre leur attachement à la propriété privée de la terre, pour réaliser, même dans les campagnes, par amour ou par force le communisme, une autorité centrale coercitive, c’est-à-dire la dictature, doit être nécessaire.
Sans trop faire confiance aux nouvelles en provenance de Russie, car trop incertaines, et en répétant que les conditions de là-bas sont tout à fait différentes de celles de l’Europe occidentale, ces événements ne peuvent donc pas nous dicter une ligne de conduite pour chez nous. Le peu que l’on en sait semble bien confirmer une vieille idée anarchiste selon laquelle la violence révolutionnaire est nécessaire et utile pour vaincre l’organisation étatique et bourgeoise, pour détruire les actuelles institutions oppressives, pour briser les chaînes politiques et économiques, alors que, pendant l’œuvre de reconstruction, la violence devient nuisible à moins qu’il ne s’agisse de celle nécessaire à la défense du travail de reconstruction contre les attaques extérieures. C’est-à-dire, donc, que l’on ne pourra user utilement de violence contre ceux qui devraient être nos collaborateurs, nos coopérateurs dans la société communiste. Si on les oblige à collaborer par la violence, l’existence même de la nouvelle société serait en danger. En agissant de la sorte, nous construirions un édifice sur du sable, qui s’écroulerait à la première secousse.
l’État abattu et le capitalisme anéanti, la reconstruction pourrait être obtenue par la coopération volontaire, libertaire, par la persuasion et l’exemple, par des expériences toujours plus élargies et multiformes, et non obligatoirement standardisées. Nous ne pouvons pas prévoir dans quelle mesure cela peut se réaliser dès le premier moment, mais ce qui est certain, c’est que nous ne devons pas, dès maintenant, nous créer à nous-mêmes des obstacles artificiels. Il y en aura déjà qui surgiront inévitablement tout seuls. Evitons d’établir, en plus, un plan de reconstruction fixe, unique, à imposer par amour ou par force. Le but de la révolution est celui de nous délivrer de la tyrannie de l’État et de l’exploitation des patrons, de nous sauvegarder et de nous défendre contre les tentatives de création d’un nouveau gouvernement ou de nouveaux maîtres, d’éliminer toutes les institutions et d’empêcher l’événement qui cause ou permet à un seul homme de vivre en exploitant les autres, en les tenant à sa dépendance et en les faisant travailler pour lui.
C’est cela même l’important pour la révolution et pour le socialisme : personne ne doit plus être exploité, personne ne doit plus travailler pour un salaire ou être soumis à autrui. Cela obtenu, on sera déjà en régime socialiste. En ce qui concerne les différents systèmes pour organiser le travail, pour répartir les produits, etc., il serait erroné de vouloir imposer par la force un type unique d’organisation pour tout le monde. Nous sommes communistes parce que nous croyons que l’organisation est le type le plus parfait de socialisme réalisable qui puisse répondre aux multiples besoins de bien-être et de liberté de tous les hommes. Nous voudrions donc, pour nous, la liberté de nous organiser en communisme partout où cela sera possible et où nous trouverons des gens d’accord avec nous. Mais nous n’allons pas prétendre imposer aux autres notre système par la force. Nous sommes certains que notre exemple sera le meilleur des moyens pour persuader les autres de nous suivre, tout comme l’exemple des autres, par ailleurs, pourra nous servir à améliorer, modifier, perfectionner notre propre système.
Rien n’empêchera qu’à nos côtés, dans certaines branches de la production, pour certains types de consommation, on expérimente des systèmes différents, pourvu que pour nous et les autres règne un esprit d’entraide réciproque dans les échanges, les services communs, etc., et pourvu qu’aucun système ne permette une quelconque forme d’exploitation de l’homme par l’homme. Parmi les différents types d’organisation, il s’en trouvera certainement de plus ou moins centralisés suivant le type du travail, du service public ou des nécessités locales. Les systèmes et les organismes se modifieront au fur et à mesure, en suivant les expériences, et sur l’exemple de ceux qui se présenteront comme étant les meilleurs, c’est-à-dire les moins onéreux en travail, les plus utiles et les plus productifs pour tous.
Nous sommes persuadés que, même en régime complètement anarchiste où l’organisation de la production et de la consommation sur des bases communistes sera le type dominant et la règle générale, et justement parce qu’il s’agira là d’une règle libre et non imposée, rien n’empêchera (soit par la volonté des individus, soit par des nécessités particulières du milieu ou du travail) que des formes diverses d’organisation collectivistes, mutualistes, etc., continuent à subsister. Il pourra même subsister une quelconque forme de propriété individuelle, à la seule condition que cela n’implique pas l’assujettissement ou l’exploitation de qui que ce soit.
Cette nécessité de tolérance réciproque sera donc nécessaire en période révolutionnaire, mais entendons-nous bien, il doit s’agir d’une tolérance entre exploités, entre opprimés et travailleurs qui se sont libérés de leur joug, et non pas de tolérance envers les oppresseurs et les exploiteurs, et leurs tentatives iniques de reprendre le pouvoir et ses privilèges.
Parmi les travailleurs qui ont accédé à la liberté par la révolution, il faudra que, à partir des premiers moments et dès que les résistances étatiques auront été vaincues et que commencera la période de défense et de mise en ordre révolutionnaire, règne le plus grand accord possible. Accord qui ne doit pas être sacrifié à l’idée de contraindre par la force des classes, des groupes ou des individus déterminés du prolétariat, à se plier à un type unique d’organisation préparé à l’avance. Ils n’en voudraient pas, même si théoriquement il est excellent. Il faut surtout éviter de pareils actes d’autorité envers la classe des paysans la plus portée à les interpréter comme hostiles, la moins préparée et la plus réfractaire aux changements brusques, trop nombreuse aussi pour pouvoir maîtriser ou négliger son hostilité.
De toute manière, même si nous n’étions pas anarchistes et que nous n’étions pas conseillés par l’esprit de liberté, nous considérerions cette attitude comme très bonne et très opportune pour la révolution. La révolution doit à tout prix éviter toute sorte d’hostilités envers les masses populaires et fuir les occasions de semer les discordes. Elle doit réserver ses forces pour combattre les forces réactionnaires et contre-révolutionnaires. Se concilier la faveur et la sympathie de tous les courants populaires et prolétaires en leur laissant la liberté de se développer ou de faire des expériences (quand il ne s’agit pas, bien entendu, de véritables tendances réactionnaires partisanes de l’ancien régime, auquel cas elles sont à combattre car ennemies), voilà la tâche de la révolution. Et cette tâche libertaire est en contraste absolu avec la pratique dictatoriale, avec toutes tentatives de superposer à la révolution un État centralisé.
De quel point de vue se placent, donc, ceux qui affirment que les anarchistes ont raison en théorie mais tort en pratique (ce qui signifierait que la théorie est fausse !), et qui nous accusent de ne pas tenir compte du côté pratique des questions et de nous limiter seulement à des discussions doctrinales ? Justement, dans cette question de la dictature, théorie et pratique se trouvent parfaitement en accord. Cela démontre à l’évidence que l’anarchisme est une doctrine vitale, réaliste et idéaliste en même temps, la meilleure, et non seulement par sa vision de la société future, mais aussi comme guide pratique pour la conduite de la révolution.
Les masses paysannes de chez nous sont certainement plus susceptibles de comprendre les temps nouveaux que les Russes qui ont vécu parmi nous, mais elles ne le sont pas dans la même mesure que le prolétariat industriel des grandes villes. L’attachement à la terre est, chez le paysan, encore fort, ainsi que l’attachement à sa propriété, même si illusoire ou partagée comme pour les métayers. Comment doit-on agir face à cela ? Imposer par décret gouvernemental l’expropriation de la terre aux paysans, cela reviendrait à s’en faire des ennemis. D’après ce que l’on connaît sur la Russie, c’est une erreur de ce genre qui, tout au moins pendant les premiers temps, avant que les bolcheviks ne comprennent la nécessité de rebrousser chemin, a suscité tant d’hostilité contre le gouvernement de Lénine et a renforcé la contre-révolution. Mais laissons de côté la Russie et voyons ce qui pourrait se passer chez nous en Europe occidentale.
Au lendemain de la révolution, on se trouvera devant cet état de fait : là où il y a métayage, les métayers, une fois éliminé le patron, deviendraient les propriétaires uniques des terrains qu’ils cultivent. Les paysans, qui sont propriétaires du peu de terre qu’ils travaillent, resteraient exactement comme ils sont maintenant. Là où il y a de grandes propriétés, et où la terre appartient aux patrons mais est travaillée par des journaliers, ou bien n’est pas exploitée, ou est laissée en pâturage, se détermineront tout de suite deux faits : dans les régions les plus arriérées ou bien là où la tradition de la conquête de la terre persiste, tout spécialement dans le sud, les paysans envahiront les champs et se les partageront. Là où, en revanche, la « faim de terre » n’est pas ressentie ou moins, là où les masses paysannes sont plus modernes, là où se développent les organisations de résistance et les coopératives agricoles ; tout spécialement dans le nord, l’Émilie, la Romagne et un peu dans les Pouilles, les latifundia, les grandes propriétés terriennes, les vastes entreprises agricoles pourront immédiatement s’organiser d’une manière communiste.
Rien n’empêche que les choses restent dans cet état pendant toute la période révolutionnaire [120]. D’une part la petite propriété terrienne, même de formation récente, ne pourra causer aucun dommage à la révolution, au communisme des villes et des autres régions, du moment qu’elle n’aura aucun besoin d’ouvriers salariés, puisque se suffisant à elle-même. D’autre part, on ne trouvera plus de journaliers ou tout au moins de travailleurs salariés, soit parce qu’ils seront devenus des petits propriétaires, soit parce qu’ils seront absorbés par les entreprises communistes. Ce qui est important, c’est de donner à tout le monde l’assurance que le nouveau régime défendra la nouvelle situation contre toutes tentatives réactionnaires, et rien ne pourra être fait pour changer cette situation sans le consentement du peuple tout entier. Ce qui est important, c’est de guider les travailleurs de la terre, quelle que soit leur organisation, vers une culture intensive du sol, pour en tirer le maximum de produits indispensables à l’existence. L’important consiste aussi à fournir aux paysans, sans distinction et largement, afin qu’eux-mêmes fournissent largement aux populations des villes les produits de la terre, les matières premières comme l’engrais, les habits, les chaussures, les instruments agricoles de toutes sortes, depuis la plus simple charrue jusqu’aux machines les plus perfectionnées.
Si les organisations ouvrières des villes font cela, il ne sera pas nécessaire que des dictateurs imposent aux paysans le travail pour nous nourrir, et les paysans seront les meilleurs alliés de la révolution.
La victoire acquise, quand toutes les résistances bourgeoises auront été vaincues, au sein de la famille humaine qui en résultera il sera possible de discuter sur la meilleure conduite à tenir en ce qui concerne les terrains cultivables, en accord avec les paysans eux-mêmes. Nous ne doutons pas que ce sera l’exemple donné par les entreprises agricoles communistes qui peu à peu va convaincre tout le monde et permettre d’absorber progressivement les petites exploitations familiales héritées de l’ancienne société, ou formées pendant la première période révolutionnaire. On arrivera ainsi au communisme anarchiste.
Un ami auquel on avait soumis le dilemme cité par Malatesta (ou bien les choses sont administrées selon le libre accord des intéressés eux-mêmes, et alors c’est l’anarchie, ou bien elles sont administrées selon la loi faite par les administrateurs, et alors c’est le gouvernement ou l’État, et ce sera fatalement la tyrannie), nous avait répondu qu’il manque surtout l’essentiel : la faculté d’administrer. Mais, qu’est-ce qui peut conférer cette faculté ? Il ne suffit certainement pas, pour l’avoir, d’être les personnages les plus importants d’un parti, ni d’ailleurs d’être nommés députés ou commissaires du peuple. Il s’agit d’une faculté technique qui n’est pas un privilège des gouvernants, de même il n’est pas nécessaire d’être gouvernants pour l’exercer.
Certes, nous n’excluons pas les administrateurs techniques, mais à condition qu’ils soient choisis parmi les intéressés, donc compétents, et à condition aussi qu’ils administrent selon des pactes librement passés entre tous les intéressés eux-mêmes. Et il s’agira, en outre, de délégations de fonctions toujours révocables et non de délégations de pouvoir. Tant que cela ne sera pas réalisé, tant que les soi-disant administrateurs feront la loi à l’encontre des administrés ; tant, donc, qu’il y a aura des gouvernants, il n’y aura évidemment pas d’anarchie. Et si cela était (ce que nous n’excluons pas), ce sera aux anarchistes de propager leurs idées et de combattre afin que soit substitué à la loi coercitive le libre accord, sans pour autant devenir eux-mêmes des administrateurs gouvernants.
Du reste, aujourd’hui, ceux qui administrent pratiquement, ce ne sont pas les gouvernants. Ceux-ci, au contraire, gênent l’administration des services et de la richesse publique, mais ils commandent aux véritables administrateurs et infléchissent leurs tâches respectives à leur propre avantage. Est-ce que, dans une commune, le bureau d’état civil a besoin, pour fonctionner, du maire, du commissaire royal ou de l’inspecteur assermenté ? Est-ce que l’industrie et le commerce, les chemins de fer, les postes, les télégraphes, tous les services publics, sont administrés par le gouvernement ou par les ministres ? Les véritables administrateurs sont des fonctionnaires techniques exécutants, ignorés la plupart du temps, qui, pour ce qu’ils font d’utile et de nécessaire, ne tirent aucun avantage de leur position de fonctionnaires de l’État, et leur servilité ralentit la bonne marche du service.
De même, en ce qui concerne la gestion de la richesse privée, la fonction administrative la plus utile, celle qui soit réellement nécessaire, n’est certainement pas celle des actionnaires, des propriétaires, des banquiers, mais bien celle du personnel administratif de chaque service, de chaque usine, de chaque établissement, de chaque entreprise, employé ou salarié.
Or, pourquoi ne devrait-on pas bénéficier de leurs capacités administratives au sens libertaire, c’est-à-dire sans leur superposer des organes de coercition et de contrôle inutiles dans la pratique, sinon nocifs ?
Il est indéniable que jusqu’à ce que les intéressés, ou tout au moins un certain nombre d’entre eux, n’auront pas pris conscience de leurs besoins et de la meilleure façon de les satisfaire, de leurs droits et de leurs devoirs, l’avènement de l’anarchie sera impossible. Mais cette conscience ne peut pas se former sur commande ou en l’imposant par la force, mais en créant des conditions nouvelles grâce auxquelles il soit possible à une telle conscience de se former et de se développer. En régime de servitude, on ne peut pas former d’hommes libres, ou alors des petites minorités. Seule la liberté donnera la conscience libertaire à la grande majorité. Voilà pourquoi, pendant et après la révolution, on aura besoin d’un parti qui lutte essentiellement pour les libertés, qui conquière et qui défende le plus grand nombre possible de libertés pour tous.
Certes, la liberté n’est pas le seul et unique problème social important, nous n’oublions pas les autres non plus. Cependant, celui de la liberté reste tout de même un des plus importants, et même, après celui du pain, il nous apparaît comme le plus important de tous. On pourrait même soutenir que la question de la liberté vient en première ligne, si l’on envisage que le salariat est comme une forme d’esclavage où les patrons sont, en somme, les oppresseurs, les ennemis de la liberté des ouvriers qu’ils exploitent. Si nous étions libérés de l’oppression étatique, si le gouvernement ne nous empêchait pas toute liberté de mouvement, nous aurions vite fait de nous débarrasser de toutes les autres formes d’oppression et de résoudre tant d’autres problèmes. Il ne serait pas difficile de démontrer que chaque problème social ne se réduit, en dernière analyse, qu’à une question de liberté. D’ailleurs, Sébastien Faure l’a démontré il y a environ vingt-cinq ans dans un livre célèbre [121].
Mais cela importe peu, il est vrai aussi que dans l’état actuel des choses, les hommes savent bien où est leur intérêt. Mais pour qu’ils le comprennent, il leur faudrait de l’expérience en la matière. Mais si on leur choisit des personnes qui les gouvernent et qui prévoient pour eux, comment pourraient-ils faire cette expérience ? On dit que pour les imbéciles et les ignorants, la science elle-même sera une tyrannie. Mais qui sera le représentant de cette science qui pourra être autorisé à imposer sa tyrannie ? Est-ce que la possession de la science suffit à rendre honnête celui qui la possède, à le rendre désintéressé, à empêcher qu’il se serve de sa science et en même temps du pouvoir, pour servir son intérêt aux dépens de la collectivité ? Si aujourd’hui les vérités les plus évidentes de la science ne sont pas acceptées de bon cœur ni reconnues par tous ceux qui y auraient le plus d’intérêt, cela n’est pas dû à leur esprit inné de contradiction, mais à cause de la façon avec laquelle on voudrait les leur imposer. Et aussi aux conditions ambiantes, politiques et sociales, qui les empêchent de comprendre et de les accepter.
Par exemple, pour convaincre les personnes habituées à vivre dans des taudis à changer de maison, il ne suffit pas que le médecin et l’architecte émettent l’opinion de la nécessité de 1 hygiène. Il faudrait avant tout construire des maisons saines et propres, il faudrait enlever aux riches l’usage superflu des neuf dixièmes de leurs palais et de leurs villas, et on verra les pauvres gens entassés dans les bidonvilles passer sans difficultés dans les nouvelles habitations. Ils savent qu’ils y trouveront de plus grandes possibilités de vivre plus proprement. Pour en être persuadés, il suffirait de visiter les vieux quar tiers des villes où la population ouvrière vit entassée, et ensuite es quartiers nouveaux de beaucoup de villes, constitués de maisons et de maisonnettes ouvrières construites (soit par l’initiative privée, coopérative ou communale) selon les normes et selon les règles de l’hygiène, dotées de certaines commodités, même modestes. On verra tout de suite que ces quartiers marquent un immense progrès par rapport aux premiers, en ceci que leurs habitants semblent se trouver sur un niveau plus élevé de civilisation, de propreté, e décence et d’ordre.
Il va de soi que pour la construction des maisons il faut des architectes et des hygiénistes, et non pas n’importe qui, car alors les maçons travailleront selon les normes données par des techniciens et non pas selon celles d’un quelconque manœuvre. Supposer que les choses ne se feront pas ainsi par le seul fait qu’il n’y aura pas de gouvernement est une sottise. Dans chaque administration, la qualité première des administrateurs est la capacité technique, mais cette capacité n’a rien à voir avec le fait de commander, gouverner, imposer avec la violence ou la menace. Même lorsqu’il s’agira de faire triompher le système le plus juste et parfait (quand il ne s’agit plus de détruire mais de reconstruire et qu’il faut le consensus général) il ne faudra plus compter que sur la persuasion qui procédera de la propagande et de la libre expérimentation des différents types d’organisation.
Dans les usines tout comme dans les campagnes, dans les services publics ainsi que dans les organisations, les conseils d’usine et les soviets pourront réaliser la coordination du travail libre. Les conseils d’usine assureront l’autogouvernement de l’usine et de l’entreprise, et les soviets l’organisation de la production ainsi que de la distribution, selon les besoins et les conditions particulières locales, régionales et inter-régionales.
Au début de la révolution russe, on a beaucoup parlé des conseils d’usine, et cela a même éveillé en Italie le désir de les imiter. Mais on en parle beaucoup moins depuis quelque temps déjà, c’est-à-dire qu’on parle seulement et de façon très vague d’ailleurs des soviets qui sont une toute autre chose. Il y a quelque temps, les journaux bourgeois avaient diffusé une nouvelle selon laquelle Lénine aurait aboli les conseils d’usine, coupables d’avoir acculé l’industrie russe à la ruine. Mais étant donné que certains journalistes avaient fait une confusion entre les conseils d’usine et les conseils d’ouvriers et de paysans (soviet), le gouvernement russe avait démenti l’abolition de ces derniers. Des conseils d’usine proprement dit, on n’en parla pas, pourtant un renseignement précis à cet égard aurait été plus que nécessaire [122].
L’Avanti ! avait seulement démenti, d’une façon très vague, la suppression du droit de grève, mais d’une telle manière qu’indirectement il en donnait confirmation. Il affirmait, en effet, que si la grève est légitime en régime patronal, elle devient une faute grave en régime prolétarien et communiste. C’est un raisonnement très dangereux, car toutes les tyrannies s’appuient, pour soutenir leurs raisons d’être, sur des considérations d’intérêt général et elles trouvent que la révolte est légitime lorsqu’elle est dirigée contre un autre pouvoir que le leur.
Quoi qu’il en soit, nous sommes convaincus que les conseils d’usine et les soviets restent les seules institutions capables d’obtenir, pour chaque type de travail et chaque système de production, le meilleur rendement possible. Et c’est pour cela même qu’ils sauront assurer la transmission, la correspondance et l’échange avec les autres localités où l’on expérimente d’autres systèmes. En un mot, ces nouveaux organes révolutionnaires dans les campagnes et dans les villes assumeront la tâche de faciliter l’accord mutuel en ce qui concerne la production, de façon à éliminer tous les obstacles et les dissensions qui pourraient rendre le travail trop désagréable ou moins spontané.
A propos des soviets, puisqu’on en parle, il faudrait clarifier une équivoque qui les concerne. Certains croient que dictature et organisation sur la base des conseils ouvriers sont la même chose. C est une erreur. Apparemment ils peuvent au moins coexister, ainsi d ailleurs qu’il semblerait que ce soit le cas en Russie quand les conseils d’ouvriers sont formés en majorité par des autoritaires qui sentent le besoin d’être gouvernés et dirigés par un pouvoir central. Mais ce pouvoir central, ou dictature, non seulement n’est absolument pas nécessaire à l’existence, à la vitalité et à l’action des conseils, mais il finit par limiter toutes leurs fonctions et influences et en fait des instruments du pouvoir. Un peu, en somme, comme chez nous les conseils communaux et provinciaux, ou le parlement sous la dictature militaire et bourgeoise. Et tout cela simplement parce que celui qui détient le pouvoir armé détient le gouvernement, et donc subordonne tous les autres organismes.
Bien sûr ! On dit que le pouvoir des dictateurs est révocable par les électeurs ou par les conseils ouvriers, mais c’est un droit nominal illusoire. En effet, le pouvoir comme tel trouve toujours un moyen de se faire confirmer ou de rester malgré les révocations, de gré ou de force. Il vaudrait donc mieux que les conseils ouvriers ne se donnent aucun gouvernement et demeurent contre celui-ci. D’autre part, il serait peut-être bon de rappeler que si les conseils ouvriers sont une excellente chose, ils ne représentent cependant pas à eux seuls toute la vie de la révolution et de la société, et que donc, même s’ils venaient à abandonner leur autonomie dans les mains d’un gouvernement, il resterait tout de même la partie vraiment vivante de la révolution, la partie libertaire qui assurerait l’opposition.
Tant qu’il n’y aura pas de liberté pour tout le monde, la condition principale et indispensable de tout progrès sera l’opposition au gouvernement, l’opposition à l’autorité. En revanche, toute prétention autoritaire et coercitive plus ou moins légalisée tend à arrêter le progrès, y compris le progrès économique de la production.
Un État dictatorial qui imposerait autoritairement un type unique de communisme créerait, d’une part des courants contraires à la révolution et pourrait même la mener à la faillite, et d’autre part il nous conduirait au communisme d’État, autrement dit à la naissance d’un patron unique qui assumerait à lui seul les deux actuelles tyrannies du gouvernement et de la propriété. Dans la meilleure des hypothèses, il nous porterait donc vers un but tout à fait à l’opposé de celui de l’anarchie.
La défense de la révolution
Une des plus graves difficultés qui puisse faire obstacle au développement d’une révolution, quand elle éclate dans un seul pays, aussi vaste fut-il, est représentée par l’hostilité des gouvernements bourgeois étrangers, et tout spécialement lorsque celle-ci se manifeste par une véritable guerre armée, des tentatives d’étouffer la révolution ou l’invasion armée des territoires insurgés.
Il est évident qu’à ce moment-là il faut défendre le territoire de la révolution, militairement si nécessaire. Tant que cette nécessité se fera sentir, il faudra qu’il y ait une armée et tous les organismes qui s’y rattachent. Tous les principes anarchistes sont en criante contradiction avec cela, non pas, entendons-nous bien, parce qu’il s’agit là de moyens violents, mais parce qu’ils le sont d’une manière plus ou moins gouvernementale. Donc, tant que cette nécessité durera, il sera peut-être impossible de réaliser un ordre social vraiment anarchiste, tout au moins pendant les premiers moments. Il reste donc que cette nécessité représente un frein à la révolution, et tant qu’elle subsistera la révolution ne pourra pas se développer et subira forcément un arrêt.
De ce point de vue, la guerre que les bourgeois, sans même l’avoir déclarée mènent contre la Russie se révèle, pour la révolution, doublement dangereuse. Directement par la tentative de l’intervention extérieure armée et du blocus économique, et indirectement en contraignant les révolutionnaires à se défendre militairement, et donc à utiliser des moyens contraires à leur propre nature. Ainsi la guerre engendre le danger militaire à l’intérieur et elle oblige la révolution à s’autolimiter, à un arrêt de développement que nous espérons provisoire, mais qui pourrait aussi bien devenir plus ou moins définitif.
De toute façon, l’exemple de la Russie et de presque toutes les révolutions précédentes démontre que la menace d’une intervention militaire de l’extérieur est une éventualité dont il faut tenir compte. En admettant que la révolution soit dans l’obligation de se défendre, le problème de la dictature se présente en ces termes : la concentration des pouvoirs les plus absolus dans les mains d’un gouvernement dictatorial est-elle nécessaire pour la défense du pays en révolution ? Ou bien serait-il plus utile (même sous la menace extérieure) de laisser le maximum possible de liberté, le maximum d’autonomie aux organismes et aux localités ? Il va sans dire que nous penchons pour cette deuxième hypothèse. Nous sommes convaincus de sa justesse, non pas à cause d’un a priori dogmatique, mais à cause de l’enseignement que nous ont laissé les révolutions passées et d’un examen objectif des conditions pratiques dans lesquelles se trouvera la révolution prolétarienne.
Pour se défendre des périls intérieurs, seule l’action directe et libre du peuple sera garante d’efficacité inexorable. Lorsque, en 1792, les armées de la réaction européenne envahirent la France pour étouffer la révolution et rétablir le pouvoir monarchique, les armées françaises, au début, furent battues. La victoire leur a souri quand les soldats furent convaincus de défendre réellement la révolution, c’est-à-dire après avoir appris que la libre action directe du peuple parisien avait défait, le 10 août, les nobles enfermés dans les Tuileries et mis sous clé la famille royale (« le loup, la louve et le louveteau ») et qu’en septembre cette action avait littéralement balayé tous les ennemis de l’intérieur qu’elle avait réussi à appréhender. Le gouvernement révolutionnaire n’aurait jamais pu faire cela. Ce qu’il faut donc, avant tout à l’intérieur, c’est laisser au peuple la liberté d’exterminer ses ennemis et non pas centraliser cette tâche dans les mains du gouvernement.
Même pour la coopération active dans l’œuvre de défense militaire, il serait plus utile de confier au peuple certaines tâches pouvant être accomplies en toute liberté qu’aux engrenages gouvernementaux, aux centralisations dictatoriales, aux concentrations bureaucratiques, qui neutralisent les efforts et les volontés, gênent les services, gaspillent, détériorent, et détruisent matériel, ravitaillements, vivres, etc. Nous avons eu un exemple de ce type pendant la dernière guerre, au terme de laquelle les États battus ont été justement ceux qui étaient les plus centralisés (Russie, Allemagne, Autriche) et fournis des plus parfaits mécanismes bureaucratiques et dictatoriaux. Pendant la guerre, on a pu lire un peu partout que les services d’État étaient ceux qui fonctionnaient le plus mal et qui coopéraient le moins à la victoire nationale. Alors que, au contraire, là où les libres initiatives privées et les efforts collectifs populaires avaient lieu, cela se traduisait par une coopération même indirecte à la victoire militaire, même si les gens en fin de compte n’étaient guidés que par la nécessité de se sauver de la famine et d’éviter la catastrophe d’une invasion. Or, si cela se produisait inconsciemment pour une guerre à laquelle le peuple était hostile, combien aurait-il mieux fait s’il avait eu l’intention de défendre ses intérêts, la cause de son émancipation et sa liberté ?
Bakounine s’est préoccupé aussi, en son temps, de la nécessité de défendre le territoire en révolution contre les invasions étrangères de la réaction internationale. Il avait eu l’exemple de Sedan, en 1870. Le peuple français avait renversé Napoléon le petit et proclamé la république, mais s’était trouvé dans l’obligation de sauver sa liberté à peine conquise contre les armées allemandes victorieuses. Dans son texte : L’Empire knouto-germanique et la Révolution sociale, Bakounine soutenait que le seul statut pour la France consistait à transformer la révolution politique en révolution sociale, en donnant au peuple le maximum de libertés et au prolétariat la sensation qu’il aurait combattu pour une patrie qui était réellement devenue la sienne.
Naturellement, Bakounine ne dissimulait pas la nécessité, pour la défense militaire de la révolution, d’une certaine discipline et même d’une certaine autorité hiérarchique dans les milices.
Mais il se gardait bien de sacrifier à cette nécessité le principe même de la liberté, c’est-à-dire un des ressorts les plus puissants de la révolution, un des coefficients les plus efficaces de la victoire contre les ennemis extérieurs eux-mêmes.
« Amant passionné de la liberté, j’avoue que je me défie beaucoup de ceux qui ont toujours le mot « discipline » à la bouche. Il est excessivement dangereux surtout en France, où « discipline », pour la plupart du temps, signifie d’un côté « despotisme » et de l’autre « automatisme ». L’étonnant esclavage que la société française endure depuis qu’elle a fait sa grande révolution procède en grande partie du culte de la discipline de l’État, légué par Robespierre et les jacobins. Ce culte, vous le retrouverez en entier dans tous vos républicains bourgeois, officiels et officieux, et c’est lui qui perd la France aujourd’hui. Il la perd en paralysant l’unique source et l’unique moyen de délivrance qui lui reste : le déploiement libre des forces populaires ; et en lui faisant chercher son salut dans l’autorité et dans l’action illusoire d’un État, qui ne représente plus rien aujourd’hui qu’une vaine prétention despotique, accompagnée d’une impuissance absolue.
« Tout ennemi que je sois de ce qu’on appelle en France la « discipline », je reconnais toutefois qu’une certaine discipline, non automatique, mais volontaire et réfléchie, et s’accordant parfaitement avec la liberté des individus, reste et sera toujours nécessaire, toutes les fois que beaucoup d’individus unis librement entreprendront un travail ou une action collective quelconque. Cette discipline n’est alors rien que la concordance volontaire et réfléchie de tous les efforts individuels vers un but commun. Au moment de l’action, au milieu de la lutte, les rôles se divisent naturellement, d’après les aptitudes de chacun, appréciées et jugées par la collectivité toute entière : les uns dirigent et commandent, d’autres exécutent les commandements. Mais aucune fonction ne se pétrifie, ne se fixe, et ne reste irrévocablement attachée à aucune personne. L’ordre et l’avancement hiérarchique n’existent pas, de sorte que le commandant d’hier peut devenir subalterne aujourd’hui. Aucun ne s’élève au-dessus des autres, ou s’il s’élève, ce n’est que pour retomber un instant après, comme les vagues de la mer, revenant toujours au niveau salutaire de l’égalité. »[123]
Cela doit être ainsi, en ce qui concerne soit le gouvernement civil, qu’il faut réduire le plus possible, soit le gouvernement militaire et de défense. A ce propos, d’ailleurs, il serait bon de rappeler l’opinion d’un autre expert qui, tout en étant socialiste à tendance libertaire, fut aussi un militaire de profession, observateur et connaisseur des choses militaires et de guerre, ayant étudié l’art de la guerre dans les livres et sur les champs de bataille, en participant aux révolutions et aux guerres de 1848–1849. Il s’agit de Carlos Pisacane, un praticien plus qu’un théoricien de la révolution.
Après avoir étudié les guerres de ces années-là, il était arrivé à la conclusion selon laquelle les masses ne réaliseront pas directement le concept de révolution : « Le gouvernement issu de la révolution ne fera que se substituer à l’ancien, et combattra la révolution si elle n’est pas en harmonie avec les idées de ceux qui le composent. » [124] Après avoir dit dans un autre essai sur la Rivoluzione que la « dictature, source de tous les maux et impuissante à produire le bien, est aussi impuissante à diriger la guerre » (et il fait suivre cette affirmation par une longue démonstration)[125], il revient sur le même argument dans un autre livre qui a été trop oublié, et dédié exclusivement à des questions militaires.[126]
Nous ne pouvons pas discuter ici de la façon technique d’organiser les milices de défense de la révolution dans un régime de liberté, parce qu’il nous manque la nécessaire compétence. Il serait pourtant utile que cette question aussi soit étudiée « avant » au lieu de remettre le tout, par commodité, à ce que pourra en faire la non souhaitable dictature ou bien à ce qu’improvisera le peuple. Ceux qui se penchent sur cette question pourraient lire avec profit le livre de Pisacane qui expose un projet technique et pratique de très grande valeur.
Naturellement, Pisacane parlait surtout d’une révolution nationale, et donc différente de celle que nous souhaitons. En plus, les temps ont changé, et encore plus changé les moyens de défense et d’offensive, que ce soit pour une révolution ou bien que ce soit pour une guerre. Mais il se nourrissait d’un vif sentiment de liberté, et de plus il ne concevait une révolution nationale italienne qu’à caractère prolétarien greffé sur un mouvement social et anticapitaliste. En ce domaine, donc, on peut dire que Pisacane était un précurseur qui s’adresse à nous aussi. En ce qui concerne les moyens matériels, aujourd’hui si différents, ce n’est pas à eux que nous pensons lorsque nous parlons d’une organisation de la défense armée plus adaptée à un régime de liberté, mais à un matériel humain qui est à peu de chose près le même qu’il y a cinquante ou soixante ans.
Il est certain que le projet de Pisacane, dans les détails, ne peut pas être exempt d’erreurs inutiles à énumérer, qui pouvaient aussi bien d’ailleurs ne pas en être de son temps. Mais ce qui est important pour nous, c’est sa démonstration qu’une bonne défense armée de la révolution est incompatible avec un régime dictatorial :
« Dire aux habitants d’une ville : reconnaissez un tel comme étant votre chef, délimiter l’étendue d’un soulèvement, signifie tout perdre et c’est une preuve de manque de bon sens. Et c’est bizarre que justement ceux qui ne parlent que d’élan et d’exaltation populaire prétendent ensuite que tout se plie à leur volonté suprême : pour eux le peuple n’est que le peuple qui obéit… Sots ! L’ennemi chassé, la ville libérée, les citoyens fêtent la victoire et s’endorment sur leurs lauriers… et ayant élu un gouvernement, lui confient le soin de tout prévoir et tout organiser. Sans se soucier d’autre chose, ils ne s’occupent que de la défense… Et pendant ce temps le gouvernement s’emploie à nommer les généraux, à mettre sur pied l’armée, à choisir les chefs parmi les amis… Et c’est ainsi que meurent misérablement les révolutions. Pour leur redonner la vie, il n’existe d’autres moyens que de tenir les peuples en haleine, et ne pas abandonner le destin dans les mains des dictateurs… Sans attendre la sentence des dictateurs ou bien consulter le bon vouloir de tous ceux qui, en pareilles circonstances, n’ont que l’appétit de gouverner, l’ordre militaire, tout aussi bien que le civil, naîtront des profondeurs mêmes de la nation. L’unité résultera précisément de l’application de la loi souveraine : liberté absolue [127]. »
Pisacane conseille que la conduite des opérations militaires soit indépendante du pouvoir politique, que les forces armées ne soient jamais supérieures au strict nécessaire suivant les frontières qu’il faut défendre [128], que les hiérarchies et les grades soient limités au strict nécessaire et représentent une véritable diversité de fonction, que les miliciens soient convaincus que la cause pour laquelle ils combattent est bonne, que les officiers soient librement élus par ceux qui les proposent, que les intérêts mêmes des miliciens soient étroitement liés à tous ceux de la collectivité, et que leur utilité dépende non pas de leur condition de soldats mais plutôt de leur condition de citoyens, que l’unité d’action soit réalisée non pas par l’autorité des chefs, mais par la manière d’instruire les troupes, au point de pouvoir transformer l’ignoble dogme d’obéissance aveugle en conviction profonde [129].
On pourrait citer d’autres moyens capables de freiner la tendance des chefs militaires à étendre leur autorité, et même à la dépasser, au risque de nuire à la révolution, comme par exemple le système adopté d’une certaine manière pendant la révolution française (loué par Mazzini lui-même) de déléguer des commissaires civils représentants de la révolution parmi les troupes. Mais il ne faut pas qu’ils soient envoyés par un gouvernement central, mais par les libres communautés, par les communes révolutionnaires, parmi les soldats qu’elles-mêmes ont fourni. Afin que les soldats de la révolution se sentent toujours soutenus par la solidarité de tout le pays et que cette surveillance exercée par le peuple freine d’éventuelles envies autoritaires et liberticides, qui pourraient se développer chez quiconque, pour un quelconque motif, est investi d’un pouvoir supérieur à celui des autres.
Mais il est inutile, je pense, de nous arrêter à ces détails (dont nous avons parlé seulement pour donner une idée de ce que nous pensons) car dans cette direction il ne sera pas possible non plus d’obtenir la perfection puisque tant bien que mal il s’agirait d’une direction autre qu’anarchiste. Certains défauts, prévisibles pour le lecteur anarchiste, pourront être éliminés, certaines dissonances harmonisées, mais il restera toujours quelques contradictions qu’il faudra subir comme des cas de force majeure. Mais adopter par nécessité certaines mesures autoritaires, choisies parmi les moins autoritaires et en en limitant le plus possible le pouvoir est une chose ; choisir parmi les possibles mesures justement la plus autoritaire et la plus tyrannique qui soit – comme la dictature – et la présenter aux masses comme un idéal a priori à réaliser est une autre chose.
En outre, il ne faut pas négliger dans la propagande l’élément psychologique. Les socialistes, en suggérant au peuple que la meilleure façon d’asseoir sa liberté consiste à installer la dictature (contre laquelle de toute manière, même si elle était nécessaire, il faudrait tenir éveillée la méfiance prolétarienne), courent le risque de préparer le terrain aux ennemis du peuple et de la classe travailleuse, car il se pourrait qu’un jour, au lieu de la dictature du prolétariat, on subisse la dictature du militarisme. Nous espérons être de mauvais prophètes !
Bien qu’une défense militaire anarchiste de la révolution nous semble un peu difficile, elle n’est toutefois pas à exclure. D’ailleurs, une revue pleinement favorable à la dictature prolétarienne parlait, il y a quelque temps, de la résistance opposée en Ukraine à Dénikine par le général anarchiste Makhno, une des personnalités les plus remarquables du pays (c’est ainsi que s’exprimait ce journal) qui exerce sur les masses un grand ascendant.
« Anarchiste militant, ennemi de toute dictature centralisatrice même dans le domaine militaire, on comprend qu’il suscite l’animosité de Trotsky, qui ne veut pas collaborer avec les « volontaires ». Cependant Makhno possède une âme ardente et sincère, du reste il est complètement dévoué au régime des soviets, mais basé sur la décentralisation régionale. La révolution lui doit beaucoup. Peut-être que, grâce à lui, l’Ukraine toute entière sera soviétique avant le printemps [130]. »
Makhno est le chef des bandes qui se sont insurgées contre la politique agraire du parti communiste, inspirée par un programme qui n’est pas adapté aux conditions du pays. Les bolcheviks n’en ont pas tenu compte et se sont mis à dos la plus grande partie de la population. Cela semblerait confirmer ce que l’on a déjà dit à propos de la question des rapports entre les révolutionnaires de l’industrie citadine et les masses paysannes. Ces bandes elles-mêmes qui hier étaient contre-révolutionnaires car anti-bolcheviques sont devenues par la suite la plus formidables des menaces dans le dos de Dénikine et Wrangel, et favorisèrent les opérations de l’Armée rouge.
Quoi qu’il en soit, nous comprenons très bien qu’après la révolution il puisse s’installer sur le territoire un régime non anarchiste, et même pour le moment c’est ce qui semble le plus probable. La majorité des travailleurs qui participerait à un tel mouvement semble en effet plutôt favorable à un régime socialiste républicain, tandis que le prolétariat anarchiste constitue encore une minorité. Il faut compter aussi sur l’influence de facteurs divers et extérieurs, parmi lesquels l’éventualité d’attaques militaires de la part de gouvernements bourgeois étrangers. On a beau vouloir donner à la révolution une certaine direction, celle-ci par la force des choses, à cause des circonstances imprévues, par la volonté contraire des masses, etc., peut toujours prendre un chemin moins bon.
Mais dans pareil cas, est-ce que les anarchistes devront se mettre contre la révolution ou alors, indignés, refuser le concours de leurs forces à la défense de la révolution seulement parce qu’elle n’ira pas tout à fait dans la direction que nous souhaitons ? Nous pouvons, mieux nous devons, nous refuser à contribuer aux erreurs des autres, mais notre devoir de combattants contre l’État bourgeois, le capitalisme, leurs vestiges, pour l’expropriation et la liberté, est un devoir que nous devons accomplir avec d’autant plus d’énergie que nos idées sont avancées et intransigeantes. Pour les anarchistes, le devoir de défendre la révolution, malgré la direction étatique qu’elle a prise et malgré ses méthodes, est un devoir strict et ils doivent défendre la révolution contre ses ennemis de l’intérieur comme ceux de l’extérieur.
S’absenter, refuser d’accomplir le suprême devoir de la défense de la révolution, signifierait en réalité se trahir soi-même, car en définitive on obtiendrait une révolution encore moins radicale et encore moins libertaire. N’importe quel gouvernement issu de la révolution sera d’autant moins oppressif et autoritaire que les libertaires, c’est-à-dire les défenseurs de la liberté, auront été et resteront les défenseurs de la révolution sur tous les fronts. La révolution sera d’autant plus animée d’un esprit égalitaire qu’il y aura dans le pays des forces d’opposition libertaires et ultra-révolutionnaires qui défendront la révolution même contre les ennemis de son intégrité. Et il y aura d’autant plus de libertés acquises qu’il y aura un grand nombre de groupes, d’associations et d’institutions, qui revendiqueront la liberté de gérer elles-mêmes leurs propres intérêts et d’organiser librement leurs rapports avec le reste de la société.
On pourrait objecter que cette résistance au pouvoir pourrait favoriser les tentatives contre-révolutionnaires de l’intérieur aussi bien que de l’extérieur, affaiblir la position générale et la défense militaire de la révolution. Dire cela signifie tout simplement n’avoir rien compris au caractère et à l’esprit de l’opposition antigouvernementale des anarchistes. D’autre part, l’absence d’opposition au gouvernement pourrait très bien provoquer sa dégénérescence jusqu’à devenir lui-même le centre de la contre-révolution crainte. Mais, même si cela n’était pas le cas, on doit comprendre que l’opposition anarchiste s’opérerait dans un sens toujours plus révolutionnaire, c’est-à-dire tendant à frapper avec une énergie et une intransigeance toujours plus grandes les restes du passé. Le fait d’être dans l’opposition n’empêcherait pas les anarchistes (au contraire !) de combattre sur le terrain de l’action, en accord avec les forces révolutionnaires de toutes sortes, contre la réaction bourgeoise de l’intérieur et de l’extérieur.
Il est d’usage, entre anarchistes, depuis Bakounine, de dire que la révolution sera anarchiste ou ne sera pas, mais certains comprennent cette formule d’une manière énoncée comme si elle signifiait que la révolution devrait avoir un caractère anarchiste sinon, dans le cas contraire, on n’a pas à s’en occuper. Mais il n’en est pas ainsi. Bakounine voulait dire que la révolution, pour réussir, nécessite que toutes les forces populaires se déchaînent, sans freins ni contraintes, partout et par tous les moyens. C’est ainsi, en effet, qu’aura lieu le premier mouvement insurrectionnel. Si on perdait du temps à ordonner, à contrôler, si partout on attendait les ordres des chefs ou bien d’un centre, il est presque certain que la réaction réussirait à l’emporter. Le triomphe de la révolution ne sera assuré que si l’initiative révolutionnaire se développe librement dans tous les points du territoire, en attaquant directement les organismes autoritaires, et si, aussitôt ceux-ci abattus, on passe à l’expropriation.
Certes, le concours des forces organisées, ordonnées, mobiles, guidées par des chefs, sera extrêmement utile. Mais ces forces à elles seules sont insuffisantes, elles arriveraient toujours trop tard [131] si, au préalable, l’action anarchiste plus ou moins formellement indisciplinée mais rendue unanime par une discipline interne solide née de l’unité affinitaire n’aura pas vaincu les premières résistances, déblayé le terrain des opérations, empêché par son assaut soudain et général, aux forces ennemies de se rassembler, de s’entendre, de se coordonner. En ce sens aussi, donc, l’action anarchiste, entendue non seulement dans le sens du parti, mais aussi dans un sens plus général, a sa fonction imprescriptible dans la défense de la révolution. Si elle renonce à cette fonction pour se laisser encadrer dans une armée en attente des ordres des chefs, elle risquerait de laisser échapper la victoire.
La révolution, donc, même si elle ne sera pas anarchiste dans le sens où nous l’entendons, ne cessera pas pour autant d’être une révolution, mais cela ne nous empêchera pas d’y prendre part. Mais qu’elle soit plus ou moins anarchiste ou autoritaire, il est certain que la révolution aura d’autant plus de chances de gagner qu’elle sera anarchiste, donc plus complète. Il est donc du devoir des anarchistes d’impulser à la révolution une direction la plus anarchiste possible.
Si l’anarchie ne surgit pas de la révolution, il est à prévoir que s’installera une république socialiste. Mais la forme politique finalement importe peu, ce qui compte c’est son essence. Or, de la révolution naîtra une forme de gouvernement d’autant plus faible et donc d’autant moins oppressive que la révolution elle-même aura été plus radicale et que nous y aurons participé en apportant notre ardent esprit de liberté, en détruisant toutes les survivances autoritaires possibles, et en réalisant, autant que nous pourrons, des organisations autonomes dans la vie collective. Mais même au sein d’un régime non anarchiste, nous devrons essayer de réaliser autant d’« anarchie » que nos forces nous le permettent.
L’action précise des anarchistes pour la défense de la révolution sera celle-ci. De cette tâche et de son importance ne se rendent pas compte ceux à qui suffit l’hypothèse que l’anarchie ne peut pas naître de la révolution, pour en déduire que nous devrions… provisoirement y renoncer et devenir nous aussi partisans du nouveau gouvernement et peut-être en faire partie ! Il est possible que de la révolution naisse un gouvernement bourgeois, mais cette éventualité ne nous empêchera pas de participer tout de même à la révolution. Mais est-ce là une raison pour que, les choses une fois terminées, nous soyons partisans et coopérateurs du nouveau régime ? On comprend aisément que cela est impossible. Nous serons toujours dans la même situation d’opposants, jusqu’à ce que de la révolution naisse un régime anarchiste.
De toute façon, il n’est pas impossible non plus que la révolution se réalise dans un sens libertaire, à condition qu’il y ait suffisamment de gens convaincus et disposés à lui imprimer cette direction. Aujourd’hui, dans une période de propagande et de préparation révolutionnaire, cette propagande et cette préparation ne peuvent avoir d’autre direction que celle anarchiste, cela dans le but d’augmenter le nombre de convaincus et de diffuser dans les masses l’esprit libertaire. S’il en est ainsi, il est fort possible que, lorsqu’elle éclatera, la révolution puisse évoluer dans le sens que nous souhaitons ou tout au moins en grande partie. Mais si nous commencions, dès aujourd’hui, ainsi que le voudraient certains de nos amis socialistes, à proclamer qu’il faut un gouvernement pour la révolution, voire même une dictature, nous aiderions à créer ou à augmenter artificiellement cette nécessité et nous propagerions dans les masses un esprit contraire à nos idées et à l’intérêt de la révolution.
Il nous faut donc, dès aujourd’hui, largement propager les idées et les sentiments qui donnent un esprit et une direction anarchiste à la révolution, et pendant la révolution nous devrons revendiquer le droit d’appliquer cette direction, ne serait-ce qu’en tant que minorité. Ce sera la meilleure défense que nous puissions offrir à la révolution.
Nos idées, notre conception de la future organisation sociale, notre critère sur le développement de la révolution, nous imposent une ligne déterminée de conduite même dans l’éventualité probable de l’établissement d’un nouveau gouvernement en période révolutionnaire, qu’il soit libre sous forme de république sociale de type fédéraliste, ou bien qu’il soit autoritaire et centralisateur ainsi que le souhaitent les partisans de la dictature prolétarienne.
Cette ligne de conduite, qui sera en même temps révolutionnaire et anarchiste, est implicitement inclue et expliquée dans tout ce que nous avons dit jusqu’ici, et elle a été explicitement exposée quand nous avons admis l’hypothèse de la nécessité d’une défense militaire de la révolution, et donc d’une quelconque forme d’autorité et d’un minimum inévitable d’institutions gouvernementales. Nous préférerions, c’est évident, que cette hypothèse ne se réalise pas, t nous devons, pour cela, nous mettre au travail dès maintenant pour l’éviter. Mais si elle se réalisait, ce serait à l’encontre de tous nos désirs et nos efforts, par majorité d’oppositions, par circonstances de force majeure ou à cause d’événements imprévus. Mais, par rapport à nos idées et à leur réalisation pratique dans l’intérêt de la révolution, quelle devra être l’attitude la plus utile des anarchistes en particulier, et des forces plus conscientes du prolétariat en général ? C’est ce que nous essayerons de voir dans le chapitre suivant qui servira à ce livre de conclusion.
La fonction de l’anarchisme dans la révolution
Le mouvement prolétarien et subversif est divisé aujourd’hui en courants et fractions plus ou moins hostiles les unes aux autres, pourtant ayant en commun un minimum d’objectifs à réaliser (surtout de démolition) qui ne pourront pas être atteints sans une union effective, ne serait-ce que transitoire, au moment de l’action.
Les anarchistes, les socialistes, et les unions de métiers de ces deux tendances s’efforcent, ensemble, d’abattre les institutions politiques et économiques qui sont actuellement les nôtres. En Italie, de plus, le régime étant monarchique, la nécessité d’éliminer la monarchie fait que les républicains sont aussi nos alliés contre ce premier obstacle qui se dresse devant nous, sans compter que les républicains les plus jeunes, spécialement les ouvriers, par « république » entendent un régime non capitaliste, c’est-à-dire contraire à celui des républiques bourgeoises d’Europe et des Amériques.
Nous, les anarchistes, ne sommes d’accord ni avec les socialistes ni avec les républicains, avec les premiers parce qu’ils veulent donner une empreinte autoritaire à la révolution, avec les seconds pour la même raison, et en plus à cause de l’imprécision dangereuse de leur programme économique qui ne garantit pas au prolétariat la disparition réelle du privilège capitaliste. Et pourtant nous sommes toujours disposés à collaborer avec les uns et les autres pour les buts, aussi limités soient-ils, que nous avons en commun. Pour leur assurer notre coopération et pour recevoir la leur, devrions-nous cesser d’être anarchistes et rentrer dans les rangs des socialistes et des républicains ? Nous n’en voyons pas du tout la nécessité, et personne, parmi nous ou nos adversaires, n’a soutenu une pareille absurdité.
Compte tenu de l’ambiance actuelle et de la mentalité dominante parmi les masses, il est fort possible que les autres partis accomplissent une fonction utile et, pour le moment, nécessaire.
Les républicains eux-mêmes, s’ils redevenaient ce qu’ils étaient avant la guerre, pourraient avoir une fonction spéciale qui leur vient de la tradition historique et de la situation créée par l’implantation de la monarchie, étrangère à l’esprit italien, et qui a pris ses quartiers à Rome comme en terrain conquis. Les socialistes, eux, constituent la plus grande force dans le camp ouvrier, celle qui pourrait être le gros de l’armée révolutionnaire de demain, mais malheureusement leur politique incite très peu les anarchistes à la coopération. Le désir de conquérir le pouvoir pousse les dirigeants socialistes, de fait sinon en paroles, à nier à tout autre mouvement révolution-aire le droit d’exister, et ils prétendent, en plus, être les seuls représentants des droits et des intérêts de la classe ouvrière.
Voulant encadrer tout le mouvement et toute la révolution sous leur autorité et selon leurs directives, ils acceptent aussi toutes coopérations extérieures dont ils peuvent tirer profit, mais sans leur reconnaître aucune liberté d’initiative, cela est justement l’obstacle à une concorde effective qui autrement serait possible. En procédant ainsi, ils dépassent leurs fonctions spécifiques en empêchant les anarchistes de remplir la leur. Mais notre fonction ne nous empêcherait certainement pas de coopérer avec les socialistes s’ils étaient animés d’un plus grand esprit de tolérance et de compréhension dans tout ce qui nous est commun et pour les buts que nous voudrions atteindre.
Chaque fois que les socialistes engagent une lutte, même partielle, contre le capitalisme et le gouvernement, pour des améliorations immédiates, pour freiner l’exploitation et l’oppression, pour augmenter le bien-être et la liberté, ils peuvent être sûrs de trouver des alliés chez les anarchistes, sur le terrain de l’action directe populaire et prolétaire, et ils les retrouveraient encore plus sûrement à leurs côtés et en première ligne s’il fallait engager un conflit résolutif contre l’État et le capitalisme.
Le conflit se manifeste justement là où commence la fonction spécifique des anarchistes en tant que révolutionnaires et ennemis de l’autorité.
Tout en étant présents partout où il y a une lutte contre le privilège politique et économique, les anarchistes ne cachent pas que toute amélioration obtenue est illusoire et de brève durée tant que durera l’oppression capitaliste et étatique. Après la guerre cela est encore plus vrai qu’auparavant. Et en plus, si la solidarité anarchiste est pleine et enthousiaste lorsqu’il s’agit de l’action du peuple qui descend dans la rue, du prolétariat qui s’organise et mène des grèves partielles ou générales, qui lutte dans les usines ou les campagnes, qui résiste ou attaque le capitalisme directement sur son propre terrain, les anarchistes deviennent fermement hostiles lorsqu’il y a tentative de changer l’état de lutte en accommodement avec l’ennemi, en collaboration de classes, et en participation aux fonctions directives du capitalisme ou représentatives de l’État bourgeois.
C’est pour cette raison que les anarchistes sont et restent adversaires de la politique électorale ou parlementaire, du réformiste légaliste et collaborationniste, de tout autre rapport qui ne soit pas d’opposition et de guerre réelle contre les patrons et le gouvernement. La fonction, le devoir des anarchistes dans le mouvement social actuel, consiste justement, en tant que révolutionnaires, maintenir ouvert et vif l’état de lutte entre le prolétariat et le cap talisme, entre peuple et gouvernement, et, en tant qu’ennemis de tout pouvoir, à maintenir éveillé l’esprit de révolte contre toute autorité coercitive, à combattre, même parmi les mouvements prolétaires, les tendances autoritaires, centralisatrices et dictatoriales d’individus, groupes ou partis. Ainsi les anarchistes, jour après jour, par une action immédiate, donnent au problème de l’État la même solution négative qu’en théorie, soit en travaillant à la désagrégation et à la destruction de l’État actuel, soit en faisant obstacle, dès maintenant, à toute formation ou consolidation d’un État ou d’un gouvernement futur. La lutte contre l’État est la fonction essentielle qui caractérise, sans exclusion d’autres fonctions encore, l’anarchisme par rapport à tous les autres partis. Plus les anarchistes développeront leur fonction, plus la révolution sera proche et se développera dans le sens d’une plus grande justice et d’une plus vaste liberté.
Mais pour exercer cette fonction révolutionnaire et libertaire, les anarchistes ont plus que jamais besoin d’être et de rester eux-mêmes, c’est-à-dire de ne pas se laisser absorber par d’autres partis ou mouvements avec lesquels ils se trouvent tour à tour proches à l’occasion de luttes communes, qu’ils soient socialistes ou républicains, ou qu’ils soient syndicalistes. D’ailleurs, l’influence qu’ils pourraient exercer sur ces partis ou mouvements sera d’autant plus importante et efficace qu’elle proviendra exclusivement de l’extérieur, plutôt que dissimulée de l’intérieur.
On comprend que cette position intransigeante empêche les anarchistes d’obtenir certains résultats, et d’aider comme il faut la classe ouvrière en certaines circonstances. Par exemple, la nécessaire volonté de sacrifice faisant défaut aux ouvriers, ou bien ces sacrifices paraissant disproportionnés au but envisagé, il est impossible d’obtenir une victoire quelconque sans pactiser avec l’ennemi, sans recours aux services des politiciens et des lois, sans transactions avec le capitalisme et l’État.
Dans des cas de ce genre, les anarchistes, s’ils sont vraiment tels, ont le courage de ne pas s’occuper du succès et de dire à leurs compagnons travailleurs : « renoncez à un résultat qui vous coûte en dignité et en sacrifice sur l’avenir davantage que ce que vous allez obtenir. Unissez-vous, afin d’obtenir beaucoup plus par votre action directe, mais si notre conseil n’arrive pas à vous persuader, n’attendez pas notre concours pour une action que nous n’approuvons pas, demandez l’aide ailleurs que chez nous ».
Certes, ce langage et cette attitude ne sont pas faits pour nous attirer, en temps ordinaire, le concours des grandes masses ; mais nous préparons ainsi le terrain à des temps extraordinaires. C’est-à-dire que nous formons, dès maintenant, la minorité révolutionnaire dont la fonction est de porter les premiers coups de bélier contre les portes fermées de l’avenir. Alors les anarchistes ne seront plus seuls et la minorité deviendra la majorité. Mais cela sera réalisable seulement si les minorités d’aujourd’hui n’abdiquent pas leurs fonctions spécifiques, destructrices, intransigeantes, d’avenir, et ne se laissent pas séduire par le désir d’accroître au-delà du possible leurs effectifs, dans le but de faire face aux nécessités qui se présentent en toutes circonstances.
Parti de la minorité, les anarchistes ne peuvent pas suffire à assumer toutes les fonctions du mouvement socialiste et ouvrier. En renonçant à une récolte prématurée, en laissant aux autres tous les succès immédiats les plus prestigieux, ils leur laissent aussi les fonctions de transiger, de se soumettre ou d’exercer l’autoritarisme que la basse mentalité des grandes masses crée ou alimente. Libres et indépendants, les anarchistes bougent au sein de la masse elle-même, en contact avec elle, prenant part à ses sacrifices et à ses révoltes mais pas à ses faiblesses, à ses transitions, à ses renoncements.
Bien entendu, ceci est le devoir, le programme idéal de l’anarchisme : ce qui n’exclut pas, malheureusement, que certains anarchistes, en leur nom propre, transigent, renoncent ou se montrent faibles. Nous parlons de l’attitude générale anarchiste telle qu’elle devrait être, en cohérence avec les idées qui l’animent. Dans les faits, il est bien entendu que les anarchistes, eux aussi, peuvent tomber dans l’erreur comme n’importe quel autre parti. Mais ce qui le distingue des autres consiste en ceci que l’anarchisme reconnaît toujours ses erreurs, inévitables pour ceux qui bougent et qui agissent, et il s’efforce de les corriger, de les éviter, afin d’accomplir le plus possible leur fonction spécifique de ferment dont parle la parabole biblique.
Ferment de liberté et de révolte, outre que vulgarisateur d’idées, l’anarchisme a, en tant que tel et en cohérence avec son programme, un terrain tellement vaste à cultiver, qu’il n’a pas le temps de s’occuper des activités des autres, pour lesquelles il est d’ailleurs très adapté. S’il lui sera possible de porter à terme sa tâche, il aura apporté la plus grande et la meilleure contribution à la réussite de la révolution et à l’édification de cette « cité du bon accord » dont nous parlait Reclus, et dans laquelle vivront les hommes selon la justice, libres et égaux.
Notre discussion sur la dictature a soulevé quantité d’autres questions qui s’y réfèrent plus ou moins directement, qui sont en étroit rapport avec le problème de la révolution et avec celui de la tâche spécifique des anarchistes dans la révolution.
Très peu de monde, parmi les adversaires des anarchistes, se rendent compte de notre fonction spécifique dans la révolution. Même quelques anarchistes, soit parce qu’ils sont pris dans l’engrenage de l’activité pratique et révolutionnaire et perdent de vue l’ensemble des choses, soit parce qu’ils prennent pour de l’anarchisme leur ardeur révolutionnaire, ne semblent pas avoir une idée exacte de la place que les anarchistes occuperont dans la complexe et vaste guerre sociale où est en train de s’engager la société moderne.
La fonction et la tâche des anarchistes, avant et pendant la révolution, ont un but déterminé, un champ d’action déterminé, et ne peuvent prétendre suffire à toutes les nécessités, résoudre toutes les questions qui se présenteront jusqu’au jour où s’installera un régime communiste anarchiste.
En revanche, il est vrai (et seulement des adversaires de mauvaise foi peuvent nous accuser du contraire) qu’il est peu probable de passer d’un seul bond de l’état actuel des choses à un autre qui serait pleinement conforme à nos idées et à notre programme. Il faudra d’abord une révolution qui change l’environnement et transforme comme dans un creuset la conscience des majorités. Et il se pour-ait même qu’une seule révolution n’y suffise pas. La période révolutionnaire ne sera pas de brève durée et les insurrections de la première heure ne suffiront pas à la dépasser. Pendant cette période seront expérimentés des régimes différents, plus ou moins parfaits, plus ou moins autoritaires, plus ou moins entachés de violence, d’injustices et d’inégalités.
Rien de plus probable et de plus naturel : l’humanité va son chemin au travers de chutes et d’erreurs, et même ces chutes et ces erreurs ont une fonction utile, si, grâce à elles, grâce à leur douloureuse leçon, les hommes peuvent s’approcher de la vérité. Il se pourrait, donc, que le résultat de la révolution ne soit pas en accord avec l’idéal anarchiste. Une république plus ou moins socialiste, une dictature plus ou moins tyrannique, des nouveaux gouvernements, des nouveaux exploiteurs, des nouveaux privilèges et des injustices d’un autre genre, etc., et que tout cela assume un caractère de nécessité à cause de notre faiblesse et de l’inconscience des masses, ou parce que parmi nous ou en dehors de nous les forces ennemies sont encore trop puissantes, parce que les égoïsmes aveugles et les superstitions empêchent l’harmonie des volontés ou des intérêts, parce que, en somme, manqueraient encore les conditions effectives pour l’accomplissement de notre idéal.
Mais il y a des anarchistes qui, en songeant à ces difficultés, s’oublient eux-mêmes et oublient leurs propres buts politiques et sociaux, et s’adaptent dès maintenant aux difficultés en transigeant avec l’erreur et la tyrannie. Comme ils prévoient un état de choses imparfait, ils l’acceptent sans autres formes de procès, dans leur pourtant noble impatience de sortir de l’état actuel, plus imparfait encore. Ils voient l’erreur et le danger de demain et, le considérant comme inévitable, s’en font les partisans. Ils renoncent au but ultime du libre socialisme, de l’anarchie communiste, pour considérer les transitions qui leur semblent nécessaires : la république sociale, la constituante, la dictature prolétarienne, le socialisme marxiste, en s’associant ainsi, de fait sinon en paroles, aux autres partis, en servant d’autres buts et d’autres intérêts, en renvoyant à plus tard le « mieux » qu’ils gardent dans leur esprit.
Ils se demandent : « faut-il donc sacrifier le bien qui est à portée de la main au mieux de demain, en risquant ainsi de faire le jeu des ennemis du prolétariat et de la liberté ? » Et ils ajoutent l’éternel argument, assez juste en soi mais que les opportunistes ont usé jusqu’à le fausser : « il faut être pratiques ».
Or, justement, la question se pose : est-on plus pratiques en s’adaptant au mal, même s’il est inévitable, à l’erreur même si elle est provisoirement imposée par les circonstances, au point de s’en faire les partisans, ou bien en résistant à l’erreur et au mal le plus possible, en les montrant sous leur vrai jour et en envisageant continuellement les solutions que nous croyons les meilleures ? Nous pensons que la deuxième méthode est beaucoup plus pratique. Avant tout, les prévisions selon la direction que prendront les événements, aussi bien les nôtres que celles des autres, peuvent être erronées, peuvent être démenties par les événements mêmes. Choisir une voie qui nous semble fausse, sur les bases de prévisions futures, pourrait nous conduire à quelque désastre dont nous serions responsables, justement parce que nous savions avant l’erreur que nous acceptions.
Mais, cela mis à part et même si ces prévisions devaient se réaliser, du mal ou une erreur inévitables sont réellement transitoires et ils cesseront d’autant plus vite s’il y a des gens qui y résistent, qui conservent intacte la conscience de ce mal et de cette erreur, des dommages qui peuvent en découler et de la nécessité de s’en libérer au plus tôt. Si, par contre, tout le monde s’y adapte, et avant même que les circonstances ne les imposent par la force, il se créera chez le peuple un état d’âme favorable à l’erreur. Si ceux qui connaissent la voie de la vérité et de la justice renoncent à l’avance, car ils craignent le pire, le mal et l’erreur prendront des racines encore plus profondes, pourront se consolider, et le jour où il faudra les extirper, il faudra déployer des efforts et supporter des sacrifices incroyablement plus pénibles et durs.
Cela ne veut pas dire qu’il soit nécessaire de sacrifier, à un mieux lointain, le peu de bien que l’on peut obtenir tout de suite, même dans le mal et les erreurs, cela ne signifie pas que le fait de tendre vers une plus grande vérité et vers une justice supérieure, assume des formes telles qu’il puisse faire le jeu de la réaction et des ennemis de l’émancipation ouvrière.
Par exemple, pour parler de l’Italie, il est probable qu’une révolution en ce moment, ou dans peu de temps, établisse parmi nous une république qui, bien qu’à tendances plus ou moins socialistes, serait loin d’instaurer une société anarchiste. Est-ce pour cela que nous devrons faire obstacle à la révolution, ou bien se montrer et rester indifférents, pour le simple fait qu’elle ne donnera pas ce que nous voudrions ? Aucun anarchiste ne pense ainsi. Au contraire, nous devons y participer avec toute notre énergie, dans le but immédiat d’abattre autant de privilèges et d’oppressions que possible, et pour profiter de l’absence momentanée ou de la faiblesse des forces gouvernementales pour renforcer notre position d’anarchistes en créant et en multipliant les institutions libres et volontaires, fondées sur l’accord mutuel, institutions qui seront le point de départ pour une action nouvelle, et qui représentent la défense de la liberté en opposition à un quelconque gouvernement qui se serait constitué.
Si, en prévision de l’issue probable de la révolution vers une république plus ou moins dictatoriale ou socialiste, nous renoncions dès maintenant à notre fonction d’anarchistes et nous faisions chorus avec la propagande républicaine et socialiste dictatoriale nous ne deviendrions que les doubles inutiles de ces partis, nous cesserions d’être une force indépendante et serions absorbés par les partis du gouvernement à venir. En un mot, les anarchistes abdiqueraient leur fonction de défenseur de la liberté et de promoteurs de la révolution.
Pour que les anarchistes puissent exercer leur fonction, il faut qu’ils restent en dehors pour « pousser le chariot » selon l’expression qu’employait Mazzini pour ses disciples.
Avant tout, ils ne devront jamais assumer une responsabilité gouvernementale, aussi révolutionnaire que ce gouvernement puisse être ou se dire ; n’avoir jamais les mains liées afin de ne pas se trouver contraints d’agir contre leurs convictions, d’une part, de ne pas pouvoir agir librement suivant les nécessités du moment d’autre part. Quand nous parlons de responsabilités à repousser, nous entendons bien parler de celles qui nous éloigneraient du peuple, nous feraient perdre le contact et la confiance du peuple, celles qui peuvent nous repousser à l’arrière, et non les responsabilités, bien entendu, inhérentes au fait révolutionnaire vis-à-vis de la bourgeoisie. Nous ne devons pas oublier que nous sommes un parti d’avenir et que nous nous devons de ne pas compromettre cet avenir par des renonciations de fait qui nous lient au présent et soient un obstacle pour aller plus loin.
Vis-à-vis de la dictature prolétarienne ou d’un gouvernement révolutionnaire, notre place est donc dans l’opposition, opposition intransigeante par principe, et dans la pratique plus ou moins généreuse, plus ou moins active, avec des trêves plus ou moins importantes suivant ce que sera ou fera le gouvernement, et suivant, surtout, les nécessités de la lutte contre les forces bourgeoises et réactionnaires, qu’elles soient à l’intérieur ou bien qu’elles exercent leur pression de l’étranger.
Certes, l’opposition à une dictature ou à un gouvernement ouvrier, socialiste et révolutionnaire, autant qu’elle puisse être contraire à nos convictions, ne pourrait avoir le même caractère que l’opposition actuelle, véritable hostilité d’ennemis envers le gouvernement et la dictature bourgeoise. Du moins elle n’assumerait cet aspect que jusqu’à ce que le prétendu gouvernement ouvrier pousse à l’extrême ses provocations contre la liberté et ne devienne un danger aussi grave pour la révolution que la réaction bourgeoise.
La boussole des anarchistes dans leur action sera toujours l’intérêt de la révolution ; les socialistes au pouvoir auront toujours le concours libre, volontaire mais efficace, de tous les révolutionnaires sincères, y compris les anarchistes, en ce qui concerne la lutte contre la bourgeoisie, pour le travail de reconstruction et de défense du peuple contre le malaise et la faim.
« Nous resterons avec les socialistes » disait un journal anarchiste, « tant qu’ils resteront dans l’opposition. Nous serons contre eux dès le moment même où ils prendront le pouvoir, tout en les aidant dans leur lutte contre la réaction et pour la défense de la révolution, et nous lés aiderons pour tout ce qu’ils feront de « socialiste » tandis que nous les combattrons honnêtement mais fermement pour tout ce qu’ils feront de nuisible, afin d’extirper de la révolution tout son contenu social libertaire [132]. »
A ce propos, nous croyons que, bien plus que les polémiques et les formes violentes et irritantes de lutte, bien plus que les mots et les affirmations dogmatiques, les faits sauront démontrer le bien fondé de nos agissements. Les anarchistes, où qu’ils soient, s’ils sont en nombre suffisant ou bien s’ils peuvent disposer de beaucoup de partisans, sauront mettre à profit la disparition des organismes étatiques. Grâce à la conséquente liberté ainsi obtenue, ils pourront procéder, dès le premier moment, à l’expropriation. Ils détruiront tout ce qui reste des anciens organismes autoritaires et ils organiseront la vie sociale sur des bases communistes et libertaires, et sur ces bases on pourra établir toutes les formes possibles de libre association, dans le but de satisfaire les besoins de toutes sortes de travailleurs sans s’occuper des ordres contraires des nouveaux gouvernements qui surgiront dans les pays les plus arriérés. Ils procéderont à fédérer ces libres institutions au fur et à mesure qu’elles seront créées, de façon à constituer une force, un rempart de la liberté. Même minoritaires, ils sauront sans doute tenir en respect le nouveau pouvoir, et sauront assurer la nécessaire autonomie de l’initiative prolétaire et libertaire.
Il est aisé de prévoir que la libre initiative trouvera sa meilleure forme de développement, outre chez l’individu, dans les différents types de groupements et d’associations, suivant les fonctions qui leur sont propres. Les groupes locaux, les comités de quartiers et des communes, les syndicats de métiers, les fédérations d’industries, l’union des fonctionnaires des services publics, du ravitaillement et de distribution, les conseils d’usines, les sociétés culturelles, les ligues paysannes, etc., fourniront le terrain idéal pour le mûrissement et l’aboutissement de l’initiative populaire, ainsi qu’elle est comprise par les anarchistes autant pour la destruction que pour la suppression de l’autorité étatique.
Nous avons, en traitant notre sujet, déjà parlé des soviets, ou conseils ouvriers. Nous les avons présentés comme des organismes révolutionnaires à ne pas confondre avec la dictature. Nous pourrions ajouter que le régime des soviets dans le sens véritable du mot (et non pas, ainsi qu’il est devenu en Russie, l’expression d’un gouvernement dictatorial de parti qui les a subjugués, domestiqués et subordonnés en empêchant toutes expressions libres et oppositions) semble se rapprocher beaucoup du type d’organisation sociale que nous souhaitons, ou, tout au moins, que c’est un régime à contenu libertaire qui pourrait évoluer vers l’anarchie par des modifications et des adaptations suggérées par l’expérience et les besoins. Notre ami Luigi Bertoni disait, avec raison, que « les soviets représentent en réalité le pouvoir le plus large, important, direct, populaire, que l’on ait connu jusqu’ici dans l’histoire, donc le moins absolu et tyrannique, le moins dictatorial [133] ».
Dans ces organismes nouveaux, issus de l’action directe du prolétariat, organes de production et de distribution organisés et gérés par les producteurs et les consommateurs eux-mêmes, conçus libres de tout contrôle d’un pouvoir politique qui domine les soviets et se met au-dessus du mouvement autonome des travailleurs [134], les anarchistes pourront ordonner leurs actions, justement pour combattre, faire obstacle, limiter au moins, le pouvoir arbitraire des dictatures personnelles ou de partis qui viendraient à se créer au sein de la révolution. Dans les soviets, les anarchistes, ainsi que les autres révolutionnaires d’ailleurs, pourront assumer leur double tâche négative et positive : défense de la liberté contre tout nouveau pouvoir qui pourrait se former, et reconstruction sociale sur des bases communistes. Les soviets étant suffisants par eux-mêmes, à côté des autres organisations prolétaires, à l’existence d’une société sans gouvernement ; si un gouvernement s’établissait, ils représenteront la résistance populaire, la libre initiative, l’esprit d’indépendance des masses. Ils seront les noyaux autonomes des producteurs fédérés entre eux par villes ou villages, par provinces, par régions, jusqu’aux plus grands territoires nationaux, jusqu’aux unions internationales, suivant les fonctions, les genres de productions, de services publics, de consommations, et toutes les nécessités auxquelles ils devront faire face.
Défendre leur autonomie de l’ingérence et de l’exploitation étatique sera une fonction nécessaire, éminemment révolutionnaire, et autre qu’anarchiste, jusqu’au jour où cette autonomie sera complétée par l’élimination absolue de tout État ou dictature. Ce jour-là seulement on pourra dire que la révolution sociale aura triomphé et que le but de l’émancipation du prolétariat et de l’humanité toute entière aura été atteint.
Sans doute ceci est une tâche assez limitée, mais pour la réaliser nous n’aurons jamais de forces en telle abondance que nous puissions nous permettre de nous occuper de tâches qui ne soient pas exclusivement les nôtres.
Si les conditions nécessaires à l’établissement d’un régime anarchiste ne sont pas réalisées, il est évident que la porte reste ouverte à un gouvernement quelconque plus ou moins révolutionnaire, et que donc il faudra néanmoins qu’un parti ou un autre en assume la responsabilité. Puisque nous en sommes conscients, devrions-nous, nous anarchistes, assumer une telle tâche ? Jamais ! Si le troupeau humain a encore besoin de bergers, qu’il les choisisse où il veut parmi des éléments plus conformes que nous. Nous qui ne voulons pas de bergers, nous ne voudrions ni ne saurions non plus l’être. Nous continuerons à être contre tous les bergers et nous le resterons, d’autant plus hostiles qu’ils auront tendance à manier contre le peuple le bâton et la tondeuse.
Et en attendant, commençons, nous, dès le début, par refuser le bâton et la tondeuse.
Les socialistes disent toujours que la « dictature » sera passagère, un état imparfait de transition, quelque chose comme une douloureuse nécessité. On sait combien cette croyance renferme de dangers et d’erreurs. Mais même en admettant que la dictature soit réellement nécessaire, ce serait quand même toujours une erreur de la présenter comme un but à atteindre, de s’en faire une bannière qui remplace celle de la liberté. De toute façon, une des conditions indispensables pour qu’une telle dictature soit réellement provisoire et transitoire, qu’elle ne se renforce et ne donne lieu dans l’avenir à une dictature durable, c’est-à-dire qu’elle cesse au plus tôt, consiste à entretenir, à l’intérieur comme à l’extérieur d’elle-même, une opposition vigilante et énergique parmi les révolutionnaires, un parti fort qui entretienne à son tour la flamme vive de la liberté, qui combatte constamment la tyrannie de cette dictature jusqu’à sa destruction.
La fonction naturelle de l’anarchisme, qui lui revient par son essence même et ses traditions, consistera à représenter au sein de la révolution cette opposition encore plus révolutionnaire, cette flamme de liberté, en un mot : l’avenir. Ceux qui craignent que cet état de fait ne donne un avantage à la réaction se trompent lourdement. La contre-révolution triompherait si la tendance anarchiste venait à manquer, cela oui ! L’esprit de révolte de l’anarchisme, instinctif ou conscient, a été l’âme de toutes les révolutions, et il le sera d’autant plus de la révolution sociale, révolution qui n’aura rien à craindre de notre amour jaloux de la liberté, de notre opposition raisonnée et éclairée contre tout pouvoir officiel qui voudrait s’y superposer, car elle sera toujours une opposition subordonnée aux intérêts supérieurs de la révolution elle-même.
Les anarchistes n’oublieront jamais que tant que la révolution n’aura pas détruit ses ennemis, ils devront tourner vers ceux-ci leurs efforts, et ils défendront donc la révolution, quelle que soit sa direction, contre les menées et les assauts des forces bourgeoises et réactionnaires, avec une intransigeance et une ardeur inégalées par tout autre parti.
Giovanni Bovio disait que « le parti révolutionnaire par excellence doit être anarchiste ». Il en sera ainsi. La révolution pourra avoir lieu, répétons-le pour la énième fois, même sans être anarchiste, mais elle sera d’autant plus complète qu’elle sera davantage anarchiste, et elle sera affranchie d’un possible retour au passé seulement quand elle aura donné toutes les libertés à tous les hommes, seulement quand elle aura rendu impossible toute domination, toute dictature quelle que soit son espèce, quel que soit le nom dont elle se pare. Voilà pourquoi, en combattant pour l’anarchie et non pour la dictature, en soutenant que l’action libertaire dans la révolution est plus utile à son succès que toutes les pratiques autoritaires, nous sommes certains, non seulement de rester cohérents avec notre idéal, mais aussi d’être et de rester, plus qu’aucun autre parti, sur le terrain de la réalité, celui où peuvent évoluer les artisans du triomphe de la révolution.
Dans la révolution qui s’approche, si celle-ci est victorieuse, les anarchistes voient, il est vrai, le succès de leurs efforts. Mais ils n’en tireront aucune utilité pour eux, sinon celle qu’ils auront en commun avec tous les hommes, finalement libérés, dans une société plus riche, plus fraternelle et plus juste.
Si, en revanche, ils perdent – réaction harcelante, révolution vaincue, naissance d’une nouvelle tyrannie malgré l’apparente réussite éventuelle de l’insurrection –, les anarchistes savent qu’ils devront payer chèrement leur merveilleux rêve et leur amour de la liberté. La haine des dominateurs, nouveaux ou anciens, se vengera de leur révolte, jamais définitivement calmée, sans miséricorde aucune. Mais même dans ce cas, les anarchistes, sachant qu’ils seront vengés dans un avenir plus ou moins lointain, sauront tomber la tête haute, pleins de leur foi dans l’IDEE, en répétant l’invocation stoïque : « Ave liber-tas, morituri te salutant ! » (N.d.T. « Salut liberté, ceux qui s’apprêtent à mourir te saluent ! »)
Éditions du Monde Libertaire 1986
Achevé d’imprimer en février 1986 sur les presses de La Cooperativa Tipolitografica Carrara, Italie pour les editions du Monde Libertaire Paris – France
[1] L. Fabbri, L’Organisation anarchiste, Volonté anarchiste, éd. du groupe Fresnes-Antony (FA), 20 F.
[2] L. Fabbri, Crise de l’anarchisme, brochure éditée par le groupe Malatesta (FA), 10 F.
[3] – Il en fut ainsi dans la réalité. Les guerres des Balkans, issues de la guerre italo-turque pour la Libye, furent à l’origine de la Grande Guerre de 14–18.
[4] – La Bataille syndicaliste de Paris, numéro du 18 décembre 1912.
[5] – Cette propagande violemment antimilitariste fut dite « herveiste », du nom du journaliste français Gustave Hervé, du journal la Guerre sociale.
[6] – Malatesta : « A propos d’insurrection », in le Mouvement anarchiste, revue mensuelle, Paris, numéro 6–7 janvier 1913.
[7] – Pour la position du mouvement anarchiste face à la Première Guerre mondiale, voir G. Cerrito, L’Antimilitarismo anarchico in Italia nel primo ventennio del secolo. Editions R.L. Pistoia, 1968. (Note de l’édition italienne. Ed. Antistato. Cesena 1971.)
[8] – Volontà de Ancône, numéro 3 du 16 janvier 1915.
[9] – Revue Comunismo de Milan, numéro 15 du 1er mai 1920.
[10] — L’Avenir international de Paris, numéro 1 de janvier 1918.
[11] — Les Temps nouveaux de Paris. An IV du 3 décembre 1898 au 25 février 1899. Articles « le Césarisme » et « l’Alliance franco-russe ». Dans ces articles se trouve l’erreur qui devait conduire Kropotkine, en 1914, à prendre sa malheureuse attitude, favorable à la guerre pour l’Entente ; mais on y met en lumière les origines étatiques de la guerre en ce qui concerne la France et la Russie.
[12] – P. Kropotkine, La Scienza Moderna e l’Anarchia (la science moderne et l’anarchie). Editions du Risveglio (le réveil). Genève, 1913, pages 210–211.
[13] – Comme on ne peut, ici, faire une étude de tous les facteurs de la guerre, nous considérons seulement les deux plus importants et fondamentaux. Certes, il y en a d’autres (moraux, psychologiques, etc.), non moins négligeables
[14] – Préface à Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, de K. Marx.
[15] — Programme anarchiste, approuvé par le congrès de l’Union anarchiste italienne du 1er au 4 juillet 1920 à Bologne.
[16] — L’Agitazione (l’agitation) de Ancône du 15 mai 1897, article « Lo Stato Socialista » (l’État socialiste).
[17] – P. Kropotkine La Conquête du pain. Chapitre « Le Salariat collectiviste ».
[18] – A. Schaeffle, La Quintessence du socialisme.
[19] – M. Bakounine, OEuvres ; volume IV, page 252, édition Stock.
[20] – Paroles de Malatesta dans une lettre à A. Borghi ; voir Guerra di Classe de Florence du 11 novembre 1917.
[21] – Nous avons connu plus d’un maximaliste qui repousse l’idée de la dictature. Parmi ceux-ci, Enrico Leone, qui la considère comme illusoire et inacceptable dans sa signification littéraire et historique. Il pense que Marx a accepté l’expression de « dictature prolétarienne » seulement pour rendre plus efficace l’idée de la force prolétaire dans l’exercice de sa fonction révolutionnaire. Il Lavoratore (le travailleur) de Trieste du 22 mai 1920.
[22] – Ceci, et ce qui suit, avait été écrit alors que l’armée bolchevique allait de victoire en victoire contre la Pologne, qui avait à son tour agressé la république des Soviets, pour le compte des États capitalistes. La suite des événements prête à moins d’optimisme, mais cela n’empêche pas la nécessaire liberté de critique.
[23] – Il semblerait que notre espérance soit mal fondée. Humbert Droz, socialiste bolchévique suisse de retour de Russie, racontait à Genève dans une de ses conférences que le gouvernement bolchevique n’accepte aucune opposition dans le camp révolutionnaire et qu’il se comporte avec les anarchistes et socialistes de gauche de la même façon qu’avec les pires réactionnaires.
[24] – Ordine Nuovo, anthologie de culture socialiste, Turin, du 29 novembre 1919.
[25] – La Vie ouvrière, Paris, du 7 mai 1920.
[26] – E. Antonelli La Russie bolchevique, page 58.
[27] – Lénine, Deux Tactiques de la démocratie socialiste, page 397. Nous signalons que nous avons pris cette citation du livre Lénin de Landau-Aldanov, pages 34 35, livre tendancieux et antibolchévique. L’auteur est un socialiste populiste, partisan de Kerensky. Cependant nous ne croyons pas que l’auteur en arrive à falsifier des citations.
[28] — Les Temps nouveaux, Paris, numéro 12 du 20 juillet 1907.
[29] – L’origine spontanée et populaire des soviets, ni prévue ni ordonnancée par un parti, est reconnue aussi par l’écrivain bolchevique Karl Radek, selon lequel « l’idée des conseils » a été générée et s’est formée de la même façon que la nature génère et forme ses cristaux. L’evoluzione del socialismo dalla scienza all’azione (l’évolution du socialisme de la science à l’action), page 28.
[30] – Lénine, L’opera di ricostruzione dei Soviet (l’œuvre de reconstruction des soviets), page 25 ; éditions Avanti ! de Milan. Ici, Lénine dit seulement « bourgeois ». mais dans le contexte il explique bien qu’il s’agit pour lui d’habitudes et de traditions opposées au contrôle de l’État, spécialement de la petite bourgeoisie.
[31] — La Versilia de Viareggio, du 24 août 1920.
[32] – Lénine, L’opera di ricostruzione dei Soviet (l’œuvre de reconstruction des soviets), pages 38–39. Au moment de corriger les épreuves, il nous parvient une seconde édition de cet important discours de Lénine, un peu différent de celui de la première édition. Par commodité, nous avons suivi le nouveau texte, en corrigeant seulement l’indispensable.
[33] – Lénine, L’opera di ricostruzione dei Soviet (l’œuvre de reconstruction des soviets), page 36.
[34] – P.C. Masini, les Anarchistes italiens et la Révolution russe dans la Rivista storica del socialisme (revue historique du socialisme), 1962, numéro 15–16.
[35] – A. Ransome, Sei settimane in Russia (six semaines en Russie), éditions Avanti /, Milan. Rappelons que le nom d’un certain W. Shatoff figurait, ainsi que celui d’autres Russes avec Malatesta, Domela Nieuwenhuis Bertoni, Emma Goldman, Recchioni, etc., en bas d’un « Manifeste anarchiste international » contre la guerre, publié à Londres, en mars 1915. Il fut traduit ensuite dans Volontà de Ancône, le 20 mars 1915. Il s’agit probablement de la même personne.
[36] – P. Archinof, Storia del movimento maknovista (histoire du mouvement makhnoviste). Editions R.L., Napoli, 1954.
[37] – « Les bolcheviks exceptés, tous les partis représentés au congrès des Soviets (mars 1918), y compris le parti anarchiste, se sont déclarés contre la ratification de la paix et pour la reprise de la guerre. Même au sein du parti bolchevik, une minorité de « guerriers » était de cet avis, à la tête de laquelle se trouvaient Kollontaï, Dybenko, Rozanoff, Boukarine, etc. », J. Sadoul, Notes sur la révolution bolchevique, page 266.
[38] – J. Sadoul, Notes sur la révolution bolchevique, pages 286–287.
[39] – Même œuvre : page 292.
[40] – Même œuvre : page 279.
[41] – Même œuvre : page 275.
[42] – Lettre de Russie de Robert Minor, traduite dans L’Era Nuova(l’ère nouvelle) de Paterson. (Citée par Volontà de Ancône du 1.7.1919.)
[43] – En Italie aussi, plus d’une fois, les anarchistes ont défendu l’Avanti ! du Parti socialiste, avec des arguments… assez persuasifs, contre les tentatives d’assaut venant de bandes de voyous, soudoyées par la police.
[44] – Citation extraite du Risveglio (le réveil) de Genève du 17 juillet 1920.
[45] – J. Sadoul, Notes sur la révolution bolchevique, pages 393, 399, 400.
[46] — L’Avvenire Anarchico (l’avenir anarchiste) de Pise du 1.11.1918, article rédigé le 21 juillet de la même année.
[47] – J. Sadoul, Notes sur la révolution bolchévique, page 408.
[48] – A ce propos, consulter les rapports respectifs des deux organisations, publiés à Bruxelles en 1904, par le secrétariat socialiste international, sous le titre L’Organisation socialiste et ouvrière en Europe, Amérique et Asie.
[49] — Avanti !, édition de Rome, numéro 197 du 21 juillet 1918.
[50] – J. Sadoul, Notes sur la révolution bolchévique, page 393.
[51] – K. Radek, L’evoluzione del socialismo dalla scienza ail’azione (l’évolution du socialisme de la science à l’action), page 25.
[52] — L’Ordine Nuovo (l’ordre nouveau) de Turin, numéro 29 du 6/13 décembre 1919.
[53] – Nous avons extrait les informations sur les bandes anarchistes de Makhno, des numéros 51 et 52 de Umanità Nova de Milan, 27 et 28 avril 1920. On y parle aussi d’un florissant mouvement anarchiste dans le sud de la Russie : une confédération anarchiste y est très active, avec un centre à Elisabetgrad. Déjà en contact direct avec Makhno, elle s’apprête à reconstituer les communes libertaires, et développe une très grande activité parmi les masses, chez les syndicats ouvriers et les populations agricoles : soit par des conférences, œuvres d’éducation, des publications, soit en essayant d’organiser des échanges directs de produits entre les villes et la campagne (les paysans se refusant à accepter de l’argent). Tout cela sans se préoccuper de savoir si une telle activité est autorisée ou non par le gouvernement bolchevique. Sur les bandes de Makhno, nous avons lu un autre récit, qui coïncide par plusieurs points avec le nôtre, dans Volontà de Ancône (numéro 3 du 16 février 1920), qui l’a extrait elle-même de La Feuille, journal pro-bolchevique de Genève. Cela ne vaut peut-être pas la peine de nous occuper d’un article plein de haine et d’hostilité envers Makhno et les anarchistes, signé D.R. dans Ordine Nuovo de Turin, du 3 avril 1920, et d’évidente inspiration bolchevique russe. On n’y mentionne aucun fait qui soit en opposition avec ceux que nous relatons ; on y ajoute seulement que les partisans de Makhno ont commis beaucoup d’excès (chose d’ailleurs assez courante chez les bandes armées) et que Makhno disait du mal de Lénine et de Trotsky. On y affirme que les anarchistes n’ont eu aucune part importante dans l’évolution de la révolution russe ; et ce mensonge, en contradiction avec d’autres témoignages, suffit à souligner le caractère tendancieux et peu sérieux de l’auteur de l’article. Du reste, il ajoute ensuite, contradictoirement, que « presque tous les anarchistes ont loyalement collaboré avec les soviets dès le premier moment ». Et il termine l’article en reconnaissant que Makhno a rendu de grands services à la révolution pendant les moments des plus graves dangers tout en indiquant qu’il lui a porté un coup, en désagrégeant et en démoralisant les masses. Cette dernière accusation n’a pas lieu d’être lorsqu’on sait que toute critique iconoclaste et libertaire est toujours perçue comme démoralisatrice d’après la dialectique marxiste.
[54] – P. Stutka, La Costituzione de la R.S.F.S.R., éditions Avanti ! de Milan, page 12.
[55] – Costituzione della Republica Socialista dei Soviet (constitution de la république socialiste des soviets), éditions Avanti ! de Milan, page 16.
[56] J. Sadoul, Notes sur la révolution bolchevique, page 270. Vers juin 1920, plusieurs socialistes italiens se sont rendus en Russie ; mais jusqu’ici (novembre 1920), rien de plus explicite que ce que l’on savait déjà, parlant de la véritable situation russe, n’a été publié. D’après les confidences des uns et des autres, nous avons appris certaines choses qui nous rendent pessimistes sur le sort de la liberté du peuple en Russie. Quelqu’un, à qui l’on demandait si en Russie les journaux anarchistes sont toujours publiés (en 1905 et en 1917–1918, il y en avait un très grand nombre, parmi lesquels des quotidiens), nous a répondu : « Aucun journal anarchiste n’est publié, un journal comme Umanità Nova ne serait pas toléré en Russie. » A un autre, nous avons demandé si en Russie il est permis à l’opposition socialiste et révolutionnaire d’avoir des journaux ; il nous a répondu sur le ton ironique : « Oui, le permis est donné, mais on ne trouve pas de papier pour les imprimer. »
[57] – P. Stutka, La Costituzione, page 21.
[58] – P. Stutka, La Costituzione, page 24 ; voir les explications de l’auteur. Dans la Costituzione publiée par l’Avanti / de Milan en 1919, en page 8, on fait aussi allusion au président du conseil ; mais il nous semble que l’on n’en parle nullement dans les nombreux articles de la loi fondamentale de la R.S.F.S.R.
[59] – Voir, entre autres, l’article 62 de la Constitution. Même Sadoul, dans son œuvre, fait cette observation, lorsqu’il parle de « l’étroite subordination des soviets de la commune aux soviets du canton, de ceux du canton à ceux du district, de ceux du district à ceux du gouvernement, et ceux du gouvernement à ceux du Congrès pan-russe ». Mais disons tout de suite que cette dernière subordination, du gouvernement au Congrès, est simplement nominale.
[60] – J. Sadoul, Notes sur la révolution bolchévique, page 283.
[61] – J. Sadoul, Notes sur la révolution bolchévique, page 311.
[62] – Une preuve du despotisme avec lequel le gouvernement bolchevique « règne » sur les soviets se trouve dans une ordonnance de Lénine au nom du conseil de défense ouvrière et paysanne, de décembre 1918. Selon cette « ordonnance », les délibérations des soviets régionaux et locaux doivent toujours être contrôlées et, au besoin, annulées par ordre des commissaires du peuple, chaque fois qu’elles sont en contradiction avec les ordres du pouvoir central, ou qu’elles y font obstacle… Il est ordonné aux institutions régionales et locales des soviets, sans contestations, sans retards et avec la plus scrupuleuse exactitude, d’appliquer toutes les décisions et les ordres du pouvoir central, etc. (voir aussi Une Législation communiste de Labry, éditions Payot, Paris, pages 20, 21 et 22).
[63] – M.A. Landau-Aldanov, Lénin, page 33. Nous avons déjà signalé que l’auteur de ce livre est un adversaire de Lénine. Sur sa crédibilité, on peut lire dans la Revue communiste de Paris, numéro 5 de juillet 1920, ce jugement non suspect du maximaliste Rappoport : « Le livre de Landau est celui, parmi ceux des adversaires du bolchevisme, qui dénature le moins la vérité historique… Il fournit sur Lénine et son œuvre des informations très intéressantes et exactes. »
[64] – E. Avenard, Le 22 janvier nouveau style, Cahier de la quinzaine, 19 novembre 1915, Paris, page 158.
[65] – Avanti !, édition de Rome du 6 février 1920.
[66] – En ce qui concerne l’attitude de condescendance, de méfiance, d’espoir et de peur des bolcheviques face à la Constituante, voir J. Sadoul, Notes sur la révolution bolchevique, page 199 ; le journal II Soviet (le soviet) de Naples du 15 février 1920 et la revue Comunismo, numéro 8/9 du 15 janvier 1920 (article de Lénine).
[67] – Voir les journaux Agitazione (agitation) de Ancône, et L’Avvenire sociale (l’avenir social) de Messine, de 1899 et 1900.
[68] – PJ. Proudhon, Mélanges, volume 1, pages 11–19.
[69] – K. Marx, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte (le dix-huit brumaire de Louis Bonaparte), page 12. Opéré di Marx, Engels e Lassalle, volume I.
[70] – K. Marx, Pour la critique de la démocratie socialiste, page 11. Opéré di Marx, Engels e Lassalle, Vol. II, numéro 6.
[71] – M. Bakounine, OEuvres, volume IV, page 345.
[72] – N. Boukharine, Le Programme des communistes, page 13.
[73] – N. Boukharine, même œuvre, page 15.
[74] – P. Kropotkine, La Conquête du pain, chapitre III, « Le Communisme anarchiste ».
[75] – Article, La Dittatura (la dictature) de E. Leone, dans le journal II Lavoratore (le travailleur) de Trieste, du 22 mai 1920.
[76] – Marx, La guerra civile in Francia (la guerre civile en France), pages 45 et 46. Opéré di Marx, Engels e Lassalle, volume II, numéro 4.
[77] – K. Marx, « Tous les socialistes sans exception entendent par anarchie la chose suivante : une fois les lois abolies, le pouvoir de l’État disparu, les fonctions gouvernementales seront transformées en simples fonctions administratives. » L’alleanza della Democrazia socialista (l’alliance de la démocratie socialiste), page 13. Opéré di Marx, Engels e Lassalle, volume II, numéro 5.
[78] – Voir aussi une lettre de Bakounine à Herzen, en date du 28 octobre 1869, dans laquelle il vante « les mérites énormes » de Marx, spécialement son influence qui empêchait l’infiltration des idées et des tendances bourgeoises au sein du socialisme. Bakounine, Correspondance, éditions Perrin, Paris, pages 288 et 291.
[79] – Saverio Merlino, Pro e contro il socialisme (pour et contre le socialisme). Editions Treves, Milan ; pages 28 et 29.
[80] – Benedetto Croce, Matérialismo Istorico e Economia Marxista. Editions Sandron, Palerme, page 106.
[81] – M. Bakounine, OEuvres. Volume IV, page 374.
[82] – M. Bakounine, OEuvres. Volume IV, page 376.
[83] – M. Bakounine, l’État et [‘Anarchie (en russe), pages 223 et 224 ; La Théologie politique de Mazzini et l’internationale, Neuchatel, pages 69 et 78. Ces notes sont extraites du fameux Anarchismo e Socialisms (anarchisme et socialisme) de Plekano, éditions Critica Sociale, Milan, page 51.
[84] – M. Bakounine, OEuvres. Volume III, page 11.
[85] – On pourra opposer l’exemple du socialisme italien et de ses organisations politiques et économiques. On aurait absolument raison en ce qui concerne le parti, mais de façon toute relative en ce qui concerne la Confédération du travail, pour laquelle il y aurait de nombreuses objections et discriminations à faire. Mais une des raisons pour lesquelles le Parti socialiste italien a pu se sauver du naufrage réside justement en ceci, qu’il est bien moins marxiste dans les faits qu’il ne semblerait ou voudrait paraître.
[86] – N. Boukharine, Le Programme des communistes, pages 13 et 14.
[87] – P. Kropotkine, La Piccola industria in Inghilterra (la petite industrie en Angleterre) (voir revue II Pensiero de Rome, numéro 19 du 1er décembre 1906).
[88] – On peut lire dans un livre récent de Kautsky (Terrorisme et Communisme, Paris, pages 40 et 41) une définition de la dictature qui semble assez claire et objective. Bien que l’auteur soit un adversaire des bolcheviks, elle vaut la peine d’être reproduite : « La dictature est un pouvoir arbitraire, qui naturellement ne peut être exercé que par une stricte minorité, très cohérente, ou bien par un homme seul. Tout groupe plus nombreux nécessite, pour agir en commun, des règles définies à l’avance, un ordre social, des lois. Le type de dictature comme forme de gouvernement est la dictature personnelle. Une dictature de classe comme forme de gouvernement est un non-sens. »
[89] – Cette citation est extraite d’une revue hostile aux bolcheviks (Les Temps nouveaux, Paris, numéro 15 du 15 septembre 1920), qui dans ses attaques contre le bolchevisme russe fait preuve, malgré son contenu libertaire, d’un manque complet de sens révolutionnaire ; mais nous ne croyons pas que la citation soit erronée.
[90] – Marx avait fait une observation assez semblable, il y a de cela soixante-dix ans ; en reprochant à la minorité de la « Ligue des communistes » de son temps leurs conceptions dogmatiques et leur hâte d’arriver au pouvoir. Il ajoutait : « De même que les démocrates ont fait du mot « peuple » une essence sacro-sainte, vous faites de même avec le mot « prolétariat » (K. Marx, Rivelazioni sul processo dei Comunisti [révélations sur le procès des communistes], page 23, volume I de Opere di Marx, Engels e Lassalle.)
[91] – M. Bakounine, Ouvres, volume IV, page 345.
[92] – J. Guillaume, L’Internationale, volume III, page 8.
[93] – Ces phrases, et d’autres déjà citées, sont extraites d’une lettre envoyée à l’auteur par Malatesta, qui se trouvait alors en 1919 à Londres. La lettre fut publiée dans Volontà de Ancône, numéro 11, du 16 août 1919.
[94] – Cette citation est extraite d’un très bel article de Giuseppe Ferrari sur P.-J. Proudhon. (Nuova Antologia, Florence, avril 1875.)
[95] – P.-J. Proudhon, Idée générale de la révolution au xixe siècle. Editions Garnier, Paris, page 180.
[96] – P.-J. Proudhon, Mélanges (articles de journaux). Editions Lacroix, Bruxelles, volume I, page 13.
[97] _ J. Dejacques, Les dictatures providentielles, journal le Libertaire, New York, du 7 avril 1859.
[98] – Voir Saggio sulla Rivoluzione (essai sur la révolution) de Carlo Pisacane, édition de 1894, avec préface de Colaianni, pages 202 et 205.
[99] – M. Bakounine, Œuvres, volume IV, page 261.
[100] – Ce concept est mentionné aussi par L. Michel, dans son livre La Commune de Paris, Stock, Paris, page 165.
[101] – Voir La Comune di Parigi de Malatesta, dans la revue II Pensiero (la pensée) de Rome, numéro 6 du 16 mars 1907.
[102] – Voir Come divenni anarchica (comment je suis devenu anarchiste) de Louise Michel, dans la revue La Protesta Umana (la protestation humaine) de Tunis, numéro 9 du 31 octobre 1896.
[103] – A. Arnould, Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Bruxelles, 1878, volume II, pages 82 et 84.
[104] – G. Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste à Paris, en 1871, éditions Guillaume, Neuchâtel, 1871, page 370 et suivantes.
[105] – A. Costa, La Comune di Parigi dans II Martello (le marteau) de Bologne, numéro 11 du 18 mars 1877.
[106] – La révélation de l’existence de cette force, au congrès de L’Union anarchiste italienne, qui avait eu lieu à Bologne du 1er au 4 juillet 1920, a été une surprise pour les anarchistes eux-mêmes. Il y a désormais en Italie des dizaines de milliers d’anarchistes rassemblés dans quelques centaines de groupes ; et il est à noter que les anarchistes ne sont pas tous regroupés, ni associés et qu’ils ne se connaissent pas tous entre eux. En plus des six ou sept périodiques hebdomadaires ou bihebdomadaires, l’anarchisme édite en Italie un journal quotidien, Umanità Nova de Milan, qui a recueilli en un an plus d’un demi-million de lires de souscriptions, avec un tirage d’environ 50 000 exemplaires. En plus, il existe à côté du mouvement anarchiste le mouvement ouvrier de l’Union syndicale italienne ; étant complètement autonome des différents partis politiques, elle prend des initiatives libertaires, du fait que ses dirigeants sont pour la plupart des militants anarchistes. Cette union compte plus de 300 000 personnes organisées.
[107] – Le présent volume était à moitié imprimé lorsque les éditions Avanti ! ont publié en 1920 Stato e Rivoluzione (État et révolution), de Lénine. Dans son œuvre, Lénine reconnaît la superficialité de Plekhanov, lequel traite l’argument en évitant soigneusement toute l’actualité qui concerne la différence essentielle entre socialisme et anarchie, et accompagne la partie historique de considérations vulgaires qui tendent à démontrer qu’un anarchiste s’y distingue difficilement d’un bandit. (Lénine, Stato e Rivoluzione [État et révolution], page 118.)
[108] – Nous faisons allusion au terrorisme, non seulement dans sa signification particulière, mais aussi dans le sens général de l’usage de la violence, jusqu’à ses limites extrêmes les plus redoutables. Violence qui peut être exercée aussi bien par un gouvernement, par le truchement de ses gens d’armes, que par le peuple au cours d’une insurrection ou pendant la révolution.
[109] – En ce sens, Giovani Bovio disait que la révolution « commet pieusement » des actions cruelles, évite la sensiblerie et la pitié et elle excuse le carnage. (G. Bovio, Dottrina dei parti ti in Europa [doctrine des partis en Europe]), Naples, 1886, page 137.
[110] – Ainsi s’exprime Amadeo Bordiga dans Soviet, journal bolchevique de Naples, le 5 octobre 1919.
[111] – Consulter le Manifeste dans l’édition des Œuvres complètes de Marx, Engels et Lassalle. Volume I.
[112] – C. Radek, L’Évolution du socialisme, page 20.
[113] – P. Kropotkine, revenu en Russie après la révolution, est mort au mois de février 1921 dans un petit village aux environs de Moscou, où il avait vécu deux ou trois ans, entouré par le respect général. Il avait désormais soixante-dix-neuf ans, et travaillait à un de ses livres, L’Ethique. Le fait d’avoir été pendant la guerre le partisan d’un des partis belligérants, et d’avoir soutenu au début de la révolution le régime de Kérensky et la continuation de la guerre pour l’Entente, avait diminué son prestige ; mais tout le monde s’accordait à reconnaître sa bonne foi et l’honnêteté de ses intentions. Cependant, à cause de son attitude, presque tous les anarchistes russes s’étaient détachés de lui. Les derniers temps, il avait envoyé aux travailleurs anglais un long message, dans lequel il fait une critique aiguë du système dictatorial bolchevique, selon la conception anarchiste.
[114] – P. Kropotkine, Fields Factories and Workshops. Nous citons l’édition anglaise, bien qu’il en existe une en français, des éditions Stock ; la première étant, à ce qu’on nous dit, beaucoup plus complète que la deuxième.
[115] – S. Merlino, L’Individualisme dans l’anarchisme, publié d’abord en français par la « Société nouvelle » de Bruxelles, et ensuite en italien (typographie de l’Asino, Rome, 1895).
[116] – Avanti ! de Milan, du 15 décembre 1919.
[117] – P. Kropotkine, La Conquête du pain.
[118] — Avanti ! de Milan, le 6 janvier 1921.
[119] – Les nouvelles que nous recevons nous rendent trop pessimistes pour que nous puissions rester impartiaux vis-à-vis des bolcheviks. Voici d’ailleurs un entretien entre le socialiste italien Mario Guarnieri et le bolchevik Alexandre Schlapnikoff, qui a été entre autres ministre du Travail (voir II Lavoratore (le travailleur) de Trieste, 21 juillet 1920, éditions du soir : « Quelles sanctions sont prises contre les ouvriers indisciplinés ou peu productifs ? » (…) « Il existe dans chaque usine « un tribunal » qui juge les fautes des ouvriers, selon leur gravité, il peut appliquer des amendes, mais peut aller jusqu’à infliger des peines de prison. Si le syndicat dénonce un « abandon de poste », son auteur peut être jugé comme un soldat qui déserterait au front. Pendant la guerre, les ouvriers n’ont pas été militarisés dans les usines. » Toujours le même argument insensé : les bourgeois faisaient ainsi, les militaristes aussi, pour quelle raison nous ne le ferions pas ? Comment ne pas comprendre que cela signifie que l’on devient à son tour militaristes et bourgeois, c’est-à-dire tout le contraire de socialistes ?
[120] – Cette solution libertaire, provisoire du problème agricole, est mentionnée aussi dans le dialogue bien connu Fra contadini (entre paysans) de Malatesta, et qui date de 1882. A Beppe, qui demande si on va exproprier de son petit bout de terre le petit cultivateur qui travaille tout seul et pour son propre compte, et si on dépossédera de sa petite boutique l’artisan qui exerce tout seul son métier, Giorgio (anarcho-socialiste) répond : « Je vous ai déjà dit que chacun à droit à la matière première et aux instruments de travail, donc si quelqu’un possède un petit bout de terre, et pourvu qu’il le travaille lui-même, de ses propres bras, il pourra le garder ; on lui donnera même les ustensiles perfectionnés, les engrais et toute autre chose dont il aura besoin, dans le but de tirer de la terre le plus grand profit possible. Certes, il serait préférable qu’il mette tout en commun ; mais pour cela, point n’est besoin de forcer qui que ce soit, car tous reconnaîtront l’intérêt du système de la communauté. »
[121] – S. Faure, La Douleur universelle, éditions Stock, Paris.
[122] – E. Colombino, socialiste réformiste et membre de la Confédération du travail, s’est rendu en Russie pendant l’été 1920 : dans un article dans la Stampa, de Turin (27 novembre 1920), il nous dit que les comités ou conseils d’usine existent toujours, mais qu’ils ne peuvent plus exercer que des fonctions exclusives de contrôle, avec la même utilité qu’ont chez nous les commissions internes. Le menchevik Martoff, dans un discours au Congrès des socialistes indépendants allemands, va encore plus loin (voir Critica sociale (Critique sociale) de Milan du 1er janvier 1921) : il soutient que le gouvernement bolchevique a substitué à l’autogouverne-ment des travailleurs, par le moyen des conseils d’industries, la dictature des ingénieurs. Nous laissons à Colombino et à Martoff la responsabilité de leurs assertions.
[123] – M. Bakounine, OEuvres, volume 11, pages 296 et 297.
[124] – C. Pisacane, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848–1849 [guerre combattue en Italie pendant les années 1848–1849), page 317. Voir aussi les Considérations, page 299 et suivantes.
[125] – C. Pisacane, Saggio sulla rivoluzione [essai sur la révolution, page 203 (lire tout le chapitre de la page 185 à la page 208).
[126] – Le livre en question a pour titre : Ordinamento e costituzione delle milizie » italiane, ossia, come ordinare la nazione armata (organisation et constitution des milices italiennes ou comment organiser la nation armée. Il a été réédité en 1901 par les soins de Ghisleri, avec une préface de Rensi, par l’éditeur Sandron de Palerme.
[127] – C. Pisacane, Come ordinare la nazione armata (comment organiser la nation armée), pages 148 à 154.
[128] – Se rappeler, à ce propos, la tragique expérience hongroise. Parmi les causes du désastre subi par la République communiste magyar, on peut compter les hostilités ouvertes contre la Roumanie, alors que les soldats n’étaient pas convaincus de se battre pour la défense de la révolution. Ceux-là même qui avaient défait les Tchécoslovaques en se défendant, ont été défaits à leur tour, quand ils ont attaqué les premiers les Roumains.
[129] – ID., ibid., page 137.
[130] – Il en fut ainsi effectivement : voir Ordine Nuovo de Turin, numéro 29 du 13 décembre 1919. A propos de Makhno (nous ajoutons des notes, alors que ce livre est terminé depuis quelques mois), il faut noter que la campagne de dénigrement contre sa personne, ses faits et gestes, a recommencé après qu’il eut battu Dénikine et Wrangel. Dans les journaux socialistes et bolcheviques, il n’y a pas eu jusqu’à aujourd’hui de nouvelles précises. Makhno est revenu à l’opposition violente et à l’insurrection contre le gouvernement de Moscou : il semblerait que ce soit dans le but de reconquérir la liberté d’une vie autonome en Ukraine et dans la Russie du sud. Il faut cependant considérer que, malheureusement, l’ambiance de guerre doit exercer aussi dans le camp de Makhno et sur lui-même sa néfaste influence, car elle développe l’esprit militariste, la prépotence, l’oisiveté et l’esprit d’autorité chez les chefs. On ne peut donc pas exclure que plusieurs des critiques élevées contre Makhno soient justifiées, et que les faits évoluent d’une façon bien moins libertaire et anarchiste de ce que nous voudrions. On sait aussi que si Makhno trouve beaucoup d’aide chez la masse paysanne, cette aide n’est pas totalement désintéressée. En effet, les cultivateurs des terres méridionales de la Russie, terres très fertiles, ont tendance à soustraire les céréales aux réquisitions des bolcheviks, qui en ont pourtant un urgent besoin pour donner à manger aux pays bien moins lotis du nord, et qui ont raison de demander du blé. Mais cela n’enlève rien à nos arguments sur la possibilité « relative » d’une défense militaire moins autoritaire de la révolution et ne justifie pas le procédé du gouvernement de Moscou, qui après s’être servi de Makhno et des anarchistes du sud au moment du danger, au lieu d’établir avec eux une entente fraternelle, les a mis devant le dilemme : ou se soumettre ou déclencher la guerre civile. (N.d.A.) Il semble que L. Fabbri, a été victime de la campagne d’intoxication menée par les bolcheviks. Voir à ce sujet l’ouvrage Nestor Makhno, le cosaque de l’anarchie, d’Alexandre Skirda, éditions A.S., 1982, qui rétablit la vérité historique. (Note dé l’édition française.)
[131] – Voir pages 79–80 l’épisode relaté par le bolchevik Victor Serge sur l’action des anarchistes de Petrograd, en défense de la révolution menacée aux portes de la ville par les armées de Judenitch. A propos de la liberté laissée aux anarchistes dans la république des soviets, nous avons relaté (page 94) que d’après certains témoignages, aucun journal anarchiste n’était autorisé. Or d’après Nofri et Pozzani, il semblerait – au contraire – et cela nous semble beaucoup plus plausible, qu’à Moscou soit édité un journal anarchiste, Volia truda, (la volonté du travailleur) (page 43 du livre La Russia corne (la Russie, comment est-elle ? de Nofri et Pozzani). Nous en prenons donc acte.
[132] – L’Avvenire anarchico (l’avenir anarchiste) de Pise, numéro du 22 août 1919.
[133] – Il Risveglio (le réveil) de Genève du 8 novembre 1919.
[134] – e. Malatesta, dans une entrevue avec Avanti ! de Milan, décembre 1919.