Grupo Ruptura
Les classes dans la société capitaliste
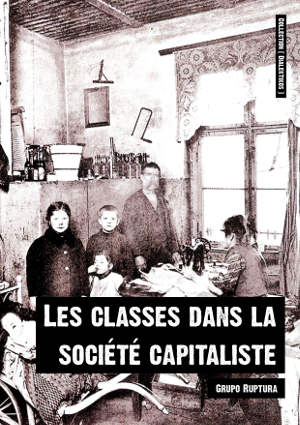
Les classes sociales dans le capitalisme
La classe comme relation sociale
Des solutions ? Coopératives, auto-emploi…
Traversé par la contradiction…
Quelques bases matérielles de la domination capitaliste
Introduction
Depuis que nous avons commencé à éditer Ruptura, nous l’avons toujours envisagé plus comme une question que comme une réponse. Une invitation à la réflexion et à l’analyse plus qu’une tentative d’étaler notre science, bien que tout le monde ne l’ait pas pris ainsi. C’est pour cela que nous n’avons jamais hésité à exprimer nos doutes comme à défendre nos convictions. Dans le numéro 2, nous avons essayé d’éclaircir le fait que notre revendication d’une posture de classe partait de l’intuition que cela constitue une réalité fondamentale qui détermine nos vies et le monde dans lequel elles se développent, et non pas de la souscription à une idéologie déterminée. Cependant, comme certains nous ont fait la critique, nous n’avions expliqué dans aucun numéro ce que signifiait en détail, pour nous, les classes, ce que nous entendions par prolétariat et bourgeoisie, ce que signifie la lutte des classes et surtout, quelle importance nous donnons à toutes ces réalités. Dans cet article, nous essaierons de faire une première approche de l’analyse des classes dans la société capitaliste.
Avant de commencer, nous aimerions faire une série de précisions. Nous ne sommes pas intéressés par une analyse de type universitaire, ce qui ne veut pas dire non plus que nous allons nous limiter à dire quatre banalités et comme nous ne basons pas notre « prestige » ni notre travail sur la validité de notre théorie, nous n’avons aucun besoin de la défendre becs et ongles si quelqu’un nous démontre que nous nous trompons. De même, nous comprenons qu’il y a des questions importantes et d’autres qui ne le sont pas autant, ou qui ne méritent pas que l’on s’arrête sur elles, aussi réelles soient-elles. Nous n’adhérons à aucune idéologie particulière (marxiste, anarchiste, situationniste, insurrectionnaliste, etc.) c’est pourquoi nous n’avons pas besoin de mettre des citations de tel ou tel auteur pour appuyer nos arguments, même si nous avons utilisé systématiquement ces mêmes auteurs, et si ce que nous disons ne cadre pas avec les orthodoxies, invariances ou principes, tactiques et finalités, tant pis pour eux/elles.
Ce qu’il nous intéresse de comprendre, c’est ce qu’est le prolétariat, ce que cela implique d’être un prolétaire ou un bourgeois, c’est mieux comprendre comment fonctionne le système capitaliste, mais surtout, mieux comprendre comment fonctionne sa destruction : les conflits, contradictions et crises qui se produisent en son sein. Pour cela nous considérons nécessaire de comprendre comment le capitalisme se base sur l’exploitation et la domination d’une classe par une autre, et quelles sont les caractéristiques de chacune. Cela ne signifie pas que le capitalisme et ces conflits peuvent être réduits aux luttes au sein du monde du travail. De fait, comme nous essaierons de l’expliquer, l’aspect lié au travail ou économique, aussi important soit-il, est simplement un des aspects de la lutte des classes. Pour ces motifs, nous nous centrerons fondamentalement sur les aspects de notre réalité la plus proche en tant que prolétaires, et nous consacrerons peu de temps à des relations qui, bien qu’importantes pour comprendre la société, restent relativement lointaines à l’heure de la pratique, comme par exemple les relations entre différents types de capitalistes, etc.
Les classes sociales dans le capitalisme
Le capitalisme est une société basée sur la production et l’échange de marchandises. Cela signifie en dernière instance, que pour acquérir n’importe quel service ou objet nécessaire pour vivre, il faut avoir l’argent pour l’acheter. En principe, on pourrait penser que ce qui caractérise les différentes classes, c’est la façon dont elles obtiennent l’argent : les travailleurs reçoivent un salaire et les capitalistes une partie de la plus-value que ces derniers génèrent, c’est-à-dire un bénéfice. Cependant, ceci est bien plus une conséquence de l’appartenance à différentes classes que ce qui les définit. Les travailleurs reçoivent un salaire parce qu’ils sont des travailleurs, et non l’inverse. Ce qui définit les classes, c’est leur relation avec les moyens de production, et à travers eux, leur relation avec le reste de la société et le reste des autres classes. Le prolétariat se définit en premier lieu en négatif, comme celui qui est dépossédé de tout moyen de production qui ne soit pas sa propre capacité de travail. Cela est évidemment rendu possible par l’existence d’une autre classe, la bourgeoisie, qui est propriétaire des moyens de production nécessaires pour reproduire cette société. L’important ici, c’est de voir ce que cette dépossession nous impose au quotidien : nous les prolétaires ne disposons pas des moyens et mécanismes pour mener la vie que nous voulons, pour produire la société dans laquelle nous voulons vivre, car pour survivre dans la société capitaliste nous avons besoin d’argent pour acheter les marchandises que celle-ci produit. Les prolétaires disposent de seulement trois manières d’obtenir l’argent nécessaire à l’achat des marchandises : en travaillant, en volant ou en mendiant. Faire telle ou telle chose est une décision « libre » de chaque prolétaire, étant donné que, à la différence d’autres temps et lieux, celui des serfs et des esclaves, les prolétaires sont désormais égaux juridiquement aux bourgeois, nous ne sommes pas obligés de travailler pour eux. Nous pouvons « choisir » entre leur vendre notre force de travail… ou mourir de faim. Évidemment cette « liberté » et ce « choix » sont purement formels et cachent la nécessité de travailler pour n’importe quel capitaliste[1] mais même ainsi ils ont une importance cruciale pour le fonctionnement du système et, comme nous le verrons plus loin, pour ses mécanismes de domination.
Cependant, comme nous le disions, le travail salarié n’est pas la seule option qu’ont les prolétaires pour survivre. Demander ou prendre sont les autres manières restantes à celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas trouver un travail salarié. De nos jours, cela peut sembler être de la branlette intellectuelle, vu que la majorité des gens « normaux » dédient leur temps à travailler. Mais si on va un peu plus loin que les apparences, on peut voir que généralement personne ne rate une occasion de s’arranger les choses au boulot, de télécharger des films, de tricher avec la balance de fruits et légumes au supermarché, etc., etc.[2]
Le fait que la grande majorité des prolétaires ait le travail salarié comme source, quasi exclusive ou majoritaire, d’argent n’est pas un motif pour faire de celui-ci ce qui définit le prolétariat, vu que c’est l’existence du prolétariat qui, tant historiquement que logiquement, détermine l’existence du travail salarié, bien que postérieurement la relation capital-travail reproduise et renforce la division entre prolétariat et bourgeois.[3] Il est important de souligner ce point pour diverses raisons. Nous éviterons ainsi de tomber dans l’ouvriérisme qui réduit le prolétariat au salarié, ou pire encore à l’ouvrier d’usine, mais également dans l’« anti-ouvriérisme » (et sa mythification de la délinquance et de « la débrouille ») ou dans des distinctions entre « intégrés » et « exclus ». Avec la crise que l’on subit et le peu de signes de récupération économique qui s’annoncent à l’horizon, le nombre de gens au chômage et/ou qui vont être contraint à des formes plus ou moins illégales, ou aux magouilles, pour obtenir de l’argent augmenteront, et avec eux, augmenteront la répression comme les tentatives de nous diviser. Salarié, chômeur, femme au foyer, étudiant, voleur… sont les différentes formes que le prolétariat peut assumer dans la société capitaliste, mais, dans leur défilement, ils constituent dans le même temps autant d’éléments d’une unité organique dans laquelle, loin de s’opposer, ils sont tous également nécessaires, et cette égale nécessité est ce qui constitue la vie de l’ensemble. Comprendre que nous sommes tous membres de la même classe, avec des intérêts communs à long terme, sera crucial pour développer des formes et des pratiques de résistance contre la crise.
Classe et détermination
Arrivé à ce point, il est important de se demander ce que cela implique d’être un prolétaire ou un bourgeois. Les courants les plus déterministes, le marxisme comme l’anarchisme, ont voulu voir (ou plutôt ont voulu nous faire voir) dans le prolétariat à peine moins qu’un nouveau messie que le développement des forces productives, ou un autre facteur comme l’éducation libertaire, s’organiser dans un syndicat, etc., amènerait à s’affronter chaque fois plus directement contre la bourgeoisie et à établir le communisme (libertaire si c’est le cas)... Il est aujourd’hui évident que cela n’est pas ainsi.
Les relations sociales capitalistes se caractérisent par le fait que les relations entre les personnes s’effectuent à travers la médiation d’objets (marchandises, moyens de production, billets, pièces de monnaie…), de sorte que ces choses acquièrent des propriétés qui appartiennent réellement aux relations dont elles assurent la médiation. Par exemple, les choses ont un prix, une valeur du fait d’être produites dans une société dans laquelle une série de producteurs et de consommateurs privés socialisent la production à travers le marché. De même, de l’argent de la banque produit un intérêt, mais il le produit parce que la banque se charge de le convertir en capital (ce qui implique de l’investir dans une entreprise pour obtenir une part déterminée de la plus-value arrachée à ses travailleurs), et non pas parce que c’est de l’argent. C’est ce que l’on appelle traditionnellement le « fétichisme » de la marchandise, et par extension, de l’argent, du capital, etc.
L’autre face de la médaille est que les gens agissent comme personnification de ces « choses » dans lesquelles se sont cristallisées certaines relations sociales. Quand nous entrons dans un magasin, nous ne sommes pas nous-même pour le vendeur, mais l’argent qu’il y a dans nos poches ou sur notre compte courant. De même, ce que nous voyons uniquement derrière le vendeur, c’est ce que nous sommes venus acheter. De la même manière, pour le capitaliste, nous sommes seulement de la force de travail à exploiter, tout comme pour nous, il est seulement la feuille de paie qu’on doit recevoir.[4]
Comme nous le disions, appartenir à une classe ou à l’autre va déterminer les problèmes que nous aurons à affronter dans la société. Si tu es prolétaire, l’ensemble des relations sociales capitalistes t’oblige à choisir entre travailler, voler ou mendier pour trouver l’argent nécessaire pour vivre. Celui qui décide de voler devra décider qui il vole, les riches ou les pauvres, et il sera confronté directement à la loi et aux moyens matériels qui la défendent, etc. Celui qui décide de travailler pour un patron, finira tôt ou tard par se confronter à lui, et pas nécessairement parce que les prolétaires sont toujours disposés au conflit de classe, mais parce que l’antagonisme de classe est quelque chose d’inhérent et de nécessaire à la relation entre capitalistes et travailleurs. Pour obtenir un plus grand bénéfice, le patron essaiera de baisser le salaire, ou de ne pas l’augmenter, d’appliquer de plus grands moyens de contrôle pour s’assurer que le travailleur ne chôme pas au travail, il essaiera d’accélérer les rythmes de travail, etc. De même que nous essaierons nous planquer, de travailler le moins possible et toutes les petites choses… Ce n’est pas nous qui choisissons la lutte des classes, c’est la lutte des classes qui nous choisit.
Ceci dit, ce que la condition de prolétaire ne détermine pas c’est l’option qui sera choisie dans chaque cas. Les décisions que chacun prend seront le résultat du croisement de plusieurs facteurs : culturels, traditionnels, l’éducation reçue, la situation personnelle à ce moment, les expériences antérieures, comment répond le reste des compagnons, la concurrence avec d’autres prolétaires, etc. La « somme », pour le dire ainsi, de tous ces facteurs est ce qui déterminera en dernier ressort si quelqu’un décidera de squatter une maison, de l’acheter, de la louer, s’il volera une banque, dans la supérette du coin, ou à la sortie d’un distributeur de billets du quartier, s’il fera face suite à une humiliation de la part du chef ou s’il baissera la tête, s’il décidera de lutter pour une augmentation de salaire ou s’il cherchera un autre boulot… Nos actes ne sont ni plus ni moins que les reflets de notre position de classe. Nous ne sommes pas, nous les prolétaires, les chiens de Pavlov, nous voyageons chacun avec notre propre histoire sur le dos et, en dernière instance, la synthèse de toutes nos expériences passées et présentes est ce qui décide de notre comportement face à une clochette. Pour résumer d’une manière simple, la position de classe nous pose les questions, mais nous sommes celles et ceux qui choisissons les réponses.
Rien ne permet de dire qu’un prolétaire va se lever glorieusement un jour et lutter pour instaurer le communisme. La seule chose sûre, c’est que c’est la seule manière de se libérer collectivement du capitalisme et de ces aliénations, à travers la révolution sociale. Que nous prolétaires, décidions de nous libérer en « détruisant l’ordre social actuel » ou de continuer à supporter l’exploitation et l’aliénation capitaliste est une question différente, en lien certes, mais différente et nous nous y attèlerons plus tard.
Il en va de même pour l’autre grande classe de la société capitaliste. Bien que l’on représente parfois les capitalistes comme des méchants messieurs avec fouet et haut de forme, la réalité est assez différente. En fait, certains d’entre eux sont sûrement de braves gens, mais s’ils veulent faire des bénéfices, s’ils veulent que leur capital fructifie, il faudra bien qu’ils serrent la vis à leurs travailleurs tôt ou tard. Ce n’est ainsi pas du fait d’une quelconque méchanceté congénitale du capitaliste, mais parce que la concurrence du reste des entrepreneurs l’obligera à cela, qu’il le veuille ou non. Bien que ce soit seulement pour clarifier, nous dirons que les moyens de production ne sont pas immédiatement du capital, et que leur possession ne transforme pas immédiatement leur propriétaire en capitaliste, pour cela il est nécessaire qu’il les utilise pour obtenir une plus-value à travers l’exploitation des travailleurs. Ainsi, un charpentier ou un traducteur freelance qui travaillent en indépendants dans leur petit local ou leurs maisons, avec peu d’outils, ne sont évidemment pas capitalistes de par le simple fait de posséder leurs propres moyens de production, mais ils le seraient si, par exemple, ils employaient un assistant qui travaillerait dans le même local avec les mêmes outils. Si quelqu’un a un doute à ce sujet, que pense t-il que répondrait le charpentier si l’assistant lui demandait de doubler son salaire. Le capital n’est pas un ensemble de choses, mais une relation sociale entre personnes passant par l’intermédiaire de choses.
La classe comme relation sociale
Il est important de remarquer que toutes ces relations qui dérivent de la propriété ou non des moyens de productions, sont des abstractions de la vie réelle et, par conséquent, elles ne s’excluent pas nécessairement entres elles. Si nous confondons les abstractions que nous construisons pour comprendre la réalité avec la réalité elle-même, nous arrivons à des conclusions erronées, la plus commune de celles-ci est d’essayer de faire rentrer chaque personne dans une classe comme si ces dernières étaient des cases sociologiques.
Si nous nous penchons sur la réalité, nous nous trouvons face à une complexité beaucoup plus grande, qui échappe à ces tentatives de catalogage unilatéral typiques de la sociologie positiviste. Pour éviter cela, il faut remarquer que comme toute catégorie sociale, les classes sont des abstractions d’une relation sociale, d’un ensemble de relations sociales. L’essence du prolétariat, c’est l’ensemble des relations sociales qu’il se voit obligé d’établir du fait de sa dépossession des moyens de production. La même chose pourrait être dite du capitaliste. Appartenir à une classe est une manière d’être dans la société, d’être en relation avec elle.
Par exemple, auparavant nous avons dit que la femme au foyer, le salarié, le chômeur, le voleur, etc. étaient différentes formes concrètes dans lesquelles pouvait s’exprimer le prolétariat dans la société capitaliste. En réalité, toutes ces catégories n’expriment que des manières d’être en relation avec le reste de la société. On ne peut les considérer chacune de manière abstraite, isolées de la totalité des relations sociales. Entre autres choses, cela implique qu’on ne peut essayer de ranger chaque personne dans une de ces cases, comme si elles étaient excluantes les unes des autres. Il est normal, en tant que prolétaire, que nous passions de l’une à l’autre au cours de notre vie (université – chômage – travail précaire – chômage – formation – travail –…) et que nous en combinions plusieurs à la fois (combien de femmes peinent au foyer avant 8 heures de travail quotidien, combien essayent de décrocher un examen en même temps qu’ils travaillent, combien touchent une allocation tandis qu’ils travaillent au noir).
Cela n’a pas non plus de sens d’opposer les travailleurs aux « délinquants », comme si c’était des entités pures qui s’excluent. D’où que vienne cette idéalisation, de l’ouvriérisme ou de la mythification de la délinquance, elle est simplement fausse. En laissant de côté les cas les plus extrêmes, la majorité des fois le prolétariat gagne sa vie en recourant fondamentalement au travail, sans mépriser le vol chaque fois qu’il est possible (et surtout chaque fois qu’il est peu probable de se faire choper) : vols au boulot, petits larcins lors des achats, téléchargements sur internet, squat de maison abandonnées, etc. Dernièrement, la précarité a fait que de nombreux parents servent de matelas financier à leurs enfants, en les entretenant, tandis qu’ils travaillent avant de devenir indépendants et même après, quelque chose qui, formellement du moins, ne se différencie pas beaucoup de la mendicité (donner de l’argent à quelqu’un en échange de rien).
Une fois qu’on passe de la logique des petites cases (chaque personne rangée dans une catégorie abstraite et pure) à la logique des relations sociales (chaque personne « traversée » par des relations qui forment et déterminent les problèmes, les contradictions et les conflits auxquels on se confronte), nous voyons que la réalité concrète est la synthèse de multiples déterminations et, par conséquent, unité du multiple.
C’est ce qui se produit lorsqu’une même personne se voit traversée simultanément par deux positions de classe contradictoires, en se mettant en relation à travers celles-ci avec différentes personnes. Par exemple, rien n’empêche que quelqu’un soit membre associé d’une entreprise « à mi-temps », étant par conséquent une personnification du capital et qu’elle travaille dans un bureau « l’autre moitié du temps », étant par conséquent une personnification du travail, bien que cela ne soit pas le plus courant.
Simplement, cette personne affrontera différents problèmes dans les différentes facettes de sa vie et probablement elle fera à ses employés ce que ses chefs lui font. On pourrait dire qu’elle se trouve dans une position contradictoire. Dans ce cas concret nous ne trouvons aucun type de relations différentes de celles déjà traitées. Face à un groupe de gens, elle se trouve en relation en tant que salariée et face à un autre groupe, en tant que capitaliste. Si nous nous centrons sur l’individu et que nous essayons de le classifier, il semble être capitaliste ET travailleur (serait-il alors de la classe moyenne ?). Si nous changeons de perspective et nous nous centrons sur les relations qu’il maintient, ce que nous voyons c’est qu’il est ou bien capitaliste ou bien salarié.
Ce dernier exemple nous permet de changer de perspective, passant d’une conception de la classe comme un ensemble défini d’individus à la conception de la classe comme, pour le dire ainsi, un ensemble de relations sociales qui traversent les individus, les positionnant et les affrontant de manière antagonique.
En principe, il peut paraître étrange de concevoir les classes sociales en termes de relations sociales et non en tant que groupes de personnes. Cependant, de même que le capital n’est pas un ensemble de choses mais une relation sociale entre personnes passant par la médiation de choses, la classe n’est pas un ensemble de personnes mais un ensemble de relations entre personnes passant par la médiation de choses : l’argent, les marchandises, les moyens de production.
Quelles sont ces relations ? Bien que, comme nous l’avons dit auparavant, le prolétariat ne puisse être réduit aux travailleurs salariés, les relations qu’établissent les prolétaires entre eux et avec le reste de la société dépendent essentiellement de la relation entre salarié et capitaliste, étant donné que, que nous le voulions ou non, la bourgeoisie obtient ses bénéfices de l’exploitation basée sur cette relation.
En tant que prolétaires, les relations que nous établissons entre nous passent par la médiation des relations qui nous mettent face aux capitalistes. Les travailleurs d’une même entreprise s’opposent entre eux pour avoir les faveurs du chef, pour des postes à responsabilités, etc. Les chômeurs sont en compétition avec les travailleurs pour les postes de travail. Les étudiants ne sont pas plus que de la marchandise force de travail en cours de formation pour le marché du travail, ceci est l’essence de l’éducation capitaliste. Les femmes au foyer sont chargées de la reproduction privée de la force de travail, leur dépendance par rapport à leur mari est l’expression familiale d’une relation de classe déterminée. Le vol, les stratagèmes, etc., sont des manières d’éviter le travail quand on ne veut pas travailler ou de le remplacer lorsqu’on ne trouve pas de job bien qu’on en cherche un.
Évidemment, la grande majorité d’entre nous se situe de manière exclusive ou fondamentale dans un des pôles de ces mêmes relations, ce qui permet que le concept de classe comme groupe d’individus ait une apparence réelle, c’est-à-dire que si nous prenons ces individus qui personnifient uniquement le travail, nous pouvons construire avec eux un prolétariat « pur et dur ». Le problème c’est que quand nous allons aux limites de cette conception, les choses commencent à ne pas coller et apparaissent les problèmes typiques des conceptions sociologiques : strates intermédiaires, subdivisions, devoir introduire de nouveaux critères de classification, etc. Dans les parties suivantes, nous allons nous occuper de ces limites.
« Classes moyennes » ?
Chaque fois qu’est posée la question des classes sociales apparaît la question des dénommées « classes moyennes », concept trompeur s’il en est. L’idée que « nous sommes tous de la classe moyenne » a été une des principales bombes idéologiques que la bourgeoisie a utilisée contre le prolétariat. Comme l’expression en elle-même ne fait référence à rien de plus qu’à une position intermédiaire entre deux extrêmes indéfinis, dépendant de l’expérience de chacun, il est facile de se convaincre qu’un tel est de la « classe moyenne ».
Si un travailleur qui bosse depuis 20 ans dans un bureau avec un bon salaire se compare d’une part avec le travailleur précaire de la sous-traitance du nettoyage qui est à côté de lui et d’autre part avec l’architecte propriétaire du bureau de l’étage du dessus, évidemment il est de la classe moyenne. Si le précaire se compare avec l’immigrant illégal qui lui vend des CD et avec l’employé de bureau ou l’architecte, il est de la classe moyenne. Et si l’architecte se compare avec l’employé de bureau, le précaire et l’immigrant d’un côté et, d’un autre côté, avec le banquier à qui il demandera un prêt pour le prochain chantier, c’est lui la classe moyenne. Et ainsi, grâce à l’infinie variation des salaires et positions sociales au sein des diverses classes sociales ou entre elles, nous pouvons tous et toutes vivre dans le soulagement et la jalousie de celles et ceux qui sont au milieu.
Les classes moyennes sont une espèce de boîte à tiroirs sociologique dans laquelle mettre celles et ceux qui ne cadrent apparemment pas avec un des quelconques critères classificatoires utilisés. En général, on a coutume d’englober basiquement, d’un côté, tous ces auto-employés qui n’ont pas de salariés et les dénommées « professions libérales » (avocats, médecins, etc.), c’est-à-dire la dénommée « petite bourgeoisie ». D’un autre côté, tous ceux qui occupent des positions « intermédiaires » dans la hiérarchie du travail : depuis le petit cadre jusqu’au personnel de direction embauché par l’entreprise.
Le premier groupe reçoit parfois le nom de « vieille classe moyenne » et le second celui de « nouvelle classe moyenne ». Dans la partie suivante, nous verrons qu’en réalité il s’agit de relations sociales différentes.
La « petite bourgeoisie »
Un terme que les marxistes ont tant tripoté avec leurs accusations de « petit bourgeois » suscite quasiment du dégoût quand on l’utilise. Classiquement, il se réfère à celles et ceux qui possèdent leurs propres moyens de production mais qui n’ont pas de salariés à leur charge (par exemple les petits commerces ou ateliers artisanaux dans lesquels il n’y a souvent que du travail familial non salarié) et par conséquent ils n’exploitent personne.
L’étiquette de « classe moyenne » survient parce qu’ils partagent des caractéristiques apparemment associées à la bourgeoisie (posséder ses moyens de production, une petite boutique ou un atelier, quelques outils, etc.) et au prolétariat (ce sont eux-mêmes qui travaillent). Néanmoins, la réalité est autre. Le capital est une relation sociale, c’est pourquoi il ne suffit pas de posséder des moyens de production, il faut les utiliser pour exploiter le travail salarié, qui n’est pas simplement du travail, mais du travail qui se réalise en échange d’un salaire. Un petit charpentier autonome, le propriétaire d’un magasin « Tout à un euro », un photographe professionnel ne sont donc pas des capitalistes sauf s’ils embauchent un assistant salarié. Ils ne sont pas non plus des « travailleurs » sauf au sens purement physique, et non social, du terme.
En réalité, quand nous parlons de petite bourgeoisie, nous considérons une relation complètement différente des relations capital-travail, étant donné que ce sont des petits producteurs indépendants de marchandises, considérés comme des restes d’un « mode de production antérieur » au capitalisme, d’où le nom de « vieille classe moyenne ». Les relations petites-bourgeoises sont des relations confinées à la sphère de l’achat-vente de marchandises différentes de la force de travail, des relations mercantiles entre des sujets formellement égaux. En tant que relation sociale distincte, la petite bourgeoisie est confrontée à des problèmes différents de ceux du prolétariat. Bien que les relations mercantiles soient aussi des relations fétichistes (vu qu’elles s’établissent à travers des marchandises) et aliénées (vu qu’elles sont soumises au produit de leur propre activité aliénée, dans ce cas le marché), cette aliénation est complètement distincte de celle du prolétariat. Le salarié expérimente l’aliénation comme une imposition directe de la part du capital, que nous ressentons sous la forme de son autorité personnifiée dans nos chefs ou sous la forme de l’accablement d’être soumis à nos moyens de travail. Tandis que le petit-bourgeois expérimente l’aliénation sous la forme de la soumission indirecte aux lois impersonnelles du marché, de la concurrence des grandes multinationales, des chutes de prix, des intérêts qu’il faut payer à la banque pour maintenir la boutique, etc.
Des solutions ? Coopératives, auto-emploi…
Les coopératives méritent une mention à part, surtout du fait de l’importance que leur accorde beaucoup de monde comme moyen pour changer la société capitaliste. Clarifions le fait que nous nous référons aux entreprises coopératives tournées vers le marché et non à d’autres schémas possibles de production-consommation, dont la critique suit un autre chemin. Personnellement, nous n’avons rien contre celles et ceux qui cherchent à gagner leur vie en montant une coopérative, cela nous paraît être une manière parmi d’autres de gagner sa croûte dans la société capitaliste. Une manière qui a ses particularités propres. La majorité de celles et ceux qui optent pour l’auto-emploi, seuls ou en groupe, ont dans l’idée, surtout, de ne pas avoir de chef, de gérer eux-mêmes leur temps, de gagner en indépendance et en autonomie, etc. Le problème est que, dans une société capitaliste, ils entrent en concurrence d’égal à égal avec le reste des entreprises, raison pour laquelle ils sentent d’autant plus la pression de la concurrence, de telle manière que la recherche d’autonomie et du fait de ne pas avoir de chefs se transforme au final en responsabilités, boulots interminables, accablements divers et en ce que beaucoup de celles et ceux qui en ont souffert définissent comme « auto-exploitation ». Formellement, les coopératives endurent collectivement ce que les petits commerçants endurent individuellement, ce qui peut se traduire en problèmes collectifs internes quand la pression du marché redouble ou quand il faut faire face à une mauvaise passe. Les bonnes passes ne sont pas meilleures vu qu’en général il n’est pas facile de faire rentrer des nouvelles personnes dans des coopératives déjà établies.[5]
Du fait des problèmes mentionnés, nous ne considérons pas que l’établissement de ce type de projets autogérés coopératifs soit une voie utile pour le changement social, encore moins lorsqu’ils se mêlent avec des projets de type politique (ce que les plus pédants du coin ont appelé « entrepreneuriat biopolitique »), en ce que ces derniers peuvent aboutir à se sacrifier aux nécessités économiques de la coopérative.
C’est un cas distinct que celui des usines récupérées, abandonnées par leurs propriétaires et remises en marche par leurs travailleurs. Bien que nous croyons qu’à moyen et long termes elles présentent les mêmes problèmes que les coopératives, les usines récupérées surgissent d’une situation extrême dans laquelle les travailleurs doivent aller de l’avant, et nous ne gagnons rien à jouer les purs, critiquant pour critiquer, mais rien non plus en leur vendant la moto de l’autogestion ou l’idée qu’ils sont le germe de la société nouvelle. En réalité, il faudra se positionner par rapport à chaque cas concret, étant donné qu’en lui-même le fait que des travailleurs prennent les rênes de leur usine peut signifier beaucoup ou rien.[6]
Traversé par la contradiction…
Le second groupe que l’on a l’habitude d’inclure dans la classe moyenne est celui que formerait tous les « cadres intermédiaires » de la hiérarchie du travail. Suivant les critères ou les auteurs cela inclurait depuis un responsable commercial jusqu’à un haut dirigeant. Il n’est pas nécessaire d’avoir été à l’université pour voir qu’un haut dirigeant de la Banque de Santander n’est pas la même chose qu’un responsable d’équipe chez McDonalds ou qu’un superviseur d’un call-center (en anglais dans le texte – NDT). Mais il ne faut pas non plus être très intelligent pour voir que, dans le fond, un chef est un chef. Cette contradiction apparente a une solution assez simple : elle représente une réalité qui en elle-même est contradictoire. On s’explique.
Dans le fond, le capitaliste n’est rien de plus que la personnification d’une relation sociale, c’est-à-dire qu’il représente un des pôles de ladite relation sociale (de même que le salarié représente l’autre pôle). En tant que propriétaire des moyens de production, être la personnification du capital implique basiquement deux choses : l’organisation et la supervision du processus de travail et la propriété des produits issus de celui-ci, en dernière instance le droit à une partie de la plus-value. Le développement du capitalisme a permis que ces fonctions se dissocient partiellement ou totalement : grâce aux actions, bons, etc., on peut obtenir des bénéfices sans avoir à se salir les mains en supervisant un commerce (les dénommés « rentiers ») et on peut superviser une affaire sans être le propriétaire de celle-ci. Ce dernier point est, sans aucun doute, la figure la plus controversée : du responsable de base au personnel de direction. Nous laisserons de côté ces derniers[7] pour nous centrer sur ces prolétaires qui occupent des positions de supervision des travaux. Rien n’empêche qu’on puisse embaucher un prolétaire pour qu’il agisse comme représentant du capitaliste et, par conséquent, comme personnification du capital. Cela ne conduit pas à ce qu’il cesse d’être prolétaire, il ne cesse pas non plus d’être salarié, simplement il se convertit en une espèce de « représentation salariée du capital » et, comme tel, il est traversé par des relations contradictoires, étant donné que face à ses subordonnés il est la représentation du capital, tandis que face à ses supérieurs dans la hiérarchie du travail, il est la représentation du travail. On pourrait dire que l’exploitation du travailleur par le capital se réalise ici à travers l’exploitation du travailleur par le travailleur. Qu’implique ceci dans la pratique ? Qu’il sera confronté simultanément aux problèmes qui assaillent le capital (comme obtenir une meilleure efficacité, de plus grands bénéfices) et à ceux qui assaillent le travailleur (avoir un supérieur qui lui organise le travail, sentir la pression du chômage ou celle de la compétence d’autres prolétaires, ses subordonnés, disposés à occuper son poste, etc.), devant choisir dans chaque cas de quel côté il se met.[8]
Un autre cas particulier de relations de classe contradictoires, c’est celui qui se produit avec la dénommée « financiarisation des économies domestiques ». Celle-ci se présente majoritairement sous deux formes : quand l’épargne est constituée d’actifs financiers, comme des actions, des bons, etc. ou quand les fonds de pension sont privés (quelque chose qui dans beaucoup de pays n’est pas une option mais une nécessité). Quand cela se produit, l’épargne de l’individu se convertit (ou a été convertie) en capital, ce qui fait que ce dernier se convertit en une minuscule personnification du capital qui, s’il ne voit quasiment jamais les bénéfices (en réalité le peu qu’il touche compense simplement la dépréciation de son épargne avec le temps), court toujours le risque de tout perdre au cours d’une chute boursière. Sans doute, cela peut sembler à beaucoup une simple nuance mais quand ta retraite dépend d’un fond organisé par une banque, tu seras pour ou contre que l’État vienne à sa rescousse quand il est au bord de la faillite ?
Cela ne signifie pas que les uns ou les autres soient de la classe moyenne, ni qu’ils appartiennent à une classe distincte, mais qu’ils se trouvent traversés par des relations de classe contradictoires, relations qui sont les mêmes que nous avons vu auparavant sous leur « forme pure » entre salarié et capitaliste. Si nous essayons de faire entrer un petit cadre dans une classe ou que nous essayons de comprendre les manifestations de celles et ceux qui perdirent tout après la faillite de Lehman Brothers, nous nous trouverions devant les problèmes commentés auparavant, mais si nous regardons plus loin que les personnes, en direction de leurs relations sociales, ce qui semble apparemment une contradiction démontre qu’elle est réellement une contradiction.
Autonomes
Les dénommés « travailleurs autonomes » méritent une considération à part vu qu’ils constituent une étiquette juridique qui est une véritable boîte à tiroir de conditions et de relations sociales.[9] Il est évident que parler de « travailleurs » autonomes comme une réalité supposément homogène, c’est se laisser duper par des catégories légales qui dissimulent ce qui se produit en réalité. Nous n’entrerons pas dans les cas que nous avons déjà traités : petits entrepreneurs ou propriétaires de petits commerces (boutiques, ateliers, salons de coiffure, etc.). Notre intérêt se fixe sur les formes de travail salarié qui se cachent sous le nom de « travail autonome » et les différentes confusions qu’elles peuvent causer.
Le cas le plus évident sont les dénommés « faux autonomes », salariés que leurs chefs enregistrent comme autonomes pour convertir une relation de travail entrepreneur-salarié en une relation marchande entre entreprises, avec les avantages économiques que cela rapporte. Il n’y a pas grand chose à dire sur ce cas étant donné qu’il est considéré illégal, cependant il existe d’autres formes de « travail autonome » légales qui sont dans leur essence des formes de travail salarié et, par conséquent, des formes dissimulées de relations de classe.
La première et la plus évidente, c’est celle qui a récemment été régulée sous la dénomination de « travail autonome dépendant ». Ses caractéristiques principales sont que 75% des revenus doivent provenir d’un unique client, qu’il ne doit pas y avoir de salariés à charge et qu’il faut posséder une « infrastructure productive et matérielle propre » qui soit « économiquement importante », c’est à dire qu’il faut apporter une partie des moyens de production. En échange, on leur reconnaît partiellement certains « droits » réservés aux salariés comme des vacances, l’indemnisation en cas de rupture injustifiée du contrat, être sous la juridiction sociale et non la juridiction marchande, etc. C’est-à-dire que d’une certaine manière les propres lois reconnaissent qu’on se trouve dans une situation « intermédiaire » entre le travail salarié et le contrat entre entreprises ? Cependant, la réalité passe par dessus les lois étant donné que le travailleur autonome qui est dans une situation de « dépendance » n’a pas la capacité d’obtenir qu’on le reconnaisse comme tel, et l’entrepreneur duquel il dépend n’a aucun intérêt à ce qu’il en soit ainsi. Cette relation de classe dissimulée se manifeste dans le fait qu’entre l’apparition de cette figure juridique en juillet 2007 et juin 2008, seuls 1 069 travailleurs s’étaient inscrits à ce régime, tandis qu’une étude de l’Association des Travailleurs Autonomes de 2005 chiffrait à 400 000 le nombre de travailleurs autonomes dépendants en Espagne.[10]
Finalement, nous nous retrouvons face à ce que, pour la majorité, nous avons en tête quand nous parlons de travailleurs autonomes. Quelqu’un, propriétaire de quelques moyens de production, qui « prête service » à une entreprise plus grande ou à un client particulier, raison pour laquelle on pourrait apparemment considérer cela comme une « entreprise individuelle ». Comme nous l’avons répété au long de cet article, pour parler de classes, nous devons nous centrer sur les relations qu’établissent les personnes. Bien que ce soit le même travailleur, les relations de classe qu’il établit sont distinctes, dépendantes du fait qu’il vende directement son travail sur le marché ou s’il est en sous-traitance pour une autre entreprise, ce qui est la signification réelle de « prêter service ». Dans le premier cas c’est la même relation dont nous parlions dans la partie sur la petite bourgeoisie, une relation purement mercantile d’achat-vente, peu importe qu’on vende un produit ou un service. Dans le second, bien que puisse s’établir également la même relation, les cas les plus intéressants sont ceux dans lesquels sous un supposé contrat entre entreprises se mêle une relation salariée dissimulée dans laquelle le travailleur est le propriétaire, réel ou formel,[11] d’une partie des moyens de production. C’est-à-dire que c’est comme si le contracteur louait, d’un côté, une partie des moyens de production et, d’un autre côté, qu’il achetait de la force de travail, en échange d’un salaire au forfait, sous la forme d’une prestation de service. De cette façon sont économisés les coûts d’entretien d’une partie des moyens de production, qui sont à la charge de l’autonome et, de plus, cela fait qu’une partie de la supervision du travail est réalisée par cet autonome. Ce type de relation est très utile pour des travaux qui se réalisent de manière dispersée, où une partie des moyens de production n’est pas excessivement coûteuse et, par conséquent, est assumable par le travailleur sous forme de leasing, de prêt, etc. et où la productivité du travail dépend plus de la main d’oeuvre que de la machinerie. Le secteur du transport, celui de la construction et des nouveaux secteurs comme les designers, les traducteurs éditeurs, les programmateurs, les opérateurs de caméra freelance, etc., sont quelques uns de celles et ceux qui s’adaptent le mieux à ces « nouvelles » formes de travail salarié.[12]
La question fondamentale est que, en étant possesseur de ses propres moyens de production, « l’autonome » se voit immergé dans les deux types de relations. D’un côté, il peut agir comme producteur indépendant, par exemple si un opérateur caméra décide d’enregistrer un documentaire marginal qu’il essaie ensuite de vendre à Callejeros, ou si un historien décide de préparer une encyclopédie sur l’art austro-hongrois qu’il essaie ensuite de placer dans une maison d’édition. Mais tant l’un que l’autre peuvent être embauchés par l’agence de production du programme ou une maison d’éditions universitaire pour roder le programme ou préparer la collection. Bien que le travail soit le même, et qu’ils le fassent avec leurs propres moyens (caméras, micros, ordinateurs), le contrôle sur le processus de production et la propriété du produit final sont totalement distincts ? Ceci n’est pas limité à des travaux « créatifs » ou « immatériels », vu que la même chose peut être dite à propos d’électriciens embauchés pour faire des bricoles dans les maisons de quelques particuliers ou en sous-traitance par une entreprise de construction pour réaliser l’installation du chantier. Le mal dénommé « travail autonome postfordiste », appellation confuse sous laquelle se sont regroupées généralement des activités pompeusement dénommées « cognitives » qui ont coutume d’inclure des tâches de « design », de traduction, d’informatique (programmation, maquettage…), d’enquête, etc., ou « affectives », soins aux personnes âgées, aux enfants, aux handicapés, etc., peut présenter les mêmes relations de classe que des maçons, des plombiers ou des transporteurs. Les premiers peuvent avoir une série de problématiques concrètes relativement novatrices comme la « domination des savoirs », la « mercantilisation des capacités affectives », l’aliénation des capacités communicatives, la consommation excessive de cocaïne ou l’arrivisme fêtard, mais cela n’implique rien vu que le maçon, l’électricien ont également les leurs propres qui, si elles sont anciennes n’en sont pas moins importantes, comme travailler sous la pluie, à moins 10 degrés en hiver, mourir électrocuté, écrasé ou alcoolisé.
Quelques bases matérielles de la domination capitaliste
Dans cette partie nous n’allons pas traiter des mécanismes répressifs et de contrôle dont il nous plaît tant de parler en tant qu’anticapitalistes. Bien qu’il soit évident que le capitalisme ne pourrait survivre sans eux, il est également évident qu’il ne survit pas seulement grâce à eux. Ce que nous allons traiter ici, ce sont quelques bases matérielles de la dénommée « servitude volontaire », réellement indispensables pour le maintien de l’ordre et de la paix capitaliste. Souvent on considère que cette servitude est la conséquence de l’idéologie dominante qu’ils nous injectent à travers la télé, les médias, l’école, etc. Basiquement, « les gens ne se rebellent pas parce qu’ils sont trompés, abêtis, etc. ». Bien que cela soit en partie certain, toute idéologie est une représentation partielle, superficielle de la réalité, par conséquent comprendre la base réelle sur laquelle s’assoit l’idéologie est crucial pour la combattre.
Le capitalisme n’est pas seulement le centre de travail, c’est aussi le centre commercial. Ces deux sphères, production et circulation, façonne le tout organique que constitue le capital. La relation de classe a ses bases dans la production et, de fait, c’est dans le travail qu’elle se manifeste le plus clairement mais, comme nous le verrons dans la prochaine partie, elle imprègne toutes les relations sociales. Toutefois, dans la sphère de la circulation, les choses sont différentes. Dans le marché il n’y a apparemment pas de classes sociales. Formellement, nous sommes tous et toutes des acheteurs et des vendeurs libres. Citoyens atomisés, juridiquement égaux, avec les mêmes droits. Bien que dans le capitalisme l’égalité formelle des citoyens indépendants cache l’inégalité matérielle des classes, la séparation et l’égalité juridique constituent les bases matérielles de deux des grands piliers idéologiques du capitalisme : l’individualisme et l’« arrivisme ».
Il n’est pas du tout certain que les gens « ne se rendent pas compte » ou « sont trompés »… Beaucoup savent qu’ils sont des mulets qui se tueront à travailler toute leur vie, et que leur chef vit bien mieux qu’eux. Conclusion : beaucoup souhaitent se convertir en chefs. Est ce que cela fait qu’ils sont moins prolétaires ? Non. Celui ou celle qui veut monter sa propre entreprise ne le fait pas pour être moins aliéné ou moins exploité et cela ne fait pas non plus que le chef va moins te contrôler ou augmenter ton salaire. La question de classe reste là, ce qui change c’est la manière que l’on a de l’affronter. Les mêmes questions, des réponses distinctes. Le capitalisme n’a pas éliminé ni le prolétariat, ni la contradiction entre capital et travail. Ce qu’il a fait ces dernières années, c’est changer radicalement la manière de les affronter. D’une part, faire que nous cherchions fondamentalement des solutions individuelles et non collectives et que nous cherchions à sauver notre cul au lieu de donner un coup de main aux autres ou que nous vivions avec l’espoir que quoi qu’il arrive (un licenciement, une expulsion, un plan de réforme intégral…), cela ne va pas nous toucher nous : d’une certaine manière, le capitalisme nous condamne à l’individualisme. D’autre part, il a réussi à faire croire que l’unique option concevable pour cesser d’être prolétaire est celle d’être capitaliste. Comment a-t-il réussi à ce que nous avalions cette illusion ? Et bien parce que ce n’est pas une illusion, pas totalement du moins. À la différence de l’esclavagisme ou du féodalisme, dans le capitalisme il est réellement possible de cesser d’être un travailleur pour devenir un entrepreneur et, a priori, c’est réellement à la portée de chacun d’entre nous, par conséquent le capitalisme nous condamne à l’« arrivisme ».
L’autre face de cette idéologie est que si quiconque peut cesser d’être prolétaire, nous ne pouvons pas cesser de l’être tous à la fois. Que si quiconque peut se convertir en entrepreneur, il faut également être disposé à exploiter et piétiner les autres. Ou que la majorité des « entrepreneurs » terminent, au bout d’un certain temps, prolétaires encore plus endettés qu’avant ou qu’ils aient endetté les membres de leur famille et leurs amis qui les garantissaient, renforçant par là la domination capitaliste.
Un autre pilier dont on parle beaucoup est le consumérisme. Avec le développement du capitalisme, quelques secteurs du prolétariat des pays occidentaux (mais pas tous, pour ne pas parler des pays non occidentaux) ont pu accéder à toute une série de marchandises : iPods, télévisions, machines à laver, internet, voitures… qui si elles n’éliminent pas la misère vitale qu’on subit dans le capitalisme, au moins la rendent plus supportable. Personne ne théorise mieux cela que l’Internationale Situationniste. En réalité le cas du consumérisme est très semblable à ceux d’avant. On ne cesse pas d’être prolétaire parce qu’on a une télé, un walkman ou Youtube à la maison, mais c’est un facteur de plus qui influera sur notre manière de nous confronter au monde, et y compris aux contradictions de classe. Et cela peut influer des deux côtés : en amortissant le conflit de classe grâce à une vie plus confortable et plus de loisirs ou en mettant en lumière la misère et l’aliénation capitaliste qu’aucun type d’abondance marchande ne peut éliminer.
À notre avis la révolution n’essaie pas d’« illuminer » un prolétariat qui vit trompé. Il s’agit d’établir des liens de communication avec lesquels découvrir collectivement le revers de la médaille de toute idéologie capitaliste et, surtout, de mettre en pratique des alternatives collectives et solidaires d’affrontement au système qui soient assumables par quiconque. Cela n’a pas beaucoup de sens que nous nous limitions à critiquer les syndicats et à dire aux gens qu’ils sont vendus et bureaucratiques (on n’apprend rien à la majorité d’entre eux) si nous ne sommes pas capables de construire des alternatives de lutte à travers lesquelles les gens peuvent solutionner leurs problèmes à la marge des syndicats et y compris contre eux. Cela n’a pas de sens que nous nous limitions à démontrer les supercheries de la gauche progressiste et des ONG si nous ne sommes pas capables d’appuyer ces alternatives de lutte avec une pratique réelle collective, aussi minoritaire qu’elle puisse être au début.
L’importance des classes sociales
Reprenant sur le sujet des classes, beaucoup se demanderont quelle est l’importance réelle des relations de classe dans la société actuelle et, par conséquent, dans le « mouvement » anticapitaliste. En laissant de côté, celles et ceux qui nient directement l’existence des classes sociales, beaucoup, tout en reconnaissant l’existence des relations de classe, affirment qu’actuellement elles n’ont pas d’importance dans les conflits sociaux, par conséquent notre intervention dans ceux-ci devrait se baser sur d’autres critères (que ce soit contre la « domination », contre le « développementisme » ou « la technologie », quasiment toujours ainsi en termes généraux). Du côté opposé sont celles et ceux qui considèrent que la lutte des classes est pratiquement tout ce qui a réellement de l’importance et que tout autre type de conflit est quasiment de l’« humanisme petit-bourgeois » ou bien celles et ceux qui croient que tout est directement lutte de classe et voient, par exemple, dans les interventions militaires « impérialistes » la nécessité d’écraser un prolétariat local mythifié. Finalement, il est évident que la société capitaliste ne se divise pas exclusivement en classes : il existe des différences de genre, de race, d’orientation sexuelle, culturelles, d’âge, de couleur de peau, etc. Beaucoup de celles-ci donnent lieu à des relations spécifiques de domination, d’oppression ou de discrimination, et par conséquent à des luttes et des résistances : la lutte de genre, contre l’oppression raciale, les luttes LGBT, de libération nationale, etc. Beaucoup placent ces luttes, y compris celles de classe, les unes à côté des autres, et parfois y compris les unes au dessus des autres, donnant lieu aux dénommées « politiques de l’identité » ou aux « nouveaux mouvements sociaux ».
Pour éviter de tomber dans une de ces simplifications, il est nécessaire d’approfondir un peu plus l’essence des relations de classe. C’est seulement de cette manière que nous pourrons déterminer son importance réelle ainsi que sa relation avec le reste des luttes mentionnées.
Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, nous existons dans et à travers nos relations avec le reste des êtres humains et avec la nature. Ces relations sont le principal produit de notre activité théorico-pratique, de notre capacité à transformer et comprendre le monde qui nous entoure. Le principal produit de la praxis humaine, ce ne sont pas seulement ses résultats matériels (des choses) ou mentaux (des idées, des catégories, des concepts) mais les relations humaines et avec la nature qui façonnent notre existence. Cependant, ces relations n’existent de manière abstraite ou générique que dans notre esprit. Dans la réalité, elles se présentent toujours sous des formes historiques concrètes et transitoires qui dépendent des conditions matérielles de la praxis humaine.[13] Les relations de classe sont, de fait, les formes historiques qu’adoptent les relations humaines en fonction de la distribution réelle et formelle des moyens à travers lesquels nous, les êtres humains, nous reproduisons les conditions matérielles de la sociabilité. Concrètement, du fait de la distribution et du type de propriété des moyens de production et de subsistance dans la société capitaliste, les relations humaines se présentent sous la forme de relations sociales capitalistes, c’est-à-dire fétichistes (passant par la médiation de choses), impersonnelles, aliénées et, surtout, de classe.
Cette petite excursion « philosophique » était nécessaire pour montrer que les relations de classe ne sont pas des relations imposées de manière externe à la réalité sociale mais que la réalité se constitue, se reproduit à travers elles. Les voitures, les maisons, ce que nous mangeons, la ainsi dénommée « culture », les activités qualifiées de loisir se produisent dans leur immense majorité à travers des relations de classe capitaliste, c’est-à-dire à travers l’exploitation des uns pour le bénéfice d’autres sur la base de l’achat-vente de la marchandise force de travail. Les conflits qui surgissent contre la « marchandisation » de la santé, de l’éducation, de la sexualité, etc. captent cela, mais seulement superficiellement. La marchandisation de l’existant n’est pas la cause mais la conséquence du fait d’essayer de le soumettre à la logique du capital, et celle-ci peut seulement être la logique de l’exploitation et de la lutte des classes.
À partir de cela, il est facile de comprendre comment la lutte des classes entre en relation avec le reste des luttes (de genre, contre la domination raciale, etc.). Les relations sexuelles, les relations entre individus génétiquement différents,[14] entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, entre cultures et langages distincts sont le contenu des relations humaines. Toutes ces différences sont des différences biologiques et ethnographiques naturelles dont nous faisons abstraction lorsque nous parlons de relations humaines. Quand les relations humaines se présentent sous la forme des relations de classe, forme et contenu se traversent : les relations de classe pervertissent, subsument et canalisent le contenu des relations humaines et celles-ci ont tendance à se confondre avec la forme historique qu’elles adoptent. Par exemple, le capitalisme n’a pas inventé la domination de la femme vu qu’il apparut au sein d’une société qui était déjà patriarcale. Toutefois l’apparition du capitalisme supposa une transformation brutale des formes sous lesquelles se présente la domination de la femme : la grande chasse aux sorcières, sa réduction exclusive au rôle de mère reproductrice de force de travail, la destruction physique et psychologique de sa sexualité ont été des phénomènes reliés à la dénommée « accumulation originelle ».[15] De même les relations « raciales » ont changé au long de l’histoire en fonction des intérêts et de la lutte des classes.[16]
Ce qui est fondamental ici, c’est que le capitalisme n’est pas de manière inhérente blanc, hétérosexuel et masculin (ou raciste, homophobe et machiste) mais qu’il est ainsi parce qu’il a surgi dans une société qui l’était déjà. Les relations sociales capitalistes ont surgi sur ces préjugés mais elles les transforment durant leur développement : elles les changent et, parfois, en réponse à la lutte des dominés, elles essayent de les dépasser. On dit souvent que le capitalisme peut s’accommoder de ces revendications (égalité de genre, « raciale », entre différentes orientations sexuelles, etc.) en son sein, ce qui n’est qu’à moitié certain. D’un côté, le fait qu’il puisse le faire potentiellement ne signifie pas qu’il puisse le faire dans chaque situation concrète. Cependant, le plus important est que le capitalisme incorpore ces revendications à sa manière, à la manière capitaliste. La dénommée « égalité des sexes » a été obtenue dans de nombreux cas en permettant que la femme puisse assumer des comportements dégoûtants traditionnellement réservés aux hommes. L’égalité n’est pas, ne peut pas être, que désormais à la télé on voit des gars musclés en string aux côtés des traditionnelles nanas en bikini, ni qu’une femme puisse toucher le cul d’un homme dans une discothèque, ni que les femmes doivent travailler 8 heures en dehors de la maison et autant à l’intérieur. L’« assimilation » et la visibilisation de l’homosexualité s’est faite d’une manière totalement commerciale, basée sur la marchandisation et la vente de certains clichés et comportements stéréotypés, donnant lieu au dénommé « capitalisme rose », et ainsi successivement… Il n’y a pas de véritable libération ni de véritable égalité à l’intérieur du capitalisme, la division de classe fait que l’unique chose à laquelle on puisse aspirer est l’« égalité » et la « liberté » capitaliste, qui dans le fond cache l’inégalité de classe et la soumission au travail salarié. De même qu’une véritable politique de classe peut seulement être féministe, un véritable féminisme ne peut être que « de classe ».
Pour terminer, nous soulèverons un dernier point. Face aux différences antérieures (génétiques, entre « races », genre, âges, préférences sexuelles, etc.) qui sont des différences biologiques données, les relations de classe sont un produit aliéné de notre activité sociale comme êtres humains sous des conditions matérielles déterminées. Cela implique que nous pouvons détruire les relations de classe, nous pouvons les abolir à travers la transformation de nos relations sociales et la destruction des conditions matérielles dont elles sont la cause et la conséquence. Nous les créons, nous les détruisons. Au contraire, nous ne pouvons pas (ni ne voulons) en finir avec les différences entre hommes et femmes, entre couleurs de peau ou groupes sanguins, entre homosexuels, bisexuels ou hétérosexuels, etc. Il ne s’agit pas non plus de nous égaliser abstraitement « en droit » ou ce genre de choses, il s’agit d’apprendre à vivre en acceptant la riche diversité biologique, ethnographique et culturelle comme une vertu et non comme un châtiment, vivre grâce à elle et non malgré elle. Et nous ne pouvons ni ne voulons attendre de détruire le capitalisme pour ce faire.
Conclusion
Dans cet article nous avons essayé de commencer à exposer la structure de classe du capitalisme. Nous avons traité les relations de classe en terme « objectifs », comme des formes aliénées qu’adoptent les relations humaines du fait d’une distribution, réelle et formelle, déterminée des moyens de production.
Notre principal objectif était de tenter de comprendre les bases matérielles des conflits au sein du capitalisme, la lutte des classes et comment ceux-ci entrent en relation avec le reste des luttes et oppressions qui cohabitent en son sein : de genre, raciales, etc.
Pour des raisons d’espace et de santé mentale, nous nous sommes limités à l’expérience individuelle des relations de classe, laissant pour plus tard leur expression collective et nous n’avons pas non plus traité les aspects « subjectifs » qui découlent de ces relations. Comment à partir de ces relations nécessairement antagonistes et contradictoires peuvent surgir des mouvements et des projets qui transcendent les limites du capitalisme… ou qui restent en lui, ainsi que des idéologies qui essayent de sublimer le conflit de classe et la séparation sur laquelle se base le capitalisme. Tout ceci et beaucoup plus lors d’un prochain article ennuyeux de Ruptura.
[1] L’autre face de la pièce, c’est que le capitaliste est également libre d’embaucher ou de virer tel ou tel prolétaire comme s’il était un maître ou un seigneur, et il n’a aucune obligation envers ses travailleurs mais il n’a pas non plus de pouvoir direct sur eux, au delà de la journée de travail. Que l’exploitation soit menée sous la forme de l’achat-vente de la marchandise force de travail entre sujets juridiquement égaux est ce qui caractérise le capital.
[2] Aux débuts du capitalisme, lors de la dénommée accumulation originelle (qui aurait aussi bien pu s’appeler la dépossession originelle), il dépouilla une grande partie de la population paysanne de ses moyens de vie et il détruisit tous les liens communautaires. Dans beaucoup de cas ces dépossédés n’avaient aucune manière de gagner leur vie, dans d’autres nombreux cas ils refusaient de se soumettre à la discipline du travail salarié. Dans les deux cas, par choix ou par obligation, ils terminaient par mendier, beaucoup d’autres par voler et la majorité alternait entre ça et le travail, vagabondant de ci de là. En Angleterre et dans d’autres pays d’Europe, il fut nécessaire d’établir des lois sur les pauvres pour emprisonner les vagabonds dans des asiles ou les dénommées Work Houses. En Angleterre, par exemple, les lois contre les délits contre la propriété se durcirent (entre 1660 et 1820 le nombre de crimes châtiés par peine de mort augmenta de 190, la majorité d’entre eux étant des crimes contre la propriété ; en 1785, par exemple, la peine de mort fut appliquée quasi exclusivement pour des délits économiques) et de nouvelles formes de moralité se développèrent, spécifiquement destinées à combattre le vagabondage, l’abandon des membres de la famille, à exalter le travail manuel, etc. C’est-à-dire que pour que les prolétaires se consacrent au travail, un processus long, coûteux et extrêmement violent fut nécessaire, qui combina l’usage de la force, la modification des lois, l’évolution des formes idéologiques, etc.
[3] Le principal produit de la relation capital-travail, c’est le maintien de cette même relation, reproduisant la division de classe au niveau individuel et collectif.
[4] Évidemment la réalité est plus compliquée, vu que sur ces relations se superposent des relations et des sensations d’amitié, de haine, de complicité, de méfiance… c’est-à-dire des relations humaines. Les meilleurs textes pour approfondir la nature fétichiste des relations sociales dans le capitalisme sont le chapitre sur « Le fétichisme de la marchandise et son secret » du Livre Premier du Capital et la première partie des « Essais sur la théorie marxiste de la valeur » d’Isaak Ilich Rubin. (le plus souvent orthographié "Roubine" dans la transcription française du cyrillique, NdS)
[5] « (…) du fait de la concurrence, la complète domination du processus de production par les intérêts du capital – c’est-à-dire l’exploitation la plus impitoyable – se convertit en une condition indispensable pour la survie d’une entreprise.
Ceci se manifeste dans la nécessité, en raison des exigences du marché, d’intensifier autant que possible les rythmes de travail, d’allonger ou de raccourcir la journée de travail, d’avoir besoin de plus de main d’oeuvre ou de la mettre à la rue…, en un mot, de pratiquer toutes les méthodes déjà connues qui rendent compétitive une entreprise capitaliste. Et en occupant le rôle de l’entrepreneur, les travailleurs de la coopérative se voient dans la contradiction de devoir se régir avec toute la sévérité propre à une entreprise y compris contre eux-mêmes, contradiction qui finit par couler la coopérative de production qui, ou bien se convertit en une entreprise capitaliste normale ou bien, si les intérêts des ouvriers prédominent, se dissout ». (Réforme et révolution, Rosa Luxembourg.)
Nous ne citons pas ce texte comme argument d’autorité mais parce qu’il fut écrit en 1899 ! Comme on le voit, nous ne sommes pas très originaux dans notre critique, même s’il est clair qu’il n’est pas nécessaire de l’être.
[6] Par exemple, le Mouvement National des Usines Récupérées (Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas , Argentine) déclara, à propos du film The Take de Naomi Klein, « Nous regrettons qu’on veuille utiliser la récupération d’usines pour une action politique internationaliste au sein de la lutte des classes antiglobalisatrice, avec une claire teinte idéologique marxiste et tout est vue depuis cette perspective de matérialisme dialectique. Depuis ce Mouvement nous ne sommes en accord ni avec le titre, LA PRISE, ni avec la consigne OCCUPER, RÉSISTER ET PRODUIRE, ni avec le scénario du film ». On peut voir le texte complet ici : http://www.fabricasrecuperadas.org.ar/spip.php?article49
[7] Les personnels de direction nous intéressent bien peu, vu qu’ils nous affectent à peine dans notre pratique quotidienne. Si nous les mentionnons c’est pour clarifier toutes ces critiques qui les utilisent comme « travailleur, etc. ». Il faut cependant préciser que, dans la majorité des cas, leur « salaire » est une forme dissimulée de participation aux bénéfices. Pour ne pas parler du fait qu’une grande partie de leur rente leur est offerte sous forme de participations à l’entreprise, « stock options », etc. C’est-à-dire des participations au capital.
[8] Quand dans les usines on commença à introduire les méthodes « toyotistes », dans lesquelles on demandait la coopération des travailleurs en groupe pour rendre plus efficace la production, les délégués qui représentaient le groupe face aux chefs commencèrent à être laissés de côté et à être traités comme des chefs, malgré le fait d’avoir été élu démocratiquement par les travailleurs… John Holloway, La rosa rouja de Nissan. On peut trouver ce texte dans Keynesianismo : peligrosa ilusión. Ed. Herramienta.
[9] Selon les chiffres du Ministère de Travail, en décembre 2008, sur les approximativement 2 150 000 autonomes « proprement dit », 80% n’ont pas de salariés. Les 20% restants en ont entre 1 et 5, dont la moitié n’a qu’un unique salarié. 800 000 autres sont des « membres associés de sociétés » qui sont associés à différents types de petites et moyennes entreprises. 200 000 de plus sont des « collaborateurs membres de la famille » des travailleurs autonomes. Pour finir, environ 150 000 sont conseillers et administrateurs d’entreprises avec au moins un tiers du capital social de l’entreprise. La majorité de ces cas a été traité d’une manière ou d’une autre.
[10] Sources : http://noticiasemprendedores.blogspot.com/2008/07/qu-es-el-trabajador-autnomo.html, http://www.autonomos-ata.com/informes/INFORMEDELTRABAJADORAUTDEPENDIENTE.pdf
[11] Nous disons réel ou formel parce que beaucoup de supposés propriétaires des moyens de production ne le sont qu’en termes nominaux, étant donné qu’en réalité « leurs » moyens de production « appartiennent » à la banque qui leur a donné le prêt pour qu’ils les achètent et pour s’emparer d’une partie de leur travail à travers les intérêts.
[12] Nous mettons entre guillemets le mot « nouveau » parce que le système est, d’une manière suspecte, semblable à la dénommée industrie domestique, généralement textile, des débuts du capitalisme (15ème-16ème siècle), appelée également « putting out system » ou « verlagsystem », dans laquelle un commerçant donnait des matériaux à des artisans ou des paysans pour qu’ils les travaillent dans leur propre maison avant de les recueillir pour les vendre.
[13] Par « conditions matérielles de la pratique humaine », nous ne nous référons pas aux « conditions économiques » et encore moins aux « conditions technologiques », mais simplement aux moyens à travers lesquels nous transformons le monde et survivons en son sein.
[14] Dans le fond les dénommées « races » ne sont rien de plus qu’une des nombreuses manifestations de la diversité génétique humaine. Voir note 16.
[15] Caliban and the Witch : Women, The Body, and Primitive Accumulation (Caliban et la sorcière : Les femmes, le corps et l’accumulation primitive). Silvia Federici. Autonomedia.
[16] Nous mettons entre guillemets le mot « race » parce que nous considérons qu’en grande partie c’est une construction sociale basée sur le fait que notre perception de la réalité est fondamentalement visuelle. C’est-à-dire des différences biologiques dans la couleur de la peau ou dans les caractères morphologiques (lèvres, yeux, cheveux) qui sont des différences réelles produites par notre évolution, qui sont regroupées en catégories que nous appelons races, tandis que d’autres différences biologiques comme le groupe sanguin ou les différentes isoformes de l’enzyme Alcool déshydrogénase (par exemple), qui ne sont pas perceptibles à la première vue, ne donnent pas lieu à tant de controverses.
Il y a des exemples très intéressants de comment le capital interfère avec la catégorie « race ». Le génocide du Rwanda en 1994 fut dû à un affrontement entre l’« ethnie » hutu et tutsi, cependant ces « ethnies » partagent la même langue, religion et couleur de peau, se différenciant seulement dans leur stature moyenne et, de fait, eux/elles-mêmes se reconnaissent incapables de se différencier à première vue. Selon différents auteurs, bien qu’il soit possible qu’existent quelques différences, ce fut la colonisation belge et allemande qui alimenta et exacerba la séparation entre hutus et tutsis (pour certains ce fut même cette colonisation qui la créa) comme un moyen de contrôler la population autochtone, en donnant aux tutsis un rôle principal dans l’administration coloniale.
Le cas contraire est celui de l’immigration irlandaise aux États-Unis durant le 19ème siècle. En ces temps là, l’Irlande était une colonie britannique où les irlandais étaient aussi discriminés que les noirs aux États-Unis (avec la différence qu’ils et elles n’étaient pas esclaves). En arrivant aux États-Unis, ils/elles étaient traités de la pire manière, parfois même pire que les esclaves afro-américains (qui étaient plus chers), en arrivant à être considérées comme des « nègres blancs » ou les noirs comme des « irlandais fumés ». Face à quelques irlandais qui proclamaient l’union avec les esclaves noirs pour lutter pour l’abolitionnisme, la majorité des immigrants irlandais décidèrent de faire valoir leur « blancheur », laissant de côté leur catholicisme et leur ascendance irlandaise pour accéder aux privilèges raciaux des blancs, anglo-saxons et protestants. Ce processus supposa principalement d’affronter et d’assumer sa « supériorité » sur les « noirs » (esclaves ou libres), en se plaçant au côté des « blancs ». Un exemple de ce changement est que le Ku Klux Klan, le représentant du racisme antérieur à la Guerre Civile Américaine, haïssait initialement de manière égale les noirs et les catholiques. En plus d’être un bon exemple du caractère social des « races », c’est un cas évident de comment les exploités sont divisés, dans ce cas sur la base de préjugés raciaux. Plus d’info : « An interview with Noel Ignatiev – How the Irish Became White » (Un entretien avec Noel Ignatiev – Comment les irlandais devinrent blancs). (Note du CATS : ce texte est téléchargeable ici : http://racetraitor.org/zmagazineinterview.pdf)
D’autres exemples historiques de comment les relations entre « races » ont été utilisées par le capital à son bénéfice peuvent être trouvés dans Une histoire populaire des Etats-Unis d’Howard Zinn.
