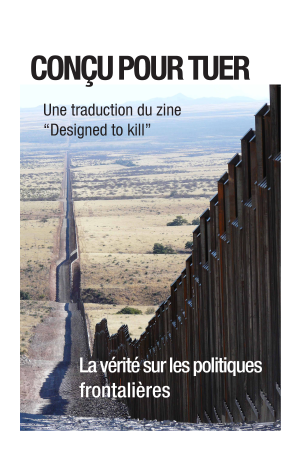ex-desert-aid-worker
CONÇUES POUR TUER
La vérité sur les politiques frontalières.
CONÇU POUR TUER
La vérité sur les politiques frontalières.
Texte anonyme publié avec ajouts et annexes par Crimethinc : https://crimethinc.com/books/no-wall-they-can-build
Texte original (Designed to kill : Border Policy & How to Change It, 2011) traduit de l’anglais, Tio'tia:ke/Montréal. 2019.
– À tous ceux-celles qui ont tenté la traversée, avec ou sans succès.
Je travaille depuis plusieurs années pour un groupe humanitaire offrant son support aux migrant-es qui entreprennent la traversée du désert afin de franchir la frontière Mexicano-État-Unienne ; périple au cours duquel des centaines d’entre eulles perdent la vie chaque année. Nous cartographions ce désert depuis longtemps ; parcourant les pistes, trouvant différents endroits où laisser de l’eau et de la nourriture, cherchant des gens en détresse et prodiguant des soins médicaux lorsque nous rencontrons quelqu’un qui en a besoin. Si la situation est critique, nous sommes en mesure de contacter une ambulance ou un hélicoptère qui conduira la personne à l’hôpital. Nous nous efforçons toujours d’agir en fonction des désirs du — de la migrant-e et n’appelons la patrouille frontalière que lorsque celui ou celle-ci le demande.
Durant mes années ici, j’ai aparticipé à de nombreuses situations démentielles et l’on m’en a rapporté beaucoup d’autres. Certaines choses auxquelles j’ai assisté m’ont réchauffé le cœur et d’autres m’ont glacé le sang. J’ai vu des gens qui étaient trop faibles pour se tenir debout, trop malades pour boire de l’eau, trop blessés pour continuer, trop terrifiés pour dormir, trop tristes pour parler, désespérément perdu-es, complètement affamés, mourant littéralement de soif et vivant avec la certitude qu’illes ne reverront jamais leur famille. Illes vomissent du sang sur leurs souliers troués, sans le sou, à plus de trois mille kilomètres de chez eux. Ils souffrent de coups de chaleurs, d’insuffisance rénale, d’horribles coupures, échardes, blessures, d’hypothermie, de choc post-traumatique et bien plus. Je me suis déjà retrouvé face à des gens qui avaient étés pillés et/ou violé-es ; dans les lieux où d’autres avaient étés assassinés. Mes ami-es ont trouvés des cadavres. J’ai été témoin de la souffrance des autres et ai moi-même perdu pied dans quelques crevasses, me suis déchiré le visage sur des barbelés, ai manqué d’eau, me suis fait pointé une arme à feu au visage, me suis fait poursuivre par des taureaux et encerclés par des vautours, évité des serpents à sonnette, retiré des aiguilles de cactus de toutes sortes de parties de mon corps. Ça m’a créé beaucoup de cheveux blancs et je crois avoir mis une quantité importante de moi-même ; de mon sang, ma sueur et mes larmes dans ce désert assoiffé.
Il n’y a pas un autre endroit au monde comme mon lieu de travail. Sa beauté dépasse l’entendement : c’est un lieu vaste et reculé, aride, montagneux, sévère et impitoyable ; plein de tous les clichés qu’on lui associe et bien d’autres encore. Je m’y suis retrouvé un nombre incalculable de fois ému par le courage et le don de soi incroyable des gens que j’y ai rencontrés, tout comme j’ai souvent explosé de rage face à l’hostilité d’un système économique et politique qui force ces personnes à accomplir l’impossible afin de nourrir leur famille. Mon travail m’a permis d’observer comment la frontière est gérée au quotidien et m’a fourni une plus grande compréhension de sa fonction au sein du système global qu’est le capitalisme, ainsi que des objectifs réels qu’elle vise à accomplir.
J’offre cet essai en guise de munition à tous ceulles qui se soucient encore assez du monde pour agir lorsque leurs semblables sont traités comme du bétail.
***
La première chose que je tiens à mettre au clair est la suivante : les souffrances atroces subies par les migrants chaque jour à la frontière n’arrivent pas par hasard. Ces situations ne sont pas accidentelles. Elles ne proviennent pas d’une méprise ou d’un malentendu. Elles sont le résultat direct, prévisible et intentionnel des politiques frontalières tant américaines que mexicaines. Ces politiques ont des objectifs rationnels, directement liés aux profits qu’elles injectent dans certains secteurs de la population des deux pays. Si celles-ci peuvent être considérées comme diaboliques, elles n’ont rien de stupides. De l’extérieur, je semble peut-être alarmiste ; mais permettez-moi de vous faire part des différentes manières dont j’ai vu les tactiques frontalières se déployer sur le terrain.
Lorsque j’ai commencé à travailler dans le désert, j’ai vite remarqué certains faits étranges à propos du fonctionnement des officiers de la frontière. D’abord, ceux-ci patrouillaient intensément certaines zones et en délaissaient d’autres complètement, sans rapport apparent avec le flux migratoire de ces zones. Les officiers, de toute évidence, cherchaient donc à concentrer les migrants dans les zones les plus achalandées au lieu de les rediriger vers d’autres points de rencontre moins denses, dans lesquels les officiers faisaient souvent profil bas jusqu’à l’extrémité nord du chemin. À ces endroits se trouvait un nombre modéré de surveillances, bien minime considérant l’amas de gens qui y passait.
Puis, ils ont commencé à bâtir des tours de surveillance. Encore une fois, ces tours n’ont pas étés bâties aux endroits où la densité de migrant-es était la plus élevée, mais bien aux extrémités des chemins qu’illes empruntent. Tout portait à croire que leur intention était bel et bien de pousser les migrant-es vers les zones les plus fréquentées plutôt que l’inverse. Que se passait-il donc ici ?
Je me posais ces questions alors que j’étais en contact constant avec des migrant-es dont les groupes avaient étés séparés par des hélicoptères. La patrouille frontalière a en effet l’habitude de survoler ces groupes de très près en faisant mine de se poser, ce qui engendre une panique dans le groupe qui le pousse à se disséminer. En quelques minutes, une trentaine de personnes peuvent ainsi se retrouver perdues dans le désert. Ce qui choque davantage dans cette situation étrange est l’absence subséquente d’effort de la part de la patrouille frontalière de réellement interpeller ces migrant-es après les avoir séparé.Elle s’envolait, simplement. Pourquoi ?
Ensuite, il y a ceci : au fil des ans, l’organisation pour laquelle je travaille a acquis une grande compréhension des zones que nous couvrons ; zones qui par moments ont faits partie des sections les plus achalandées de toute la frontière. Nous avons une idée très claire des lieux où se forment, se dirigent et se rendent les différents groupes de migrant-es ; ainsi que les endroits où le flux migratoire augmente ou diminue. Nous connaissons les principaux lieux de souricière des officiers et bien d’autres choses. Je suis convaincu que si je travaillais pour la patrouille frontalière, je pourrais mettre un doigt sur la carte du désert et essentiellement désamorcer la totalité du secteur. Ce n’est vraiment pas très compliqué. Il faut garder à l’esprit que notre travail ici est fait par des bénévoles sans formations préalables, n’ayant pour seule arme que quelques modèles viellis de GPS, quelques camions, des programmes de cartographie assez sommaires, des téléphones cellulaires de mauvaise qualité et un budget très limité. Il ne semble donc pas très logique que nous soyons capables de comprendre les principaux enjeux sociaux présents à la frontière alors que le gouvernement des États-Unis, avec ses hélicoptères, drones, capteurs électroniques, avec son armée de camions bien entretenus, ses systèmes de visions nocturnes et son expertise générale en tout ce qui a trait à la surveillance, la communication et la cartographie ; sans parler de ses milliers de salariés et de ses ressources financières illimitées, ne soit pas capable d’en faire autant. Je n’y crois pas. Alors que se passe-t-il vraiment ici ?
Si l’on prend pour argent comptant les objectifs que disent se donner les responsables de la frontière, rien de tout ceci ne tient la route. Par contre, si l’on accepte que les objectifs déclarés diffèrent des objectifs réels, la situation actuelle, d’un coup, semble aller de soi. Croyez-moi, les réels objectifs des politiques en place et la mission de ceux qui les appliquent ne sont pas de stopper l’immigration illégale, mais bien de la contrôler. Mais dans quel but ? Au profit de qui ? Je suggère de trouver un endroit confortable pour poursuivre la lecture de ce texte : c’est ici que ça se complique.
Il est très clair que l’économie des États-Unis repose en grande partie sur l’hyperexploitation des travailleur-es sans-papiers. Vous le savez, je le sais, les travailleur-es guatémaltèques qui pellettent de la merde de chevaux hors des écuries de Lou Dobbs le savent. Ce fait irrévocable semble être un sujet de conversation extrêmement tabou dans la sphère publique. Pourtant, un minimum de bon sens permet de comprendre que si le gouvernement des États-Unis érigeait vraiment un mur de deux mille kilomètres le long de sa frontière demain matin et arrivait ensuite à déporter la totalité des immigrant-es illégaux qui vivent sur son territoire, il causerait une perturbation sans précédent et immédiate de son agriculture et de ses industries d’exploitation animales. Le domaine de la construction serait aussi fortement ébranlé par cette décision. Ce bouleversement risquerait de mener à une situation de panne sociale dans le domaine agroalimentaire, voire à une famine nationale. Je n’exagère pas. Ceux qui ont écrit les politiques frontalières ne sont pas des imbéciles et comprennent parfaitement ce que je viens d’avancer, malgré que vos collègues de bureaux racistes n’en saisissent rien. Nonobstant ce qu’affirment les politiciens et les soi-disant « experts », je ne crois pas que quiconque cherchera à mettre un frein à l’immigration, du moins aussi longtemps que le travail des sans-papiers sera nécessaire à la stabilité du système économique en place. Ce n’est pas pour autant une bonne nouvelle pour ceux d’entre nous à qui répugnent à voir nos semblables être traités comme des moins que rien puis jetés aux ordures comme autant de couches souillées. Ce dont il faut se souvenir est que ces migrations vont continuer d’être gérées et contrôlées par l’État.
La frontière n’est qu’une blague sadique à conclusion morbide. Son but est en fait de rendre l’entrée des sans-papiers au pays dangereuse, traumatisante, couteuse, mais possible. L’objectif n’est pas de décourager les gens à tenter leur chance, loin de là. Il s’agit plutôt de s’assurer qu’une fois qu’illes sont entrés aux États-Unis, la menace de la déportation représente quelque chose d’extrêmement sérieux : une quantité inimaginable de dépenses, une seconde traversée du désert au péril de sa vie et la possibilité de ne jamais revoir sa famille. Cette stratégie offre aux employeurs états-uniens un accès constant à un bassin de travailleurs volontairement fragilisés et donc faciles à exploiter ce qui, par effet d’enchaînement, provoque une baisse des salaires pour les travailleur-es ayant la citoyenneté états-unienne. Ce phénomène explique pourquoi le vieil adage stipulant que « les maudits immigrants viennent dans notre pays nous voler nos jobs » est si convaincant. Comme tout mensonge bien construit, sa puissance réside dans l’omission de variables importantes.
Ceux et celles qui croient que l’immigration et les politiques frontalières protègent leurs intérêts financiers personnels, leurs postes ou leurs salaires ont très mal interprété la situation. Même en limitant son point de vue à la sphère purement économique des comportements humains, il est clair que si les sans-papiers n’étaient pas sujets à des risques et des pressions extraordinaires illes agiraient comme tout un chacun et chercheraient à obtenir le meilleur salaire possible pour leur travail. D’ailleurs, ces mêmes travailleur-es ont déjà prouvés maintes fois qu’illes étaient en mesure de se battre et d’obtenir gain de cause malgré qu’illes aient à surmonter plusieurs obstacles auxquels un-e travailleur-e ordinaire n’est pas confronté-e. Les frontières et le renforcement des lois migratoires forcent le recul de tous les salaires : c’est sa mission première.
Les réels objectifs des politiques frontalières en place et la mission de ceux qui les appliquent ne sont pas de stopper l’immigration illégale, mais bien de la contrôler.
Voici un autre indice de ce que j’avance : la récente crise migratoire et la panique générale qui l’accompagne rappellent étrangement l’hystérie collective anti-musulmane qui a secoué le monde occidental il y a dix, cinq ans (qui sévit encore aujourd’hui à vrai dire) et qui s’intensifie bizarrement toujours en période de mi-mandat. La guerre en Irak s’étant essoufflé dû à l’absence d’attaque d’Al-Qaeda en sol états-unien, ce soi-disant débat sur l’immigration est devenu de facto un enjeu de sécurité nationale, ou plutôt un sujet de conversation de politicien.
La stratégie républicaine est assez claire : ils espèrent utiliser la peur, l’angoisse et le racisme de la population blanche afin de prendre le pouvoir. La stratégie démocrate est plus nuancée : ils ont commencé par blâmer les républicains pour l’absence de progrès dans le dossier de l’immigration. Ils espèrent ainsi obtenir le vote des communautés immigrantes d’une part, sans pour autant proposer des mesures pro-immigration à proprement parler afin, d’autre part, de conserver le vote des électeurs qui se positionnent contre l’immigration. Finalement, ils accélèrent les déportations. Le gouvernement de Barack Obama a déporté environ 400 000 personnes en 2010. À ce jour (soit en 2011), c’est le plus grand nombre de déportations effectuées en une seule année. Ses chiffres pourront leur servir à faire valoir leur « ténacité » en matière d’immigration. Armés de ces lois et procurations, les démocrates espèrent séduire l’électorat républicain avant la prochaine élection et lors de celles à venir. Il faut s’attendre à voir ce genre de mascarade se déployer encore en 2012, à moins que ce débat ne se fasse éclipser par une guerre ou une attaque terroriste.
Un dernier indice. Une grande part des projets de loi qui en sont venus à devenir des politiques gouvernementales ont étés écrits par des sociétés commerciales qui espèrent profiter de ces politiques. Le projet de loi 1070 de l’Arizona stipule, entre autres choses, que la police devrait mettre en état d’arrestation tout individu incapable de prouver qu’il s’est légalement introduit dans le pays. Ce projet de loi a été rédigé en décembre 2009 au Grand Hyatt hotel, à Washington, par des représentants du service correctionnel Corrections Corporation of America (CCA). Il s’agit de la plus grosse prison privée du pays ; générant plusieurs milliards de dollars par année. Le projet de loi 1070 a été rédigé durant l’American Legislative Exchange Council (ALEC) ; une organisation d’affiliés composés de législateurs et de puissantes corporations. Cette loi, qui a été partiellement abrogée, mais risque toujours d’être mise en application, a le pouvoir d’envoyer des centaines de milliers de migrant-es en prison, ce qui représente des centaines de millions de dollars de profit pour les compagnies comme CCA qui auraient le mandat de les « héberger ».
Il est évident que la cessation complète de l’immigration illégale n’est pas dans l’intérêt de ce type d’industrie. Il leur faut ces gens pour remplir leurs prisons.
Mais qui peut bien profiter de toutes ces morts dans le désert ?
De façon générale, c’est toute la classe dominante ; mais il ne faut pas s’arrêter là. Il faut, pour bien comprendre ceci, remonter le temps.
D’abord, permettez-moi d’imposer ici un cours d’Histoire condensé à l’extrême et de plonger directement au sein d’une vérité inconfortable : comme le reste de l’hémisphère ouest, le territoire que nous appelons maintenant Les États-Unis d’Amérique a été volé à ses habitants initiaux par des colons européens lors d’un massacre rempli de tricheries hautement documentées ; un génocide aux proportions incomparables, sans précédent et sans pareil dans les années relativement tranquilles qui l’ont suivi. C’est un crime monstrueux, en ascension perpétuelle depuis plus de 500 ans, qui n’a jamais demandé pardon de façon significative à ses victimes et qui continu sa mouvance aujourd’hui.
Tout le monde le sait, mais personne n’aime beaucoup penser à ce que ça implique. Eh bien voilà : à moins d’être assez honnête pour admettre qu’on adhère à l’idée que « force prime le droit » tant qu’on se trouve du « bon » côté, force est plutôt d’admettre que le gouvernement fédéral, étatique et local des États-Unis d’Amérique, ainsi que toutes les instances telles que la patrouille frontalière, les services d’immigration et de douanes sont des instituions illégitimes qui ne devraient pas avoir d’autorité sur le territoire qu’elles occupent.
Je crois qu’il est important de cerner le problème à partir de cette prémisse. Qui sont ces gens qui imposent leur juridiction en terre autochtone ? De quel droit peuvent-ils dire aux gens où aller et quand s’y rendre ? S’il y a quelqu’un qui peut se permettre de dicter qui peut ou ne peut pas passer sur le territoire où repose actuellement la frontière Mexicano-État-Unienne, ce sont ceux dont les ancêtres habitent cet espace depuis des temps immémoriaux ; certainement pas les descendants de ceux qui les ont colonisés, encore moins leurs institutions. La plupart de ceux qu’on targue d’être des immigrants illégaux ont en fait des arguments beaucoup plus solides pour légitimer leur présence en terre d’Amérique que la bande d’hypocrites qui s’évertuent à les condamner et les poursuivre.
Je me permets ici de faire un bond dans le temps, au nom de la concision, jusqu’au 1er janvier 1994 : premier jour de la mise en vigueur de L’Accord de Libre Échange nord-américain (ALENA) (ou NAFTA en anglais : North American Free Trade Agreement). Cette loi provoqua l’insurrection des peuples autochtones du Mexique et entraîna la création du légendaire groupe des zapatistes, nommé ainsi en l’honneur du célèbre révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata. Les insurgé-es avaient prédit que cet accord donnerait le coup de grâce à leurs méthodes ancestrales s’illes ne réagissaient pas. Leur analyse de la situation n’a pas tardé à s’avérer pertinente. Leur projet de résistance tient le coup à ce jour, ayant même servi de moteur à toute une génération d’opposant-es au système capitaliste. Il s’agit d’une tout autre histoire qui, heureusement, perdure.
Qui sont ces gens qui imposent leur juridiction en terre autochtone ? De quel droit peuvent-ils dire aux gens où aller et quand s’y rendre ?
En plus des effets désastreux qu’a eu l’ALENA sur les communautés industrielles État-Unienne, ses contrecoups pour les communautés agricoles mexicaines ont été catastrophiques. En prévision de cet accord de libre-échange, le gouvernement mexicain a fait amender l’article de loi 27 de sa constitution pour permettre la privatisation des Campesinos communautaires et des terres autochtones. L’ALENA a ensuite permis aux géants de l’industrie agricole états-unienne (fortement subventionnés) tels que Cargill et Archer Daniels Midland d’envahir le marché mexicain de maïs et autres produits bon marché issu de l’importation, ce qui tua instantanément toute l’industrie locale. Exactement comme l’avaient prédit les zapatistes, cette situation a eu pour conséquence de forcer des millions de Mexicain-es issus du milieu rural (dont la majorité joignait déjà difficilement les deux bouts) hors de leur terre et au fond du gouffre. La précarité causée par l’ALENA a ensuite déclenché une vague massive d’immigration. Des millions de Mexicaines ont du quitter leur foyer pour chercher du travail dans les villes avoisinantes, particulièrement dans des sweatshops, dont les propriétaires sont la plupart du temps des corporations états-uniennes situées au nord du Mexique et aux États-Unis. La même année, le gouvernement Clinton a lancé son « Opération grande-barrière » ; un programme qui a permis d’augmenter significativement le budget des patrouilles frontalières du secteur de San Diego en Californie, augmentant la surveillance dans ce secteur et leur permettant d’ériger un mur de plus de 22km de long entre San Diego et Tijuana. L’Opération grande Barrière marque plus ou moins le début d’un processus qui sévit depuis maintenant deux décennies et au cours duquel la frontière s’hypermilitarise toujours davantage, tant lors du mandat de Clinton, de Bush ou d’Obama. Ceci se traduit par un nombre toujours grandissant de patrouilleurs, de gardes nationaux, d’hélicoptères, de clôtures, de tours, postes de contrôle, de capteurs, d’armes à feu et de chiens de garde le long de la frontière. Comprendre ce phénomène de militarisation permet de mieux comprendre ce qui se passe vraiment à la frontière et pourquoi.
Fut un temps où il était beaucoup plus facile qu’aujourd’hui de traverser la frontière. La plupart des gens effectuaient un passage relativement sécuritaire d’un pays à l’autre par la plupart des grandes zones urbaines telles que San Diego, El Paso et la partie texane de la vallée du Rio Grande. Depuis l’Opération grande Barrière, la patrouille frontalière rend incessamment plus difficile d’entrer aux États-Unis par ces points d’arrivages et pousse méthodiquement le flux de migrant-es vers les parties les plus reculées des montagnes et du désert. La mort de milliers de migrant-es peut être directement liée à cette mesure, qui les a forcé à s’exposer à des chaleurs et des froids extrêmes, à la faim, la soif, aux blessures et aux maladies. Il semble que nous soyons arrivés à un point de rupture. Le gouvernement les a poussés jusque dans les zones les plus dangereuses et les plus reculées de la frontière et c’est exactement ce qu’il cherchait à accomplir. Si l’on ne peut pas affirmer que la situation soit devenue immuable (la patrouille frontalière resserre parfois l’étau dans certaines portions de la frontière et en laisse respirer d’autres), on peut affirmer qu’elle se soit plus ou moins stabilisée à l’échelle de toute la frontière.
Ce changement a provoqué plusieurs conséquences dans le comportement migratoire de ceulles qui décident d’entreprendre la traversée du désert. Beaucoup d’entre eulles avaient l’habitude de venir travailler aux États-Unis le temps d’une saison et de retourner chez eulles ensuite jusqu’à l’année suivante. Cette méthode a énormément perdu en popularité depuis qu’il est aussi difficile d’entrer dans le pays. Les gens préfèrent maintenant venir et rester aussi longtemps qu’illes le peuvent. De plus, la majorité des migrants qui traversaient la frontière étaient, par le passé, des hommes dont les familles vivaient du côté sud de celle-ci. Il y a maintenant beaucoup plus de femmes et d’enfants qui entreprennent le voyage, accompagnant un mari qui va chercher du travail et qui n’aura probablement plus jamais la possibilité de retourner au Mexique une fois qu’il aura traversé la frontière. Avec l’augmentation constante des déportations, beaucoup de ceulles qui traversent du sud au nord cherchent à retrouver, après une longue période d’absence, leur famille vivant aux États-Unis. Ce groupe en particulier doit faire face à un dilemme particulièrement déchirant s’il se heurte à un danger lors de sa traversée. J’ai souvent entendu des gens dont les enfants vivaient du côté sud de la frontière dire des choses telles que : « J’ai cru que j’allais mourir et je ne pouvais pas arrêter de penser à mes enfants. Je préfère retourner à la maison que de risquer ma vie à nouveau. » J’ai aussi entendu plusieurs personnes dont les enfants habitaient du côté nord de la frontière dire des choses comme : « Si je dois risquer ma vie pour rejoindre mes enfants je le ferai. »
J’espère avoir été assez clair : ces politiques visant à pousser le flux migratoire vers les zones les plus dangereuses du territoire ne traduisent en rien une intention réelle de la part du gouvernement de stopper ou même réduire le nombre de migrant-es qui atteignent illégalement les États-Unis. Cette stratégie complexe et vicieuse a plusieurs avantages. Elle permet d’une part aux politiciens d’avoir l’air inflexibles pour les caméras tout en fournissant à l’économie états-unienne les employés bon marché dont elle dépend ; d’autre part, cette stratégie de renforcement des frontières permet aux gouvernements d’offrir des contrats aux grosses corporations. Il payera par exemple Wackenhut pour transporter les migrants, Corrections Corporation of America pour les emprisonner et Boeing pour bâtir des infrastructures de surveillance. Ces mesures justifient aussi le salaire d’environ 20 000 patrouilleurs frontaliers et contiennent bien d’autres avantages pour les États-Unis sur lesquels je reviendrai.
Dans son ensemble, la militarisation de la frontière peut être perçue au mieux comme un projet du gouvernement visant à soutenir les sociétés commerciales ; projet surpassé en ampleur seulement par la guerre en Irak au cours des vingt dernières années.
Le résultat de cette politique en a long à nous apprendre. Tout comme il était jadis beaucoup plus facile qu’aujourd’hui de traverser la frontière, c’est aussi beaucoup plus dispendieux ; ce qui n’est pas une surprise pour quiconque est familier avec le concept de l’offre et de la demande. Tout service vaut son pesant d’or quand il est difficile à obtenir. Ainsi, les trafiquants en sont venus à exiger des montants astronomiques pour faire passer les migrant-es illégaux de l’autre côté de la frontière ; ce qui n’échappe pas aux autorités. Les tarifs de ces trafiquants augmentent sans cesse depuis que la patrouille frontalière recule les points d’accès hors des villes et sectionnent le trajet des migrant-es, le rendant ainsi plus long ; si bien qu’il est aujourd’hui plus lucratif pour les contrebandiers de faire passer des migrant-es plutôt que de la drogue de l’autre côté du mur. Les cartels qui contrôlaient le trafic de stupéfiants dans le secteur ont rapidement saisi la bonne affaire, éliminant toute concurrence et prenant le contrôle absolu des migrations. Ceci a radicalement transformé ce qui était un commerce de l’ombre en une organisation hautement centralisée permettant d’injecter des milliards de dollars de profit dans le marché noir. Il n’y a aucun doute que depuis la guerre froide, peu de groupes ont étés aussi avantagés par le renforcement des politiques en matière d’immigration, de commerce et de drogue que les cartels mexicains et états-uniens.
La dominance absolue des cartels dans leur nouvelle sphère d’activité les a menés, sans grande surprise, à appliquer une méthodologie extraordinairement inhumaine, fondée sur l’idée de masse. On fait souvent référence à ce système comme au « réseau pollero », ce qui signifie plus ou moins « les bergers de la viande », pollo désignant en espagnol une poule déjà morte, un poulet. Cette appellation démontre en soi le degré d’indifférence qu’accordent ces organisations aux vies humaines qu’elles guident vers les États-Unis. J’ai vu des groupes de plus de cinquante personnes se faire diriger comme du bétail à travers le désert, traînant à leur queue des malades et des blessé-es s’efforçant désespérément de maintenir la cadence. J’en ai entendu d’autres se faire assurer que ce voyage, impossible à accomplir en moins de 4 ou 5 jours, se ferait en aussi peu de temps qu’une douzaine d’heures, à pied. Je suis aussi venu en aide à des gens qui avaient été abandonnés sans hésitation à une mort certaine par leur guide parce qu’illes n’avaient plus la force de continuer à avancer. On estime qu’il coûte environ 5000 $ US à un-e Guatémaltèque et 6000 $ à un-e Salvadorien-ne pour entreprendre le voyage à travers le réseau pollero, de son point de départ jusqu’aux États-Unis. Les tarifs en ce qui a trait aux Mexicain-es varient beaucoup, mais demeurent très élevés. Évidemment, la majorité des gens qui désirent immigrer ne possèdent pas une telle somme à portée de main. C’est pourquoi les cartels ont développé bon nombre de solutions très imaginatives pour obtenir ce qu’ils veulent, comme les kidnappings et « l’esclavagisme contractuel ». J’ai connu des gens qui avaient travaillé pendant des années aux États-Unis simplement pour rembourser aux contrebandiers le prix de leur entrée au pays ; certain-es d’entre eulles dans des conditions horribles de travaux forcés. J’en ai connu d’autres qui sont entrés aux États-Unis simplement pour être ensuite kidnappé-es par ceux-là mêmes qui les avaient conduit du point A au point B. Les migrant-es capables d’amasser quelques milliers de dollars sont les seul-es à s’en tirer à plus ou moins bon compte. Les autres risquent de se faire battre pendant des jours avant d’être abandonné-es dans le désert, puis repris par des agents frontaliers en l’espace de quelques minutes, ce qui laisse croire à une entente préalable entre les gardes et les trafiquants. Je suis scandalisé-e par tout ce dont j’ai été témoin ici.
Les horreurs que j’ai décrites précédemment ne suffisent pas pour comprendre la profondeur de la cruauté qui caractérise cette ère dans laquelle les gouvernements financent les cartels. Les agressions sexuelles et les viols perpétrés sur des migrantes y sont absolument endémiques. Le gouvernement a d’ailleurs grandement exacerbé ce problème à force de pousser le flux migratoire dans des zones de plus en plus reculées. Il impose ainsi à toute femme immigrante de devoir affronter bon nombre de situations où les risques de se faire agresser sexuellement sont extrêmement élevés. Comme si ce n’était pas suffisant, les chemins qu’empruntent les groupes de migrant-es sont régulièrement visités par des brigands qui leur dérobent le peu qu’illes possèdent. Je crois pour ma part que certains de ces bandits travaillent pour les cartels et pillent simplement leurs propres clients alors que d’autres sont des « travailleurs autonomes » profitant de la vulnérabilité de ces proies faciles qui, souvent, trainent dans leurs poches les économies de toute une vie. Encore ici, c’est principalement parce que le gouvernement ne cesse de refouler les groupes de migrant-es jusqu’aux confins du désert que ces salauds ont le champ libre pour leur petit commerce humain.
Par souci d’honnêteté, on m’a rapporté des histoires où certains membres subalternes des cartels avaient agi de manière décente, emphatique, et même, occasionnellement, héroïque.
Il faut dire que les guias, les guides qui dirigent les migrant-es d’un bout à l’autre du désert, sont au bas de l’échelle des réseaux de crime organisé. Leurs vies sont considérées comme tout aussi accessoires que celle des migrants. Travailler dans le désert m’a fait voir à quel point être un guia doit être stressant. Ils sont responsables de déplacer d’énormes groupes à travers un territoire impitoyable qui ne possède aucun accès à de l’eau courante, souvent en pleine nuit ou sous une chaleur torride, tout en étant traqués par des militaires armées en hélicoptère. Tout ça en plus d’avoir un employeur pour le moins mal commode. C’est à peine surprenant que les guias soient prêts à sacrifier la vie d’un individu qui ne peut pas suivre la cadence plutôt que de risquer de perdre le groupe en entier. Une telle situation garantit en elle-même de faire ressortir le pire en tout un chacun. Je ne cherche pas, en disant ceci, à absoudre ces gens de leur responsabilité personnelle à avoir perpétré des actes indéfendables. Seulement je reconnais leur relative impuissance et comprends que les véritables coupables sont des gens en position d’autorité qui ont créé un véritable cauchemar afin de profiter consciemment et directement du malheur des autres.
C’est en gardant ceci à l’esprit qu’il est intéressant d’observer les liens unissant les gouvernements et les cartels. En bref, ils ont besoin l’un de l’autre. Ils partagent des intérêts communs. Aux États-Unis, les cartels ont besoin du gouvernement et le gouvernement sait se servir des cartels. Ces derniers ont besoin que le gouvernement garde les prix des biens et services qu’ils offrent artificiellement élevés, alors que le gouvernement utilise les cartels pour justifier l’injection de plusieurs milliards de dollars dans les différentes corporations qu’il finance.
Du côté du Mexique, il n’est même pas réaliste de considérer que le gouvernement et les cartels soient des entités distinctes l’une de l’autre. Là-bas, le gouvernement et les différentes organisations criminelles se battent constamment pour contrôler le marché des drogues et des migrations, qui génère des profits de plusieurs milliards de dollars par an. Ce bain de sang aux multiples visages s’est intensifié en 2006 quand le gouvernement fédéral mexicain a voulu mettre un terme à une entente de longue date qui stipulait que le gouvernement ne se mêlerait pas des querelles entre les différents groupes armés. Ceci signa malheureusement l’arrêt de mort de dizaines de milliers de personnes.
’il est intéressant d’observer les liens unissant les gouvernements et les cartels. En bref, ils ont besoin l’un de l’autre. Ils partagent des intérêts communs.
Les analystes utilisent souvent le terme « colombisation » pour parler des affaires publiques mexicaines, formant ainsi un rapprochement dans leur fonctionnement interne. L’une des similitudes les plus frappantes est sans doute la constante croissance des réseaux de connivences entre certaines parties du gouvernement et les cartels avec lesquels celui-ci se dit en guerre. Ces alliances remontent très loin et s’entre-influencent grandement.
Los Zetas est sans équivoque le cartel le plus violent du Mexique. Il a été fondé par des membres du Airmobile Special Force Group (GAFE), une unité d’élite de l’armée mexicaine formée en 1994 pour combattre les rebelles zapatistes dans les Chiapas. Lors de cette période, environ 500 membres du GAFE ont reçu un entraînement fourni par la septième unité des forces spéciales de l’armée états-unienne, à Fort Bragg, en Caroline du Nord ; dans l’unique but de stopper les zapatistes. Entre 30 et 200 de ces nouveaux soldats ont ensuite désertés l’armée mexicaine et sont devenus des hommes de main et des gardes du corps pour le Gulf cartel (une organisation criminelle bien établie) puis, plus tard, ont formé leur propre bande.
À l’échelle locale, les pots-de-vin remis par les cartels aux policiers, aux juges, aux maires et autres représentants de l’état sont chose commune. À l’échelle nationale, beaucoup d’éléments suggèrent que l’armée mexicaine et le gouvernement fédéral soutiennent le cartel de Sinaloa, le plus grand et le plus prospère du pays. Ils espèrent ainsi que Sinaloa se débarrasse lui-même des plus petits cartels en vue de bénéficier des faveurs du gouvernement, comme c’est le cas pour leur homologue colombien.
Il y a peu d’étanchéité entre l’État et les cartels au Mexique ; les forces de l’ordre étant infiltrées par de nombreux membres d’organisations criminelles. Ce phénomène, quoique moins répandu, est aussi très commun aux États-Unis. Un large pourcentage des drogues qui y entrent s’y infiltrent par des ports d’entrées où des agents frontaliers corrompus laissent passer les chargements. L’alliance entre le gouvernement et les trafiquants n’est cependant pas assumée au point de ne pas se munir d’employés à deux fonctions, qui vont et viennent entre, par exemple, la Corrections Corporation of America, la patrouille frontalière, le Gulf Cartel et l’armée mexicaine. Ce qu’il faut retenir ici est que toutes ces organisations ont des intérêts communs, bénéficient du secteur d’activité des autres et entretiennent mutuellement leur survie économique.
La trinité malsaine que forme le gouvernement avec les corporations et le crime organisé (trois systèmes qui traduisent un même message) forme un adversaire formidable à quiconque espère stopper les mortalités dans le désert de sitôt.
« Vous nous entendrez rugir ! » — slogan entendu à une manifestation contre le projet de loi 1070
L’élite corporative, gouvernementale et criminelle qui bénéficie de la souffrance des migrant-es à la frontière est puissante et sans pitié, mais elle ne fait pas de ses membres des dieux. Ils ne sont pas non plus les seuls actants de ce drame et ne sont pas totalement maîtres de la situation. Les gens qui accomplissent la traversée du désert n’y arrivent pas seulement parce la patrouille frontalière le leur permet, mais bien parce qu’ils sont vaillants et débrouillards. Les chemins qu’illes empruntent, savamment camouflés et serpentant les canyons et les montagnes avec une précision géographique déroutante ; témoignent de l’ingéniosité humaine à l’œuvre.
Il y a près de douze millions de sans-papiers aux États-Unis. Il n’y en a pas deux avec la même histoire. Illes ne sont pas tous anges ou démons ou victimes. Ils ne sont pas les objets passifs d’un monde qui agit sans provoquer chez eulles de réaction. Chacun d’entre eulles est un être à part entière ayant pris la décision de prendre son destin en main et je m’efforce, du mieux que je le peux, de les soutenir. Parfois j’y arrive. Parfois on peut battre le système et parfois c’est impossible.
La traversée de la frontière ne se termine pas à la frontière puisque les difficultés que rencontrent les migrant-es sont loin d’y prendre fin. La frontière passe par toutes les villes de tous les états du Sud. Cette ligne dans le sable n’est ni le premier ou le dernier obstacle que la machine capitaliste a mis en place pour les sans-papiers. Après avoir réussi à traverser, les immigrant-es illégaux pénètrent un univers dans lequel il leur est impossible de gagner de l’argent légalement. Illes sont donc toujours hésitant-es à appeler une ambulance, aller à l’hôpital, à se munir d’assurances de toute sorte, conduire une voiture, ouvrir un compte de banque, utiliser une carte de crédit, tenter d’obtenir un prêt hypothécaire, signer un bail ou se fier a tout support auquel un-e citoyen-ne « à part entière » a droit. Ceux d’entre vous qui, pour une raison ou une autre, ont vécu en marge du système en place à un moment ou un autre seront peut-être en mesure de reconnaitre la difficulté de vivre ainsi à temps plein.
L’immigration illégale est une forme légitime de résistance face aux inégalités du capitalisme qui asservit des millions de personnes dans le monde. C’est une résistance indirecte certes, mais qui arrive tout de même à ses fins et agit sur les deux axes suivants : d’abord, l’argent généré par les travailleur-es illégaux aux États-Unis qui est envoyé hors du pays aux familles de ceulles-ci a totalisé plus de 21 milliards de dollars en 2010 seulement. La somme de tout l’argent qui se transfère du nord au sud de l’Amérique par le biais des travailleur-es illégaux est encore plus élevée. Bien que le tout passe par le filtre de l’exploitation, cet argent représente l’un des plus grands mouvements de redistribution des richesses de l’Histoire.
Ensuite, l’immigration du sud vers le nord entraîne d’importants changements démographiques sur le continent et touche particulièrement les États-Unis. Ce changement a le pouvoir d’engendrer une véritable transition sociale au pays ; une restructuration qui rendrait le système économique global un peu plus équitable, où les inégalités entre le nord et le sud seraient diminuées ; ce qui ralentirait forcément le flux migratoire par effet domino.
Il n’est cependant pas acquis que le phénomène mentionné ci-dessus se réalisera. Plusieurs générations d’immigrant-es ont passés de la marge à la masse dans la société états-unienne sans créer de remous. C’est d’ailleurs ainsi que les colons ont pu envahir le territoire. Reste que des caractéristiques bien précises de l’Histoire états-unienne montrent que ce parcours semble réservé aux immigrant-es européen-nes et à leurs descendant-es. Les États-Unis ont-ils la capacité d’assimiler ou de couper du reste du monde les millions d’immigrant-es non européens sans en venir à compromettre l’idéologie de la suprématie blanche sur laquelle ils reposent ? Ce changement démographique latent est la cause d’une réelle angoisse chez certains États-Uniens puissants comme chez bien d’autres qui, sans être en position de pouvoir, n’ont simplement pas conscience de toutes les ramifications, causes et conséquences de leur racisme. En ce qui me concerne, je pense que le plus tôt nous serons débarrassés de cette idéologie, le mieux nous nous porterons. Je crois que l’érosion même partielle de la suprématie blanche aux États-Unis sera, à long terme, dans l’intérêt de la plupart des États-Unien-nes à la peau blanche, tel que moi-même. On peut bâtir un trône avec des baïonnettes, mais on ne peut s’y asseoir bien longtemps.
À l’heure actuelle, je ne crois pas qu’il soit possible de stopper la destruction de notre planète sans contester les structures de la suprématie blanche
Au-delà du fait qu’asservir des peuples est une chose exécrable à entreprendre, ce n’est pas non plus une façon très sécuritaire de vivre. C’est extraordinaire que les Afro-Américain-nes aient réussi à se libérer à la fois de l’esclavage et des lois Jim Crow sans avoir recours à un massacre sans distinction et à grande échelle de leurs tortionnaires blancs. Ceci aurait certainement été compréhensible, voire justifié. Je soupçonne que cette révolution aurait été beaucoup plus sanglante s’il n’y avait pas eu quelques blancs par-ci par-là, enclins à prendre position du côté des opprimé-es. Cependant, je ne parierais pas que les millions de gens qui se font bousculer d’un côté et de l’autre du globe à l’heure actuelle n’aient la même retenue lorsque viendra le jour J. Il semble plus sage de choisir la solidarité pendant qu’il est (peut-être) encore temps de le faire.
D’une manière ou d’une autre, les roues sont en train de quitter le wagon. Il ne faut pas oublier que nous habitons tous la même petite planète. Notre mode de vie est hors de tout doute destructeur pour notre biosphère et menace notre survie à long terme en tant qu’espèce. Comme d’autres l’ont noté avant moi, ma génération est la première génération d’États-Uniens blancs qui non seulement ont le mandat de changer le cours des choses, mais ont de plus un intérêt personnel à le faire. Si aucune action n’est prise en ce sens, nous serons condamné-es au cours de notre vie à regarder le monde se faire cannibaliser par ceulles qui en sont responsables et qui ne laisseront à nos enfants qu’une société cadavérique, rongée jusqu’aux os, pillée de ses richesses. À l’heure actuelle, je ne crois pas qu’il soit possible de stopper la destruction de notre planète sans contester les structures de la suprématie blanche et vice versa.
La solution pour les États-Unien-nes n’est donc pas de défendre l’indéfendable au prix de leur âme ou de dissoudre leur identité au profit des nouveaux arrivants. Il s’agit de réfléchir à nos allégeances et d’agir sur ces principes de façon significative. Croyez-le ou non, plusieurs personnes faisant partie du groupe des oppresseurs et des colonisateurs ont, à travers l’Histoire, choisi le camp de l’opprimé. Des blancs ont pris part au Underground Railroad durant l’esclavage, ont abrité des juifs durant l’Holocauste ; des États-Uniens blancs ont pris part aux mouvements des droits civiques, des blancs sud-africains ont résisté à l’apartheid, d’autres ont participé au mouvement Sanctuary, dans les années 80, pendant les guerres d’Amérique du Sud et d’autres encore résistent à l’occupation d’Israël en Palestine en ce moment même. Voilà des combats auxquels on peut être fiers de prendre part.
Nos adversaires nous appelleront des traîtres comme si nous adhérions à un gouvernement ennemi alors qu’en réalité nous aurons plaidé allégeance à une idée beaucoup plus ancienne et plus sage que toutes celles proposées par quelque état de nation. Ce sont ceulles qui excusent l’ordre actuel des choses qui ont tourné le dos au monde et se sont écartés de leur véritable chemin, pas nous.
Mon travail a fini par me faire comprendre que chaque partie de la problématique globale actuelle est inextricablement liée aux autres. Les tueries du Juárez ne cesseront pas sans un changement structurel au sein du Mexique, ce qui n’arrivera pas sans que ne se produise un changement structurel dans l’ensemble de la Colombie et des autres pays producteurs de cocaïne, ce qui ne risque pas d’arriver sans un changement structurel dans l’ensemble des États-Unis, etc. On pourrait lire cette précédente phrase dans le sens inverse et y rajouter d’autres éléments sans en changer la véracité. Se battre contre les déportations dans son pays et se battre contre la militarisation de la frontière sont deux axes différents d’un même combat. Tous deux ont un impact global ; ce qui est particulièrement vrai dans le cas du Mexique, des États-Unis et de leur rejeton monstrueux qu’est la frontière. Rien ne s’y améliorera tant que les deux pays refuseront de changer de cap et de résoudre les problèmes qu’ils causent dans le pays de l’autre.
Un jour j’ai demandé à un citoyen de la ville de Oxaca ce qu’il croyait qu’il faudrait faire afin de mettre un terme aux morts dans le désert. « Une révolution binationale » m’a-t-il rétorqué sans hésitation. Puis il s’est mis à rire et j’ai ri avec lui parce qu’une telle chose semble complètement impossible ; du moins tout aussi impossible que, disons, une double révolution à la fois égyptienne et tunisienne…
Les nouveaux volontaires de mon groupe me demandent parfois ce que je considèrerais comme étant une politique frontalière juste et équitable. Je leur rétorque systématiquement qu’il n’y a rien de tel puisqu’il y a contradiction au sein même des termes employés. Je ne suis aucunement intéressé-e à aider les autorités à nettoyer le dégât qu’elles ont créé. Pour moi, la seule solution envisageable à la crise migratoire consiste à opérer de profonds changements systémiques dans l’ensemble du globe afin de redonner aux gens une liberté de mouvement au sein de celui-ci. Il s’agirait de rejeter tout contrôle gouvernemental sur le territoire, d’honorer l’autonomie et la souveraineté des autochtones sur celui-ci, de reconnaître notre bagage d’esclavagistes et de colonisateurs et de distribuer équitablement les ressources naturelles entre ceulles qui vivent au nord et ceulles qui vivent au sud. Je souhaite que les humains arrivent à changer radicalement leur relation à la planète et aux habitant-es de celle-ci. C’est un bien gros programme. Alors, par où commencer ?
Le désert n’est qu’un lieu parmi tant d’autres pour passer à l’action. L’avantage de celui-ci est que nous avons des preuves tangibles de l’impact qu’ont sur des vies humaines les bouteilles d’eau, la nourriture ou l’aide médicale que nous fournissons. Je suis sûre que certaines personnes qui ont croisé notre route seraient décédées et n’auraient jamais réussi à revoir leur famille sans les ressources que nous fournissons ici. Je ne dis pas cela afin de quémander quelque reconnaissance, mais simplement pour démontrer qu’il faut bien commencer quelque part et qu’avoir une réelle influence sur l’ensemble du problème est possible.
Certaines personnes déplorent parfois que les actions de mon groupe n’agissent que comme de vulgaires diachylons. Cette métaphore m’irrite parce qu’elle n’est pas assez forte pour décrire l’enjeu considérable à défendre. Une seule vie vaut tout l’or du monde aux yeux de celui qui la vit. « Tourniquet » leur dis-je. « Vous voulez dire que vous ne voulez pas qu’on serve simplement de tourniquet. »
La faiblesse de notre pratique tient pourtant dans le fait que nous travaillons toujours avec le symptôme et non la cause du problème. Je doute que nos actions aient un bien grand effet sur l’ensemble des facteurs qui poussent les gens à se rendre dans le désert. On a un peu l’impression de ramasser des pots que d’autres ont cassés, de compenser pour les dommages que le beau-père alcoolique cause au reste de la famille : c’est mieux que rien, mais en réalité ce sont les mauvais traitements qui doivent cesser.
Plusieurs actions directes efficaces se traduisent par une forme ou une autre de limitation des dégâts. Il est toujours plus simple d’atteindre des objectifs et d’avoir du succès lorsqu’on est face à une personne plutôt qu’un système. Il est facile pour moi de visualiser toutes les étapes que je dois accomplir pour distribuer une centaine de litres d’eau le long d’une route. Quand je me lève le matin, ma certitude d’être en mesure d’accomplir cette tâche me donne envie d’avancer. C’est beaucoup plus facile que de tenter de visualiser comment je pourrais réussir à chasser la patrouille frontalière du désert, ou comment effectuer un changement majeur dans les structures de l’économie mondiale. Il serait tentant d’affirmer qu’il vaut mieux accumuler de petites victoires que de grands échecs, mais je trouve l’idée plutôt défaitiste. Je n’ai absolument aucune envie d’être encore en train de distribuer de l’eau ici dans vingt-cinq ans. Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
Heureusement, personne ne doit porter seul le poids du monde. Ce n’est pas mon rôle de libérer les peuples, à l’instar de Moïse. Les profonds changements sociaux n’adviennent pas ainsi. Je désire faire mon possible pour apporter mon aide au mouvement, mais si les peuples veulent se libérer ils devront le faire eux-mêmes ; non seulement parce que ce n’est pas à moi de le faire, mais surtout parce que je ne peux simplement pas imposer la forme que prendra la libération de peuples pour qui je ne suis qu’un-e allié-e. J’ai confiance que les millions de gens qui sont affectés directement par le contrôle frontalier continueront sans relâche à trouver de nouveaux moyens de se défendre contre celui-ci. Il y a certainement plusieurs actions qui peuvent être prises par les citoyen-nes états-uniennes blanc-hes qui le désirent ; suffit de rester à l’écoute. Si mes efforts dans le désert ont pu contribuer, d’une manière ou de l’autre, à déplacer 21 milliards de dollars des poches des riches vers celles des pauvres, je peux me considérer comme heureux-se.
Sur ce, cher lecteur, permets-moi de m’adresser directement à toi.
La mort dans le désert n’est pas la seule chose horrible en ce bas monde, mais c’est assez horrible. Ce combat me tient vraiment à cœur et j’aimerais pouvoir y mettre un terme. Je t’encourage fortement à trouver une façon de t’impliquer, mais je ne peux pas te dire comment. Venir travailler dans le désert est un moyen et il y en a beaucoup d’autres. Il existe des communautés de sans-papiers partout aux États-Unis. Quelle est la situation dans ton secteur ? Quelle forme peut prendre ton appui ? Des sociétés commerciales profitent de la situation actuelle dans tous les recoins du pays. Comment peux-tu agir pour leur mettre des bâtons dans les roues ?
Certains suggèrent qu’en vue de lier un objectif tangible à un changement systémique, il faut chercher les lieux d’interventions où nous aurions la possibilité d’appliquer une « pression en contrepoids » au système en place afin de provoquer un changement de cap, une transformation. Ces points de pression se situeraient au sein de la « chaîne de consommation globale des biens, services et produits » soit les points de production, de destruction, de consommation, de décision et de conception des dits biens, services et produits. Cette grille d’analyse n’est pas parfaite, mais peut se montrer utile en tant que cadre de réflexion lorsqu’on cherche à intervenir dans la situation décrite précédemment.
À quoi ressemblerait donc une action directe appliquée au point de production ? En ralentissant la construction d’une nouvelle prison de la CCA ? Et au niveau de la destruction ? Trouver des moyens d’empêcher les activités du Immigration and Customs Enforcement (ICE), des patrouilleurs frontaliers et les déportations ? Et au niveau de la consommation ? On peut faire pression sur les employeurs afin qu’ils se positionnent contre des lois discriminatoires et racistes, ou encore boycotter ceux qui en profitent ? Au niveau décisionnel ? Y a-t-il possibilité d’interrompre des rencontres et des réunions dans le processus législatif ? Et pour la conception ? Il serait pertinent de se demander ce qui, dans l’espace public, sert d’outil justificatif à la déshumanisation des immigrants. Comment pourrions-nous contester ces perceptions ? As-tu d’autres idées ?
J’ai confiance que les millions de gens qui sont affectés directement par le contrôle frontalier continueront sans relâche à trouver de nouveaux moyens de se défendre contre celui-ci.
L’aide humanitaire dans le désert est une forme d’action directe plutôt récente. Plusieurs de nos tactiques doivent être perfectionnées et d’autres deviennent rapidement caduques. Il y a encore beaucoup à apprendre sur le fonctionnement de ce secteur et nous sommes ouvert-es à recevoir toute l’aide qui nous sera offerte. Les alliances binationales et transculturelles qui ont étés forgées de part et d’autre de la frontière sont prometteuses et n’ont pas encore atteint leur plein potentiel. Notre capacité à développer ces alliances déterminera l’étendue du succès de notre campagne visant à mettre fin aux morts dans le désert et permettra de prendre le pouls, à savoir si cette campagne a pu se métamorphoser en un véritable mouvement de résistance face au système qui engendre ces morts.
Ils nous entendront rugir.
Le désert est rempli de lieux que je considère comme étant sacrés. C’est le dernier endroit où j’ai vu Esteban et celui où j’ai trouvé Alberto. C’est ici où Claudia, Jose, Susana et Roberto sont morts, près du Rocher de Jamie, de la colline de Yolanda, de l’Arbre d’Alfredo. Je trouve accablant de me dire que toutes les histoires auxquelles j’ai assisté ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’océan des situations atroces qui se sont vécues ici. Les objets abandonnés en chemins servent de témoins silencieux, de preuves tangibles du passage de ses gens dont la réalité parle du pire et du meilleur de l’humain.
Je ne suis pas une personne particulièrement spirituelle, mais le poids de ces vestiges est souvent immense et étouffant. J’aime profondément le désert. Mon cœur se serre quand je pense qu’il a été l’hôte d’autant de souffrance. Je me console en me disant qu’un jour, ne serait-ce que parce que l’humanité se sera éteinte, il n’y aura plus d’États-Unis d’Amérique, plus de Mexique, plus d’hélicoptères, plus de murs, plus de patrouilleurs, plus de frontières. Le plastique finira par se décomposer, les traces de notre civilisation actuelle s’effaceront. Alors, sous un ciel bleu dans lequel règnera encore un soleil impitoyable, la terre pourra guérir.
« Las paredes vueltas de lado son puentes »
Les murs qu’on abaisse forment des ponts.
–graffiti peint sur le mur de la frontière dans la ville de Nogales, dans l’état de Sonora au Mexique
Appendice : La patrouille frontalière
Je me permets d’ajouter ici quelques mots à propos de la patrouille frontalière. Sachez d’abord qu’aucun autre poste de fonctionnaire ne nécessitant pas de diplôme d’études secondaire n’est aussi bien payé que ceux de patrouilleurs frontaliers. Leur salaire commence aux environs de 45 000 $USD la première année, 55 000 $ les deux suivantes et va au-delà des 70 000 $ par la suite, selon l’ancienneté. Disons qu’ils ne meurent pas de faim. Je ne sais pas comment exprimer l’étendue des abus de pouvoir qu’on fait subir ces clowns à des migrant-es qui se sont ensuite confiés à moi. On m’a rapporté des cas où des agents ont battus, violés, fait feu sur des migrants sans défense en plus d’en avoir jeté d’autres dans des cactus, d’avoir volé leur argent, refusé à des détenus de l’eau et de la nourriture, déportés des mineurs non accompagnés, conduits en chauffard à toute vitesse avec des migrant-es enchaîné-es à l’arrière de camions qui ressemblaient étrangement à ceux qu’utilisent les fourrières… La liste est longue. J’ai aussi entendu plusieurs histoires concernant des agents frontaliers qui, après avoir saisi une quantité importante de cannabis aux trafiquants de drogues, laissaient simplement ces derniers partir ou traverser la frontière. Qu’en advient-il du cannabis dans un cas pareil ? Qui sait !
La patrouille frontalière est une fonction très lucrative en elle-même et une part de sa stratégie est de faire passer son travail comme plus dangereux qu’il ne l’est en réalité, afin d’enjoindre les payeurs de taxes à injecter toujours davantage d’argent dans le domaine. J’ai d’ailleurs constaté que la plupart des agents frontaliers considèrent qu’ils méritent d’être grassement payés pour l’immense service qu’ils rendent à l’ensemble de la planète, qui devrait se montrer plus reconnaissante à leur égard d’exercer une fonction aussi périlleuse. À noter que depuis la mise en place de cette organisation en 1904, seulement 111 agents frontaliers sont morts en service, dont 40 par homicide. En 2010, 3 patrouilleurs sur 20 000 sont morts. Deux ont étés tués et un autre a eu un accident de voiture. Il est impossible de savoir le nombre exact de migrant-es qui perdent la vie chaque année en tentant de traverser le désert, mais ça se situe quelque part entre 500 et 1000. En regardant les chiffres on se rend vite compte que la fonction de patrouilleurs est en fait plus sécuritaire que bien des métiers tels que couvreur-e de toiture, éboueur-e, camionneur-e, travailleur-e du sexe et bien d’autres dont le travail est en fait réellement dangereux.
Une chose que tout agent frontalier qui se respecte dira est qu’il nous protège des terroristes. Cette affirmation invite à se questionner à savoir qui est donc ce « nous » dont il parle.
Bien plus de morts peuvent être directement liées à l’activité des patrouilleurs à la frontière qu’à l’ensemble des attaques effectuées par Al Qaeda en sol État-Unien ; sans compter toutes les attaques que ces agents entreprennent, mais échouent. L’important est de se souvenir que tant et aussi longtemps qu’il y aura des inégalités aussi scandaleuses dans le monde, les États-Unien-nes ne seront pas en sécurité.
Plusieurs patrouilleurs sont issus du prolétariat et sont de descendance hispanique ; et je dois avouer en avoir rencontré qui traitaient les migrant-es avec respect. Je dirai aussi qu’il arrive parfois qu’ils portent secours à des migrant-es et que certain-es de ceulles-ci seraient sans doute mort-es sans leur intervention. Qu’en somme, certains agents sont de bonnes personnes. Il n’en reste pas moins que ce sont les patrouilleurs qui appliquent les politiques frontalières causant tous ces problèmes que je m’évertue à décortiquer. Peu importe leur vie personnelle, ces gens ne feront jamais partie de la solution tant qu’ils porteront l’uniforme et les armes de l’oppresseur. En fin de compte, les patrouilleurs en tant que groupe ont le pouvoir de stopper les morts du désert simplement en restant à la maison. J’ai entendu trop d’excuses ; qu’ils ne sont pas l’ennemi, qu’ils sont soumis aux mêmes forces économiques que les migrant-es, etc. Je n’y crois pas. L’Histoire regorge d’exemples de lâches prêt-es à sacrifier les leurs pour sauver leur peau. Il y avait des négriers noirs sur les plantations, des polices juives dans les ghettos, des autochtones d’Amérique qui combattaient Crazy Horse et maintenant il y a des agents frontaliers issus des communautés hispaniques dans le désert. Je ne peux simplement pas accepter ces justifications minables. Je crois que tout humain qui devient volontairement complice de telles atrocités ne mérite aucune sympathie.
Un de mes camarades a récemment découvert le corps d’une femme, décédée suite à une combinaison de déshydratation, d’insolation et d’épuisement à une vingtaine de mètres à peine d’un de nos plus gros points de ravitaillement ; un lieu que j’ai moi-même desservit des centaines de fois. La zone dans laquelle elle a été retrouvée était patrouillée par une équipe d’agents frontaliers particulièrement hostiles qui, depuis des mois, vidaient systématiquement les bouteilles d’eau que nous y laissions, ouvraient nos boîtes de conserve de fèves pour les faire pourrir et emportaient les couvertures que nous déposions le long du chemin pour protéger les migrants des nuits glaciales du désert. Ce vandalisme systématique nous a forcé à déplacer constamment les points de ravitaillements hors de toute zone qui semblait de prime abord idéale, de peur de voir nos efforts sabotés par les agents. Il est presque certain que la femme, avant de mourir, a dû passer par un de ses points de ravitaillements saccagés, ou du moins près d’un endroit où il y aurait normalement eu du ravitaillement si ce n’était pas des dommages causés par ces patrouilleurs. Je crois qu’il est très probable qu’elle aurait survécu assez longtemps pour que nous la trouvions si elle avait eu accès à notre eau et notre nourriture. En ce qui me concerne, les ordures qui ont commis ces actes de vandalisme ont sur leurs mains le sang de cette femme. Ils sont des assassins.
Les patrouilleurs frontaliers vivent dans la peur même lorsqu’il n’y a pas de danger apparent. Ça se voit dans leurs yeux. Ce doit être la conséquence d’avoir à berner et trahir ses semblables jour après jour. Personnellement, je retire un certain plaisir à pouvoir me promener sans arme dans un lieu où d’autres peinent à mettre le pied, même avec un gilet pare-balle et un fusil automatique. Je ne suis pas devenu un ennemi du peuple et à long terme, ceci me gardera plus en sécurité qu’eux.
Mémoires de la frontière : 1re partie
Nous marchions le long d’un petit canyon. Un de mes compagnons s’évertuait à crier à pleins poumons : « COMPANERAS ! COMPANEROS ! NO TENGAN MIEDO ! TENEMOS AGUA, COMIDA, I MEDICAMENTOS ! SOMOS AMIGOS ! NO SOMOS LA MIGRA ! ESTAMOS AQUI PARA AYUDARLES ! SI NECESITAN CUALQUIER COSA : GRITENOS ! » La plupart du temps, personne ne répond à l’appel. Au détour du canyon, nous sommes tombés face à environ trente-cinq personnes, hommes, femmes et adolescents ; tous vêtus de noirs ou de brun, et visiblement atteint de la fièvre du désert. Il régnait un silence de mort dans le recoin où ils s’étaient tous entassés.
« Oh bordel… euh… nous avez-vous entendus arriver ? »
« Oui, on vous a entendu »
Il faisait vraiment chaud.
On leur a donné de l’eau et des chaussettes avant de commencer à soigner les nombreuses chevilles foulées, coupures et ampoules. Illes provenaient tous du Guatemala et voyageaient ensemble depuis le début. On s’apprêtait à repartir quand l’un d’entre eulles nous a tendu un sac rempli de dollars et de pesos.
« Euh… non. Vous ne comprenez pas. Vous n’avez pas à nous payer. Nous sommes ici pour ça. »
« C’est vous qui ne comprenez pas. » A-t-il rétorqué. « Nous avons trouvé cet argent près d’un autel dédié à la vierge, dans le désert. Nous avons pensé qu’il ne servirait à personne là-bas alors nous l’avons emporté, mais si la patrouille frontalière nous arrête, ils prendront l’argent et personne ne pourra en profiter. Prenez l’argent et servez-vous-en pour aider d’autres migrant-es. » Nous avons respecté leur volonté.
Mémoires de la frontière : 2e partie
Mon collègue et moi sommes partis en voiture vers le fin fond du désert afin d’y laisser des caisses de bouteilles d’eau pour les migrant-es. Quatre jours plus tard, nous y sommes retournés pour voir ce qui en était advenu. En chemin, nous avons remarqué un homme qui était assis sur le côté d’une route de terre. Il avait un morceau de couverture enroulé autour de la jambe.
« Comment ça va ? » Lui a-t-on demandé.
« Mal. » A-t-il répondu « Regardez ça. »
Il a levé le tissu de son pantalon qui cachait sa jambe noire, enflée, brisée.
« C’est pas bon ça. Tu dois aller à l’hôpital. »
« Ouais… regarde ça. » Il a levé son chandail.
« OH SHIT. » Avons-nous répondu à l’unisson, mon collègue et moi. Il avait une énorme plaie ouverte, ensanglantée, à moitié cicatrisée et pleine de pue, sur la poitrine.
« Il faut que tu ailles à l’hôpital immédiatement. Qu’est-ce qui s’est passé ? »
« Il y a quatre nuits de ça, je marchais avec trois autres hommes dans les montagnes là-bas. J’ai perdu pied et je suis tombé dans un ravin. J’ai fait une chute d’environ 4 mètres. L’impact m’a cassé la cheville et je me suis ouvert le torse sur un rocher. Mes camarades m’ont transporté jusqu’en bas. Ça leur a pris toute la nuit. Le Lendemain matin, nous vous avons vu passer en voiture, mais nous étions encore trop hauts pour atteindre la route à temps. Ils m’ont laissé ici en disant qu’ils allaient chercher de l’aide. Je n’ai vu personne depuis. »
« Ça fait quatre jours que tu es ici ? » La température avait tourné autour des 40 degrés Celcius toute la semaine. « As-tu eu accès à de l’eau ou de la nourriture ? »
« Pas de nourriture. J’ai rampé jusqu’à l’étang là-bas à quelques reprises pour boire, mais je ne voulais pas m’éloigner de la route, au cas où quelqu’un viendrait. »
À une centaine de mètres de la route, une espèce de mare asséchée d’à peine quelques centimètres de profondeur, dans laquelle on abreuve normalement le bétail, pleine d’engrais et de boue. Dans le sable, une douzaine d’empreintes témoignaient des allées et retours qu’il avait effectués, en se traînant au sol, entre la route et la flaque d’eau brune. Nous l’avons conduit en ambulance. Il demeurait remarquablement stoïque face à sa situation. Je lui ai demandé si les bosses sur la route lui faisaient mal à la cheville.
« Non. »
« Ta poitrine ? »
« Non. »
« Te sens-tu malade à cause de l’eau de l’étang ? » Je me doutais qu’il mourrait si c’était le cas.
« Non. »
Nous l’avons laissé à l’hôpital. Je n’ai plus jamais eu de ses nouvelles.
Mémoires de la frontière : troisième partie.
Nous avons reçu un appel du consulat mexicain. La famille d’un homme les avait contactés. Il manquait à l’appel depuis neuf jours. La dernière fois qu’il avait été aperçu, il se trouvait près d’une petite source d’eau et avait une côte fracturée. Le consulat croyait qu’il se trouvait dans notre secteur. Nous l’avons cherché sans relâche pendant une semaine sans le trouver. Son frère avait les bons papiers et est donc venu nous rejoindre, à cheval. Il a ratissé le désert pendant une autre semaine avant de trouver son cadavre.
Deux semaines plus tard, un homme est entré dans notre campement avec une de nos cruches d’eau (identifiable par les inscriptions que nous traçons dessus ) presque vide dans une main et un grand bâton sur lequel était noué un t-shirt blanc dans l’autre. Il m’a tendu la cruche d’eau en disant : « Cette eau m’a sauvé la vie. Je priais Jésus pour de l’eau. J’étais certain que j’allais mourir et puis j’ai trouvé cette eau, en plein milieu du désert ! Je crois que la patrouille frontalière l’a déposé là pour les migrants. »
« Oh non… » J’ai répondu. « La patrouille frontalière se fout éperdument que tu vives ou que tu meures. C’est nous qui avons laissé l’eau. »
« Ces bâtards ! » a-t-il répondu. « Ça fait trois jours que je brandis ce drapeau blanc à leurs hélicoptères, qu’ils m’ignorent et continuent à voltiger. Quand on a besoin d’eux, c’est impossible de les trouver et quand on ne veut pas les voir ils apparaissent comme par magie. »
J’ai regardé les informations inscrites sur la bouteille. Elle provenait d’un point de ravitaillement que nous avions créé deux semaines auparavant, dans une zone que nous visitons peu, mais où nous nous étions rendu lorsque nous cherchions l’homme qui est mort.
Mémoires de la frontière : dernière partie.
On a reçu un appel des voisins. Un homme avait rampé jusqu’à leur porte. Il était dans un état lamentable. Il arrivait à peine à se tenir debout et à parler. Il n’avait rien mangé ni bu depuis trois jours. Il n’avait pas non plus uriné depuis presque deux jours. Il avait fait extrêmement chaud. Nous tentions de lui faire ingurgiter des liquides, mais il les vomissait systématiquement.
« C’est vraiment pas bon signe. » Lui ai-je dit. « T’as besoin d’une intraveineuse. On n’en a pas ici. C’est possible que tes reins soient endommagés. On peut pas soigner ça. Il faut que tu ailles à l’hôpital. Ils vont te déporter après t’avoir soigné, mais si tu n’y vas pas tu risques fortement de mourir. »
Il m’a dit :
« Non. Ne les appelle pas. »
« S’il te plaît… Je comprends, mais »
« Non. Ne les appelle pas. »
« Mais »
« Non. »
On l’a allongé.
Après plusieurs heures, il a réussi à garder un peu d’eau. On s’est occupé de lui toute la nuit, du mieux qu’on a pu, en essayant de l’abreuver à chaque heure environ. Au matin, il arrivait à assimiler son eau sans vomir et a même réussi à uriner un peu. Il se tenait à peine debout, mais il était de nouveau capable de parler.
« Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi malade refuser d’aller à l’hôpital. Que t’est-il arrivé ? »
« J’ai habité aux États-Unis pendant 18 ans », a-t-il commencé. « Je n’ai jamais eu d’ennuis. Je n’ai même jamais eu de contravention. Ma femme et moi avions enfin terminé de payer la maison. Tous mes enfants sont ici ; et mes petits-enfants aussi. Je gagne ma vie en aidant les ainés. Il y a six mois, j’ai eu un accident et je me suis cassé le dos. J’ai été alité pour environ quatre mois. J’étais de retour au travail quand je me suis fait interpeller. La police disait que j’avais oublié de mettre mon clignotant. Je suis ici depuis dix-huit ans et je ne me suis jamais fait interpeller. J’ai toujours fait attention. Ils m’ont envoyé en prison. Ils m’ont gardé là quinze jours, enchaîné aux pieds et aux poignets. Ils nous donnaient des craquelins recouverts de beurre d’arachide à manger, trois fois par jour. J’ai été enchaîné du début à la fin de mon séjour en prison. Ils m’ont jeté les mains vides de l’autre côté de la frontière. Je n’avais nulle part où aller. Je n’avais pas été au Mexique depuis tellement longtemps… Cette nuit-là, je suis parti avec un groupe qui nous a conduits très loin dans le désert. On a marché pendant trois jours. Je n’étais pas capable de suivre le rythme. Je ne suis plus si jeune. Alors, ils m’ont abandonné sans eau ni nourriture ; et je suis resté seul trois jours de plus. Je n’avais aucune idée de l’endroit où je me trouvais. J’ai bu de l’eau provenant d’un étang à vache et ça m’a rendu encore plus malade. J’entendais des voix et j’hallucinais. Quand j’ai aperçu la maison, je n’étais pas certain qu’elle soit vraiment réelle, mais j’ai continué à marcher. Je croyais que j’étais peut-être déjà mort. Je ne pourrais jamais recommencer. Toute ma vie est ici, aux États-Unis. Je ne possède rien au monde si je ne peux pas y revenir. Si je meurs, je meurs, mais c’est ma seule chance. Je dois continuer. »
Sa convalescence a été longue. Il nous a donné un coup de fil une semaine après son départ, de sa maison. Un mois plus tard, sa femme et lui nous ont envoyé un énorme colis de chaussures, de nourriture et de vêtements pour les migrants.
« Je ne sors pas de la maison. » M’a-t-il dit. « Je ne peux pas me permettre de risquer tout ça encore. J’ai tellement souffert là-bas. Je suis encore en convalescence… Je sais que je ne pourrais jamais survivre à ça une deuxième fois. »
Pour pousser plus loin la réflexion :
www.kaosenlared.net
www.elenemigocomun.net
www.narconews.com
www.upsidedownworld.org
www.oodhamsolidarity.blogspot.com
www.chaparralrespectnoborders.blogspot.com
www.fireneverextinguished.blogspot.com
www.solidairty-project.org
www.nomoredeaths.org
La version originale en anglais de cet essai peut être retrouvée en ligne au :
www.elenemigocomun.net/2011/06/designed-kill-border-policy/